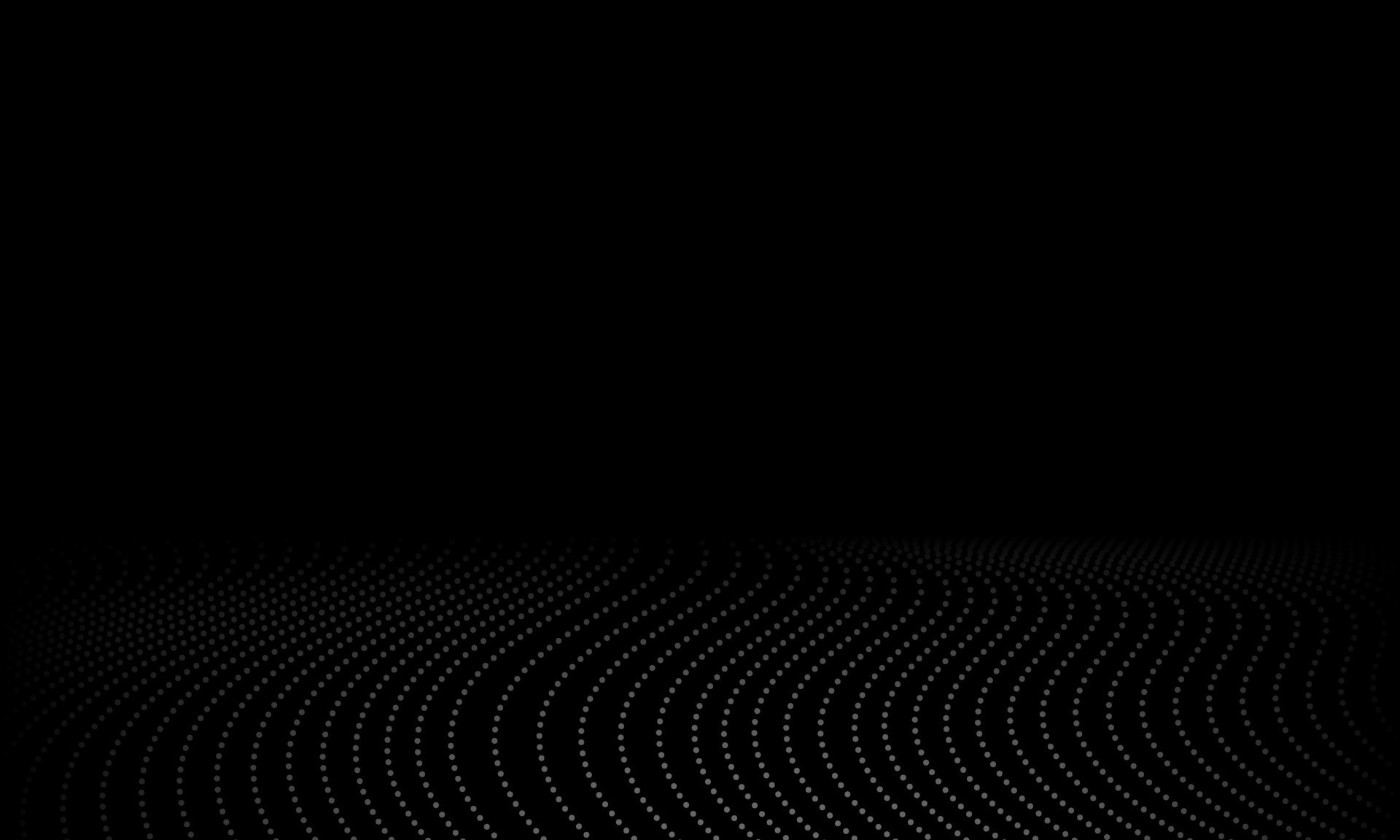La haine est l'une de ces forces infra-politiques qui sont capables de s'insinuer dans tous les domaines de la vie socialement vécue ou fantasmée. Elle incombe aux gens (misanthropie, misogynie, misandrie, racisme, antisémitisme, xénophobie), aux choses (la technique et ses objets, les styles vestimentaires et styles de vie, l'architecture et le design, etc.), aux temporalités (la Modernité, le présent, le passé, le futur, les vacances, les fêtes de fin d'année, etc.) et aux espaces (le Nord, le Sud, l'Ouest ou l'Est, les ailleurs et l'autre côté des frontières, la ville ou la campagne, la nature domestique ou sauvage). Elle s'exerce même à l'encontre de concepts ou dispositions de l'esprit : le capitalisme, la raison ou encore la démocratie (J. Herf). Elle court-circuite les échanges, sclérose les débats et fige l'identité de son ennemi pour mieux motiver son exclusion ou même sa destruction. En somme, la haine n’est jamais qu’un sentiment, elle relève du processus et des relations réciproques, et de facto, elle reste là, implicite ou explicite, au cœur de l’existence sociale.
Si la « société de l'indignation » (B-Ch. Han) ne cesse d'allonger la liste de ses injustices sociales, ses formes de protestations se succèdent dans l'espace public (J. Habermas), sont de plus en plus virulentes (J. Baudrillard), offrent parfois le spectacle d'un radicalisme désormais ordinaire voire cool sans pour autant contribuer à une réelle critique sociale.
La cristallisation des polarités, des positionnements ou même des postures politiques, culturelles et identitaires autour d'une « frontière » tantôt matérielle tantôt idéelle, semble favoriser le « diagonalisme » ou « théorie du fer à cheval » (J-P. Faye), c'est-à-dire un cadre socio-politique où les critiques extrêmes se figent dans des points de rencontre sans réelle contradiction ni possibilité de dépassement (Th. Adorno). Le communautarisme qui configure l'espace politique et social contemporain, expression et conséquence du polythéisme des valeurs cher à Max Weber, n'entraîne-t-il pas aussi une haine à la carte ?
La haine est un psychotrope qui fait du bien au corps, qui chasse pensées noires et dépressions opaques, doutes et culpabilité. Les tyrans jouent avec ce levier : ils enchantent les foules et les asservissent en les faisant hurler à la haine contre un ennemi collectif bien dessiné, avec ce nez ou cette couleur de peau (V. Nahoum-Grappe).
Pour autant, la haine en tant qu'action en réciprocité, repose sur la reconnaissance de l'autre, de son altérité (G. Anders). Dialectique non synthétique, la haine est à la fois la prise en compte de l'autre mais aussi sa négation la plus brutale. Affirmation de soi et destruction de l'autre, le moi se pose par l'anéantissement du non-moi. La mise à distance de l'autre, voire la disparition de l'altérité signerait-elle l'obsolescence de la haine ? Le règne du brutalisme comme rapport au monde et à autrui (A. Mbembe), la surreprésentation de la violence dans les médias, ne conduisent-ils pas à une banalisation de l’agressivité ? La haine pourrait bien devenir une sorte d’expression esthétique banale et quotidienne qui annihile, neutralise ou anesthésie les processus de reconnaissance intersubjective au cœur des « façons de voir et les manières de regarder des sociétés démocratiques » (Cl. Haroche).
L'histoire de la haine, la façon dont elle s'exprime selon les époques, les cultures, les groupes sociaux qui en sont les auteurs ou les sujets, les logiques rhétoriques, discursives et images et plus généralement les esthétiques qui la soutiennent et la répandent ne sont jamais toujours les mêmes. Cette passion funeste et ses archanges (J. Verne) sont l'objet du présent numéro.
Selon une approche pluridisciplinaire, il propose à la lecture plusieurs textes :
Daniela Pomarico étudie ici la nostalgie dans les discours populistes contemporains, en soulignant les manières dont elle se transforme en devenant un outil puissant de légitimation des politiques identitaires et de rejet de l’altérité.
Elisa Réato analyse les techniques d’énonciation spécifique de la haine, via J-P. Sartre, elle montre comment cette dernière engage un positionnement politique dans nos sociétés contemporaines.
Julien Cueille rend compte des représentations esthétiques de la violence voire ultra violence dans les mangas et la façon dont leur consommation est l’expression d’une possible haine de soi. Cette forme de haine se projetterait alors à de multiples niveaux du récit et la fiction pourrait bien se présenter comme un espace de distanciation des affects négatifs.
Nelly Rousset quant à elle étudie l’identification de certaines femmes contemporaines à la figure de la sorcière comme conséquence d’une forme de misogynie vécue ou héritée. Entre désir de puissance et religiosité alternative, la figure de la sorcière actuelle se construit en partie d’une le rejet d’une société considérée comme haineuse du pouvoir des femmes.
Sebastiàn Acevedo Ojeda nous emmène en Colombie, où, depuis les années 1930, se livre un affrontement national violent qui repose sur une fracture, un fossé même dont le dépassement pacifique semble impossible et qui maintient le pays dans une spirale interminable.
Maxime Piccolo, rappelle comment Amour et Haine sont deux sentiments opposés mais en permanence en jeu dans l’existence sociale. Si la haine est particulièrement destructrice, il n’en demeure pas moins, c’est paradoxal, qu’elle peut aussi donner lieu à des formes de résistances constructives.
Dans le cadre des relations anthropo-équines, un conflit sourd. Patrice Régnier et Stéphane Héas montrent comment les équitants et les opposants à l’équitation sont engagés dans un conflit violent dont les engrenages émotionnels couvrent souvent une forme de haine dissimulée et réciproque.
Nous avons étés surpris, en tant que responsables éditoriaux, de la variété des propositions reçues. Elles témoignent toutes à leur manière d’un symptôme : la haine est là, presque imperceptible, à la fois insaisissable et virulente, nulle part et partout, derrière les écrans et les mots qui s’échangent, derrière les images et les stéréotypes, elle tait son nom tout en étant surexprimée. Comme tabou et comme totem, la haine n’est pour ainsi dire plus jamais revendiquée. Pourtant, reconnaître la haine c’est déjà la regarder en face. Pourtant, « Celui qui ne hait pas l'infamie ne fait pas seulement preuve de lâcheté mais s'attire aussi le soupçon d'être de mèche avec elle » (G. Anders, 1985).
Le numéro se clot avec deux varia et une recension. Un texte de Dhouha Wiem Mbazaa sur le Souk Chaouachine, enjeux d’une réinvention sociale dans un contexte urbain en mutation ; un autre de Denis Fleurodorge qui nous invite à regarder la télévision avec Michel Houellebecq, il s’agit d’une analyse précieuse du journal du 13 heures de J-P. Pernaut et de sa dimension toute sociologique ; et enfin une recension de l’ouvrage de Michel Agier, Les migrants et nous par Fatima Zahra Aït Salem.