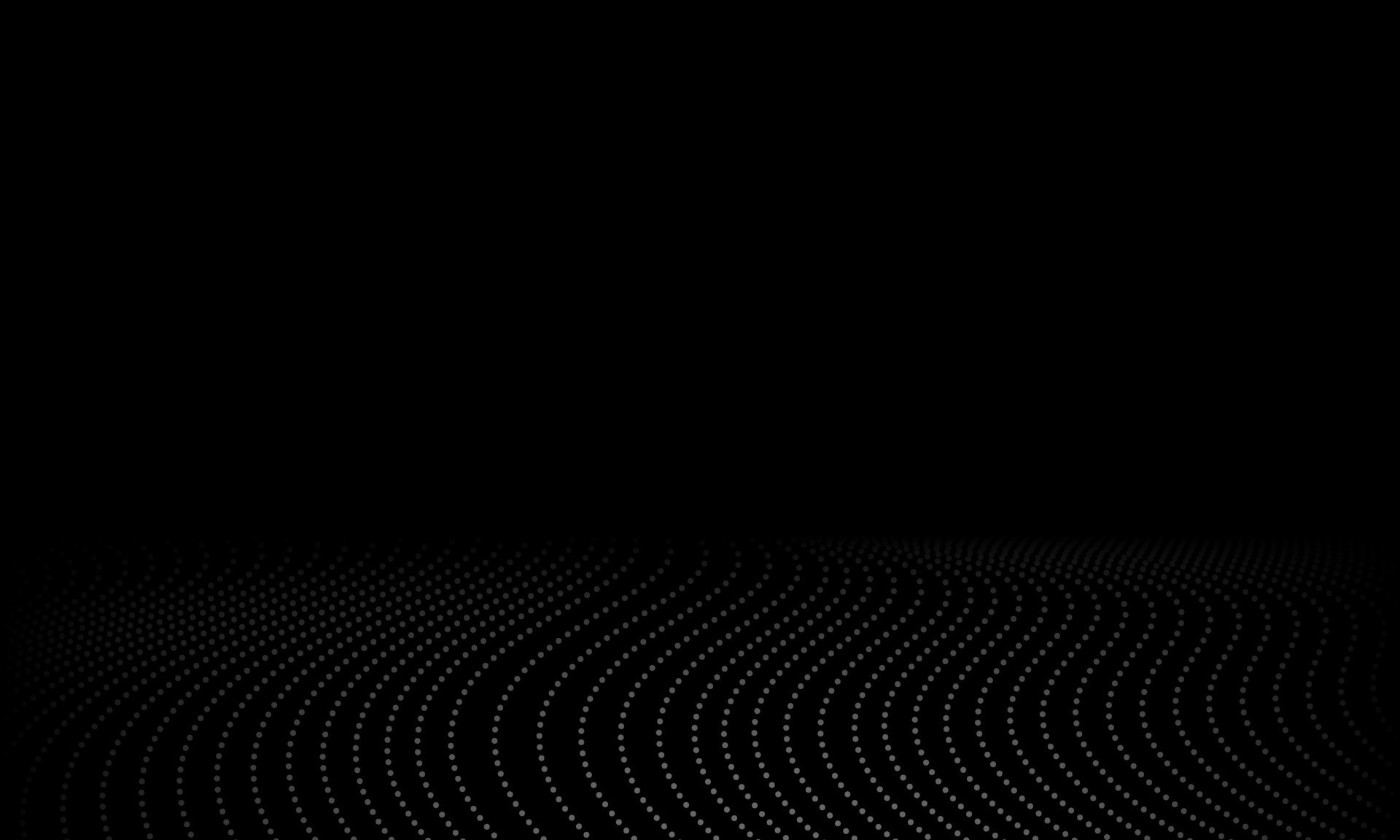Par Marianne Celka, MCF en sociologie, université Paul-Valéry Montpellier 3, chercheur au LEIRIS.

Philip Hunt, Demagogue, 28 mars 2021
Adorno s’est affirmé comme l’un des grands penseurs du XXe siècle, contributeur incontournable de l’Institut für Sozialforschung aux côtés de Walter Benjamin, Jürgen Habermas ou encore Max Horkheimer avec lequel il signe le titre Dialektik der Aufklärung en 1944. L’École de Francfort fondée en 1923 s’est fait connaître pour la portée de sa théorie critique caractérisée par son ancrage historico-culturel, son pluralisme disciplinaire et par sa capacité autoréflexive autant que pour ses concepts clés que sont « la perte de l’aura » (Benjamin), « l’unidimensionnalité » et la « raison technocrate » (Marcuse) ou encore la kulturindustrie (Adorno et Horkheimer).
En dépit de l’effondrement du régime nazi, « les conditions du fascisme continuent d’exister » (p. 14), à tout le moins sur le plan social où les conditions socio-économiques et techniques lui restent potentiellement favorables. La concentration du capital, le déclassement des couches sociales (notamment de la petite bourgeoisie) et le ressentiment qu’il génère dans la situation géopolitique allemande bien connue d’Adorno mais aussi ailleurs en Europe, entretiennent un contexte propice aux mouvements d’extrême droite. « L’inflation rampante » de l’expansionnisme keynésien, le spectre du chômage technologique (et la masse de « chômeurs potentiels »), la « peur de l’Est » (p. 16) et l’absence de liberté fragilisent les individus et leurs conditions d’existence à l’ère de l’automatisation.
Face aux grands blocs, les États semblent ne jouer qu’un rôle subalterne tandis que le nationalisme acquiert quelque chose de « fictif » (p. 18), parce que personne n’y croit plus tout à fait. C’est dans ces conditions que le nationalisme « pathique » (qui prend son aspect destructeur au moment où il se trouve privé d’une partie de sa substance, p. 19), loin d’être obsolète, épouse des formes « démoniaques ». La peur des conséquences que peuvent avoir les évolutions générales de la société est un sentiment collectivement répandu et les partisans du fascisme (ancien et nouveau) sont répartis d’une manière transversale dans toute la population (p. 19). Adorno note déjà qu’outre les petits-bourgeois, c’est la situation des paysans qui est cruciale. Pour ainsi dire « coincé » dans une crise permanente, le problème agricole ne saurait se résoudre de manière artificielle, c’est-à-dire à coup de subventions, et ce souci-là, s’il n’est pas pris en compte sérieusement restera comme un « foyer purulent » (p. 21).
Adorno souligne que pour ceux qui ont vécu l’effondrement lorsqu’ils étaient jeunes adultes, ce sentiment de déclassement et la crainte d’une déchéance de la nation s’exprime avec une force particulière qu’on retrouve dans les exclamations telles que « L’Allemagne doit remonter la pente ».
Le lunatic fringe, ce résidu « d’irréductibles fous » (p. 23) qu’on retrouve dans toutes les démocraties, expriment et confirment le fait que :
par son contenu socio-économique, la démocratie ne s’est nulle part concrétisée réellement et entièrement, qu’elle est restée formelle. Et l’on pourrait qualifier les mouvements fascistes de plaies, de cicatrices d’une démocratie, qui n’est pas encore, à ce jour, totalement à la hauteur de l’idée qu’elle se fait d’elle-même (pp. 23-24).
L’une des idées fortes d’Adorno, c’est l’effet sur les masses de l’anticipation de l’effroi. On doit comprendre la relation très complexe et difficile nous dit-il que tissent les conditions socio-économiques et le sentiment d’une catastrophe sociale à venir (p. 25 et suiv.). « Comment cela se passera-t-il s’il y a un jour une grande crise ? », c’est à partir de cette question que se pose l’ultima ratio des mouvements fascistes et qu’ils se proposent dès lors comme seule alternative. D’une certaine manière ces mouvements aspirent à la catastrophe parce que c’est dans la déliquescence des conditions matérielles et idéelles des nations qu’ils puisent leur énergie et leur légitimité.
Lorsque « la propagande elle-même [devient] proprement la substance de la politique » (p. 30), la manipulation et l’excitation artificielle de ces partis leur donnent « quelque chose du spectre d’un spectre » (p. 33). Si les mouvements de masse de « style fasciste » entretiennent une relation profonde avec « les systèmes de démence », une relation solidarisée autour de la « personnalité autoritaire », il n’en demeure pas moins, surtout aux vues de la « perfection technologique », que ces mouvements détiennent un fort potentiel de réalisation.
Dans ces conditions, Adorno considère qu’il est vain de lancer des « appels éthiques » tant que la notion d’humanité « chauffe à blanc les gens dont il est question » (p. 35). L’antisémitisme, le négationnisme, les rires qui se font entendre à l’évocation de noms juifs et les exclamations comme « vive Auschwitz ! » (p. 36), témoignent de l’obsolescence de la valeur « humanité ».
La confusion entre matérialisme au sens de la quête du profit et la théorie matérialiste de l’histoire ainsi que le « caractère [dorénavant] mythique » du communisme – dont le mot même ne sert plus que d’« épouvantail » – participent à l’une de « ces étranges scissions » au sein de la conscience de classe ; d’un côté des individus qui s’identifient à la classe bourgeoise se considèrent comme idéalistes, de l’autre, les ouvriers qui éprouvent à cet égard une sorte de scepticisme (p. 41).
À défaut de pouvoir se dire ouvertement antisémite, la méfiance se dirige vers les intellectuels. « L’antique rancune » du travailleur manuel envers le travail intellectuel (pp. 42-43) montrent d’une certaine manière comment ces mouvements, dépourvus de théorie bien établie, parce qu’« impuissants face à l’esprit » (p. 43), s’en prennent précisément à ceux qui portent l’esprit. Il y a là réification de la séparation de l’entendement et des sentiments et rejet systématique aussi bien de l’argumentation rationnelle que de la pensée discursive en général (pp. 43-44).
« L’antisémitisme a survécu aux Juifs », rationalisé pour évacuer la culpabilité, il devient le tabou qu’on dénonce d’un clin d’œil - un clin d’œil qui signifie « nous n’avons plus le droit de rien dire là-dessus » (p. 45) et qui est lourd de sous-entendus. C’est une technique certes allusive nous dit Adorno mais qui provoque certains effets, de même que celle de l’accumulation (typique du révisionnisme) ou l’art de ne jamais aller trop loin pour éviter les poursuites judiciaires, tout en suivant une logique formelle « maniaque ». C’est contre ces techniques de manipulation qu’Adorno nous met en garde. Toutes les techniques qui visent à mettre la vérité au service de la non-vérité sont d’une « immense efficacité » (p. 50), poursuit-il. On l’a évoqué, le fascisme ne s’appuie jamais sur une théorie réellement constituée, il est toujours sous-entendu parce qu’il ne s’appuie en réalité que sur un pouvoir inconditionnel (« une pratique sans concept », p. 52), et c’est ça qui lui donne sa flexibilité idéologique. « Elle est aussi dans l’esprit du temps, cette domination d’une pratique sans concept, et ce n’est pas sans conséquences sur la propagande » (p. 53).
« La propagande est [donc] avant tout une technique de psychologie de masse. Le modèle sur lequel elle se fonde est celui de la personnalité autoritaire, et ce aussi bien aujourd’hui que du temps de Hitler ou dans les mouvements du lunatic fringe, en Amérique ou ailleurs » (p. 53). Le formalisme de ce type de pensée, qui s’attache à certains traits formels et des contenus spécifiques isolés suivant la « méthode salami » (c’est-à-dire le morcellement d’un ensemble complexe en petits morceaux) (p. 57), véhicule des « connaissances difficiles à contrôler » et confère « à celui qui les présente un type particulier d’autorité ». Dernière « ficelle » qu’on rencontre sous cette forme « il faut quand même bien avoir une idée » (p. 60) chez des gens « relativement inoffensifs » est le prototype de cet « idéalisme vulgaire » qui ne tire pas sa valeur de la vérité, de son contenu objectif mais plutôt de la raison « pragmatique » qu’en quelque sorte on ne peut pas vivre sans idée et que c’est forcément une bonne chose d’avoir une idée, peu importe son contenu. Adorno nous interpelle, il faut être tout particulièrement vigilant quand on entend cette simple phrase « Il faut tout de même bien avoir une idée ».
In fine, le seul ressort que nous ayons en main selon le penseur de la Théorie critique, c’est montrer les trucages de ces propagandes, « car après tout personne ne veut être un imbécile, personne ne veut se faire couillonner, comme on dit vulgairement. Or on peut tout à fait montrer que l’ensemble repose sur une gigantesque technique de couillonnerie psychologique » (p. 68).
Dans sa postface, l’historien Wolker Weiss souligne comment Adorno a su voir et montrer la durée de certains champs de conflit. L’« effet du spectre d’un spectre », le ressentiment, et les Wutbürger (les « citoyens en colère ») sont encore d’actualité. L’institut de Francfort (l’IfS) a continué ses recherches des liens entre psychologie, dévalorisation de l’autre, peur et légitimation du ressentiment. L’IfS s’est attaché à comprendre les rouages du racisme, de l’antisémitisme, du sexisme et les liens qu’ils entretiennent entre eux et avec l’État-nation et le capitalisme (p. 83). La pertinence de l’articulation entre économie, société et structure du sujet (p. 88), où la Théorie critique développe ses spécificités reste encore aujourd’hui une approche des plus fécondes.
Les éléments de réflexion proposés par Adorno (même « à bâtons rompus ») sont précieux si l’on s’astreint à prendre en considérations les changements sociaux de fond caractéristiques de notre temps. Ainsi, la nature du « sémio-capitalisme » (selon l’expression du penseur matérialiste F. Berrardi), la contradiction entre le mondialisme des « méga corporations » (nouveaux blocs du pouvoir) et les soubresauts régionalistes, et la structure du sujet oscillant entre appartenance communautariste et narcissisme exacerbé semblent en constituer quelques traits majeurs.
Le libéralisme classique qui s’est poursuivi au sein d’une nouvelle « économie de l’attention » d’obédience libertarienne et marquée par un certain utilitarisme hédoniste à la Bentham, puise sa puissance (et son fonds de commerce) dans l’Infosphère (L. Floridi) et ses rouages techniciens. La « société transparente » (G. Vattimo) à « L’âge du capitalisme de surveillance » (Shosonna Zuboff) qui contraint chacun de nous à vendre ses données « personnelles » dans le grand commerce des signes, non seulement libère l’information qui au lieu de nous éclairer tend à rendre le monde toujours plus opaque mais contribue aussi à l’éclatement des conceptions de la Vérité, de l’Histoire et de la Réalité. Une forme de socialité qui fait de nous les objets du spectacle (G. Debord 1967) et même d’une « réalité intégrale » (J. Baudrillard) nous maintenant dans une sorte de « panoptique digital » (B-Ch. Han 2017). Baudrillard est l’un de ceux qui a su prendre en compte la continuité des remarques ici présentées par Adorno, à savoir que le contenu de la conviction et des idéologies importe peu, la revendication des singularismes, des radicalismes (politiques, écologistes ou religieux) et des essentialismes – qui sont les marques les plus virulentes de notre temps – tout comme le terrorisme par nature, ne tirent leur puissance qu’en tant qu’acte, qu’en tant que fracture brutale à l’hégémonie.
Le sémio-capitalisme a redéfini les conditions d’existence matérielles et idéelles des sujets et des processus-mêmes de subjectivation. La dé-corporéisation du langage, la virtualisation et la dé-physicalisation de la socialité sont pour Berardi des mutations profondes qui se manifestent à la fois en tant que désensibilisation et hypersensibilisation : « Le corps de l’autre se fait abstrait et pornographique. L’accélération et l’intensification de l’info-stimulation, qui est aussi une psycho-stimulation, produit un effet de panique ou de déprime. On n’a plus le temps d’élaborer les stimulations ni au niveau de la conscience ni au niveau de l’émotion »[1].
Dans ce contexte où la précarisation des « classes moyennes » continue de progresser, on retrouve les mêmes exclamations que celles qu’avait entendues Adorno. Les pays changent, les passions persistent et le sentiment est devenu pour ainsi dire transnational : « Make America Great Again ! » (D. Trump) et toutes ses déclinaisons, « Get Brexit done ! » (B. Johnson), « Prima Gli Italia » (M. Salvini), etc. Les populismes de tout bord se revendiquant du « peuple », – de J-L. Mélanchon (« La force du peuple ») à Marine Le Pen (« Au nom du peuple ») – conquièrent ce qui reste de l’arène politique.
L’anticipation de l’effroi, force est de le constater, continue de gangréner les consciences de masse. Les divers types d’effondrisme d’aujourd’hui – qu’il en aille de la fin de la civilisation chrétienne ou de la fin de la civilisation tout court – annoncent chacun selon leur dogme la grande catastrophe sociale, écologique, économique, sanitaire, etc. Un climat social anxiogène qui favorise les ressentiments divers classiques (racisme, sexisme, antisémitisme et plus généralement xénophobie) mais aussi de nouvelles craintes (par exemple la solastalgie[2]) au profit de nouveaux prophètes et entrepreneurs de morale offrant là encore leurs services « à la carte » (J-L. Schlegel). Il n’y a plus qu’à se servir : chacun peut trouver cette idée qui lui manque, « parce qu’il faut bien avoir une idée », rappelez-vous.
La « résilience » s’invite comme maître-mot de notre salvation future, sans origines ni perspectives, cette notion « despotique […] contribue à la falsification du monde en se nourrissant d’une ignorance organisée » (Th. Ribaut). Prétendant faire de la perte de nos existences actuelles une voie vers de nouvelles vies motivées par la catastrophe omnipotente, elle repose sur un principe de « gouvernement par la peur de la peur »[3].
Justice warriors, Gilets jaunes, collapsologues et tous les nouveaux Wutbürger puisent à la même source d’une catastrophe qui s’amorce déjà. Certains la désirent, là encore. Rappelant les mots du philosophe Henri-Pierre Jeudy, Bertrand Vidal souligne ce « désir de catastrophe » au cœur de subcultures spécifiques qui sont en même temps des « cultures de consommation » (survivalistes, preppers[4]) mais plus globalement bien établi dans les univers de fiction et de divertissement (depuis les films-catastrophes jusqu’aux séries et jeux vidéo « post-apo » en passant par les émissions de télé-réalité de survie).
La crainte d’être sur la mauvaise pente se conjugue à la force des techniques d’information, de communication et du divertissement, à la puissance des réseaux et de leur viralité. La propagande contemporaine mobilise de nouvelles « ficelles », de nouveaux « trucs » : Fake news, contre-vérités, fausses-vérités, hoax auxquels on tente de répondre par autant de debunking aussitôt « débunkés ». Dans le commerce continu des petites phrases, des commentaires et des images qui s’affichent, sont « signalés », supprimés puis « repostés », l’antisémitisme et l’anti-intellectualisme assumés font peau neuve. Prétextant le spectacle et la liberté d’expression, se revendiquant d’un esprit faussement subversif, certains chantent, dansent, tapent des mains au pas cadencé d’un « Shoah Ananas »[5], jeu de mots à la hauteur du cynisme le plus crasse de leur leader spirituel. C’est aussi dans l’entrelacs de ces réseaux que tout un chacun se fait l’expert, tantôt du politique, de virologie ou de n’importe quoi, et que le refus de l’argumentation se fait le plus saillant.
On retrouve alors la « technique salami » nourrissant les processus de désinformation à grande échelle et qui contente par petites gouttes l’orgueil des individus qui ont maille à partir de cette « frustration relative » (Tocqueville) toujours plus virulente. Adorno avait su voir la combinaison malheureuse entre « l’extraordinaire perfection des moyens et l’absurdité totale des fins » (Weiss, p. 104), la conjonction de moyens rationnels et de fins irrationnelles semblant marquer une tendance globale de la civilisation. In fine, ce constat est encore le nôtre.
Pour ce qui est des conclusions et des techniques de désamorçage professées par le théoricien critique, elles semblent se heurter au fait que le faux ne se distingue plus désormais du vrai, que le « malin génie de l’image » (Baudrillard) et du social nous maintient dans le simulacre et la simulation où les « experts vulgaires » sont devenus les démiurges d’un monde post-idéologique.
[1] BERARDI F. « Bifo », « Tueries. Entretien avec Jean-Philippe Cazier », Chimères, 2016/1, n° 88, pp. 51-53, en ligne.
[2] La solastalgie, notion définie par Glenn Albrecht en 2007 dans son article « "Solastalgia". A New Concept in Health and Identity » (en ligne), repose sur les concepts de « solace » et de « désolation » : « Solace isderived from solari and solacium, with meanings connected to the alleviationof distress or to the provision of comfort or consolation in the face ofdistressing events. Desolation has its origins in solus and desolare with meanings connected to abandonment and loneliness ». En somme elle exprime un sentiment d’abandon et de solitude face au surgissement d’événements angoissants.
[3] RIBAUT Th., Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs, Paris, L’échappée, 2021.
[4] VIDAL B., Survivalisme. Êtes-vous prêts pour la fin des temps ?, Paris, Arkhê, 2018.
[5] Mis en cause pour « injure publique à caractère antisémite » et « contestation de crime contre l’humanité », le polémiste Dieudonné a été déclaré coupable d’« injure publique » et de « provocation à la haine » et condamné à quatre mois de prison et à une amende de 10 000 euros (source).