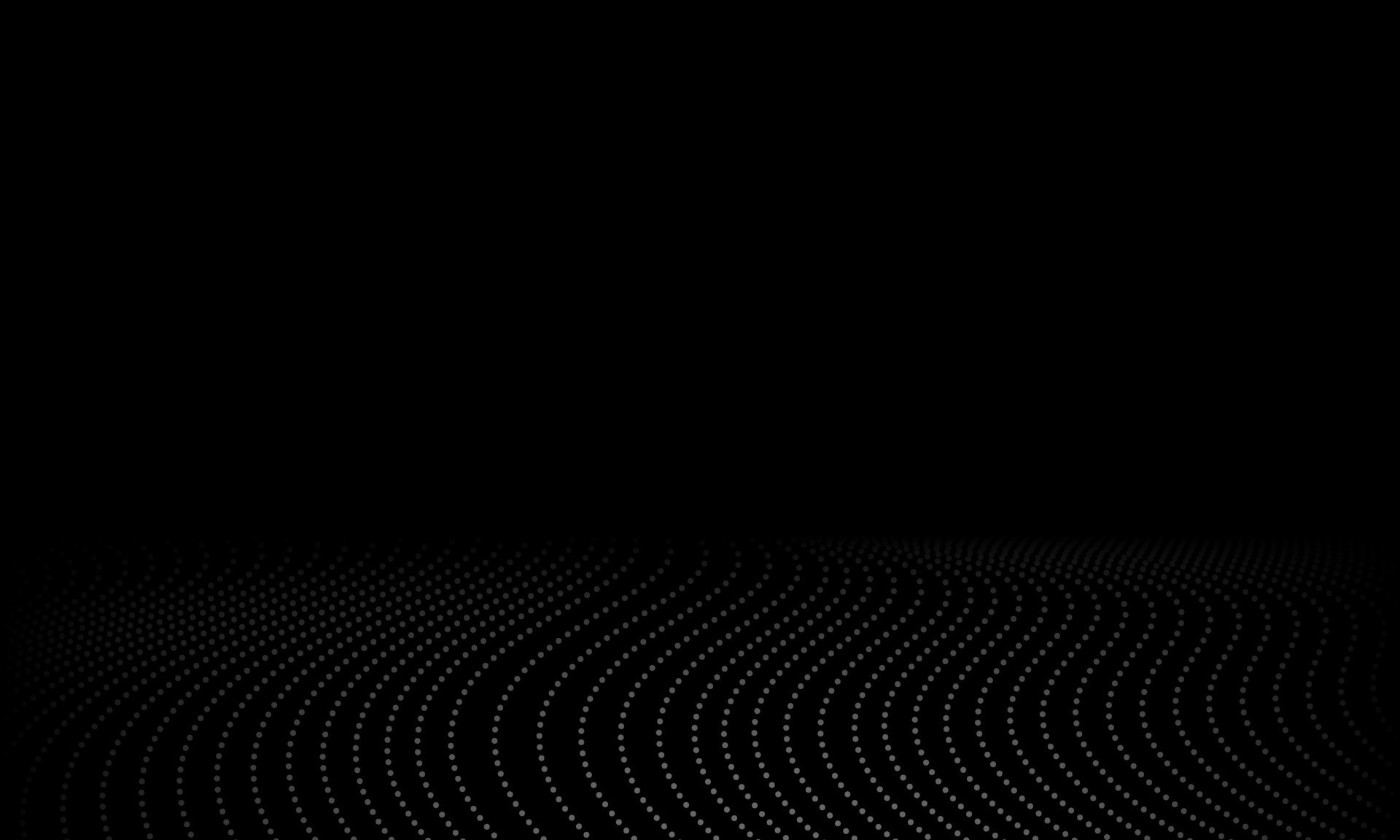Par Alfonso Pinto, Chercheur en géographie, ENS Lyon.
Le concept d’Utopie, ainsi que son contraire, Dystopie, possède une relevance géographique non négligeable. La racine grecque du mot (topos) est déjà un signe éloquent, bien que, selon l’acception du terme proposée par More, cette géographicité ne serait que figurée. Cet aspect ne doit pas pourtant décourager une analyse axée sur l’imaginaire spatiale qui peut se lier, sous formes différentes, à ces concepts. L’espace, bien que philosophiquement figuré, est matière pertinente dans les réflexions sur les Utopies et les Dystopies. En revanche pour ce qui concerne le temps, il faudrait peut-être recourir à l’idée d’Uchronie. Si l’on tient à un parallélisme étymologique, le mot « Utopie », à la lettre, indiquerait un « non-lieu », dans le sens d’un lieu qui n’existe pas. De manière spéculaire, l’Uchronie substitue la dimension spatiale avec celle temporelle. Le résultat est donc un « non-temps », un temps qui n’existe pas. Cependant, la question ne se résout pas si facilement. En 1936, Régis Messac définit l’Uchronie comme une « terre inconnue, située à côté ou en dehors du temps, découverte par le philosophe Charles Renouvier, et où sont reléguées, comme des vieilles lunes, les événements qui auraient pu arriver, mais qui ne sont pas arrivés »[1].
Comme on peut facilement le déduire, la notion géographique (terre inconnue) ne disparaît pas. Elle change de référent figuratif. L’Uchronie selon Messac n’est pas un temps, mais au contraire une terre qui contient en son intérieur des temporalités « autres », qui ne se sont pas produites. L’espace, avec une certaine subtilité, devient alors une sorte de métaphore visant à exprimer le temps.
Le but de cette contribution n’est pas celui de retracer historiquement et philosophiquement les concepts d’Utopie, Dystopie et Uchronie. D’autres, plus compétents, ont déjà offert nombreuses réflexions à ce propos[2]. Ici on voudrait offrir un regard sur deux couples de films qui ont contribué à la fabrication du riche imaginaire cinématographique de la ville de Los Angeles. Bien que le point de vue soit géographique, néanmoins il est important de préciser que le vrai intérêt, ici, n’est pas celui de s’interroger sur les singularités du lieux physique, mais plutôt de mettre en place une réflexion géo-culturelle sur le rôle symbolique et idéel que l’imaginaire los-angelin joue. Les films en question, divisés en deux couples complémentaires, sont Heat (1995) et Collateral (2008) de Michael Mann, et les deux premiers chapitres de la saga des Terminators (Terminator, 1984 et Terminator 2 : The judgement day, 1991), de James Cameron. La complémentarité de ces deux couples réside dans le rôle joué par l’espace et par le temps. En effet, si les films de Mann semblent suggérer une expérience urbaine axée sur la spatialité, en revanche ceux de Cameron peuvent être considérés comme une puissante réflexion temporelle qui mêle présent, passé et futur. L’imaginaire qui en résulte, comme on le verra, se nourrit à plusieurs reprises des idées d’Utopie, Dystopie et Uchronie. Mann produit un espace paradoxal, dans lequel les personnages sont constamment côtoyés par des ailleurs qui ne dépassent jamais le statut de rêve utopique. Le résultat est une dialectique constante entre un ici et un ailleurs. Cette ville, qui devait représenter l’apogée de l’idéal urbain américain, devient, aux yeux de Mann, une spatialité profondément dystopique.
Cameron, selon les codes de la science-fiction, transpose ces réflexions sur un plan temporel. Dans les Terminators Los Angeles est cette terre inconnue qui contient tout ce qui peut arriver. Les films basculent en effet entre un pessimisme radical (l’holocauste nucléaire) et la quête d’un avenir, enfin ouvert à toutes les possibilités. Comment définir donc cet imaginaire ? Comment se met en place donc cette tension entre Utopie, Dystopie et Uchronie ?
L’ « ici » et l’ « ailleurs »… Los Angeles et Mann
Il suffit de jeter un œil aux nombreux spécialistes de l’urbain pour comprendre comment la ville de Los Angeles, dans son histoire urbaine et dans sa géo-morphologie, incarne une sorte de contradiction entre les intentions qui ont animé sa naissance et ce qu’elle est devenue au cours du XXe siècle[3]. Dans ses prémisses la métropole californienne devait constituer « le modèle le plus épuré de la conception du cadre de vie américain »[4]. Absence de concentration, faible densité, valorisation de la sphère privée et facilité pour les transports individuels. En lisant des auteurs comme Giandomenico Amendola[5] ou encore Mike Davis[6], il est très facile de constater comme aujourd’hui ce cadre a subi un effet pervers. La faible densité, qui devait assurer un rapport de proximité avec le milieu naturel, a donné lieu à un espace sans limites, sans centres, un espace qui est souvent assimilé à une galaxie ou à une immense région. D’un point de vue cinématographique le résultat est pour certains aspects, paradoxal. L’horizontalité semble déborder le cadre, et la morphologie los-angeline fatigue à trouver une identité visuelle efficace et exhaustive. Pourtant, ce paradoxe fait de Los Angeles un espace cinématographique doué d’un charme qui trouve dans le genre « noir » sa pleine réalisation.
Comme le rappellent Erwan Higuinen et Olivier Joyard, « si, dans l’imaginaire collectif, New York est la ville de la comédie romantique, c’est à un autre genre majeur du cinéma américain que l’histoire a associé Los Angeles. […] Le cinéma a créé ou révélé une autre ville, sombre, tortueuse, perturbée et terriblement érotique »[7]. Il suffit de citer quelques classiques du genre comme The big sleep de Howard Hawks (1947), Chinatown de Roman Polanski (1974), ou les plus récents L.A. Confidential de Curtis Hanson (1997), Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994), Mulholland drive de David Lynch (2001), sans oublier, bien évidemment les deux films de Mann dont on est en train de s’occuper.
Dans Heat, mais surtout dans Collateral, cet univers de routes et autoroutes, de lumières au néon, de faubourgs sans fin, ne se limite pas au rôle de simple décor, mais devient personnage à plein titre, ou même deus ex machina. Le tissu géométrique, les formes froides, l’anonymat des espaces, sont tous des éléments déterminants tant dans la caractérisation des personnages que dans le développement de l’action. « La puissance conceptuelle du cinéma de Mann, sa tendance à l’abstraction, réside dans les manières à travers lesquelles ses films parviennent à convertir ce qu’ils racontent en paradigmes spatiaux ou géométriques »[8]. Dans les deux films, la géométrie matérielle de l’espace concret coïncide toujours avec un ailleurs tant spatial que temporel. Dans le premier, Neil McCauley (Robert de Niro) est un braqueur de haut niveau. Il s’agit d’un personnage froid, lucide, calculateur et obsédé par son occupation, « I am alone, but I don’t feel lonely » dira-t-il. Sa maison est un cauchemar d’architecture postmoderniste dans laquelle miroirs et vitres substituent les murs. Pas de meubles, pas d’objets personnels ou de photographies… rien qui ne puisse laisser entrevoir une identité, un passé.
Une séquence assez intéressante est celle qui nous présente la rencontre entre Neil et la jeune Eady. Cette fille déclenchera en Neil le désir de quitter cette vie et cette ville pour un futur différent, avec elle, en Nouvelle-Zélande.
Les deux se trouvent sur une terrasse qui domine l’infini skyline los-angelin, (peut-être la seule image qui peut assumer le rôle d’icône de cette ville). À ce propos Jean-Baptiste Thoret affirme qu’ici « Michael Mann souligne en même temps l’artificialité du plan, et donc des désirs qui s’y expriment, puisque le couple semble plaqué sur un fond auquel il n’appartient visiblement pas. Plutôt que de relier par la profondeur de champ les personnages à l’arrière-plan urbain et de ratifier optiquement l’actualisation possible de leur désir, Mann traite Los Angeles comme une surface de projection, inaccessible et inconsistante, qui dit l’absence de perspective de leur relation, au sens propre (un écran bleu sur lequel est projeté le skyline de L.A.) comme au sens figuré »[9]. En fait, à la fin, on sait que Neil, obsédé par son aberrante « éthique du travail » abandonnera Eady à la vue de son rival.
Le rôle de l’espace trouve son apogée dans Collateral. Higuinen et Joyard définissent le film de Mann comme une « stridente promenade jazz » [10]. Selon les deux critiques la vraie clé de lecture de l’œuvre réside dans la mise en scène de Los Angeles, et de sa singulière morphologie. Collateral est un film qui rythmé constamment par les mouvements du taxi, par son parcours fait d’échangeurs, avenues, autoroutes et lumières.
Dans le profond éclectisme qui caractérise la nuit los-angeline, le taxi semble conférer une ultérieure profondeur à la dialectique entre Utopie et Dystopie qui s’exprime dans le rapport entre la condition actuelle de Max (taximan « temporaire » depuis douze ans!) et son projet d’un ailleurs spatio-temporel (son rêve de mettre en place une compagnie de Limousine, mais aussi la petite carte postale caribéenne qui incarne son désir d’évasion). De l’autre côté le personnage de Vincent, le tueur, est pour certains aspects semblable à celui de Neil de Heat. Les deux incarnent, dans le gris de leurs costumes, et dans la froide lucidité de leurs comportements, l’anonymat de la métropole, son apparente absence d’identité. Les deux, en effet se révèlent incapables de briser les trajectoires imposés par leur rôle (le tueur et le braqueur). L’impression est que leur existence n’ait du sens qu’en fonction de leurs rôles respectifs.
De ce point de vue, Max, le conducteur du Taxi, semblerait au contraire incarner une sorte de maître de la route. Il semble gérer parfaitement la fascinante morphologie los-angeline, il connaît les temps et les meilleurs chemins. Toutefois son contrôle sur l’espace est purement illusoire, puisque, en réalité, il ne peut jamais choisir la destination de son voyage. Le fait qu’il se soit trouvé, malgré lui, impliqué dans cette via crucis meurtrière, ce n’est rien d’autre qu’une exaspération de sa condition habituelle.
Sa fuite vers les Caraïbes, son futur à la direction d’une entreprise satisfaisante, apparaissent longuement sous la forme d’une Utopie stricto sensu. De manière tant figurée que littérale, son espace de projection se situe bien au-delà de ses possibilités d’action (le projet velléitaire et la fuite). Son présent/ici se résout dans une pérégrination imposée par une volonté qui n’est jamais la sienne. Dans ce sens Los Angeles, derrière le charme de ses lumières, de son rythme éclectique, se révèle être un espace paradoxal, géométriquement sans fin et dans lequel toute tentation de fuite, en restant perpétuellement en dehors du cadre, retombe dans une actualité dystopique.
Bien que la forte relevance géographique de ces deux films mériteraient un traitement plus approfondi, on peut néanmoins affirmer que les rapports entre les personnages et leur décor incarnent une expérience spatio-temporelle qui se manifeste dans une perpétuelle tension entre la dystonie de l’« ici » et du « maintenant » et l’utopie de l’« ailleurs » et du « demain », qui en tant que telle, se voit reléguée en dehors du cadre diégétique de l’action.
Les Terminators. L'uchronie retrouvée
La structure temporelle des deux films de Cameron est sans doute un des éléments qui contribuent à l’efficacité du récit. En particulier, il est utile de rappeler les différents décalages entre passé, présent et futur qui caractérisent l’univers diégétique du récit. La plupart des événements racontés se déroulent en 1984, pour le premier chapitre, et en 1991 pour le deuxième, c’est-à-dire dans univers temporellement contemporain à celui du spectateur à la sortie du film. En revanche, dans la diégèse, ce temps n’est pas le présent, mais le passé. Le vrai présent diégétique se trouve bien après l’année 1997, (l’année dans lequel l’ordinateur Skynet déclenche l’holocauste nucléaire afin d’anéantir l’humanité). Le présent est donc constitué par un univers post-apocalyptique, sombre, angoissant, où les hommes peinent à survivre parmi les ruines et les décombres de celle qui fut, autrefois, la ville de Los Angeles. L’effet est sans doute remarquable, notamment dans le premier chapitre de la saga. La ville californienne, représentée en 1984, est un univers décadent, laid, que le spectateur sait déjà être destiné à la destruction. Aucun espoir, aucune possibilité d’éviter le cauchemar nucléaire ne semble exister. D’ailleurs tout le premier film, avec un ton biblique, tourne autour de la survie de Sarah, future mère de John Connor, qui guidera la résistance contre les machines. La lutte entre le soldat Reese (qui doit protéger Sarah) et le Terminator ne peut en aucune manière remettre en discussion la catastrophe de 1997. Tout ce que les protagonistes peuvent faire c’est assurer la naissance de celui qui guidera les hommes vers une possible revanche. L’holocauste, quant à lui, apparaît comme inévitable. D’une certaine manière, le futur semble jouir de la même inéluctabilité qui caractérise les temps passés. L’ambiance est donc caractérisée par un pessimisme radical qui, comme nous le rappelle Pierre-André Taguieff[11], dériverait de l’union entre la révolte absolue et totale contre l’actualité, et l’inéluctabilité de cette dernière. Selon cette perspective la « maladie est inhérente à l’existence humaine même »[12].
Le final est éloquent. Reese est mort, le Terminator a été définitivement anéanti. Sarah, enceinte de John, voyage à bord d’une jeep. Dans une station d’essence, probablement au Mexique, un vieil homme lui annonce l’arrivée d’un orage. « I know » répond Sarah. Le film s’achevé avec l’image emblématique de la voiture qui s’éloigne le long d’une route parfaitement droite. En perspective sur le fond, on voit des montagnes et en haut, un groupe de nuages noirs et menaçants qui s’approchent de la route. La métaphore est suffisamment claire. Sarah avance vers un futur noir, vers une apocalypse à laquelle on devra survivre. La route droite ne permet aucune déviation, aucune possibilité d’éviter l’orage.
De ce point de vue, il n’y a aucune « terre inconnue ». La survie ou la mort de Sarah, appartenant au passé diégétique, constituent donc une sorte d’Uchronie « en train de se faire ». Seulement le décalage temporel permet au spectateur d’assumer le recul nécessaire à rendre le passé partiellement ouvert et à pouvoir contenir deux différentes possibilités : celle de l’anéantissement total ou celle d’une possible revanche symbolisée par le nouveau messie John Connor. Ce dispositif reste quand même inséré au sein de la grande inéluctabilité du cauchemar nucléaire dont la remise en cause n’est pas contemplée.
C’est dans le deuxième chapitre que les possibilités s’ouvrent et que le dispositif uchronique s’élargit. La structure temporelle est identique, mais cette fois l’enjeu initial est la survie du jeune John Connor. Cependant, au fur et à mesure, cet enjeu change, et pour la première fois les personnages se trouvent face à une possibilité inédite : le grand holocauste nucléaire peut être évité. Il s’agit d’une perspective, d’un certain point de vue, plus progressiste, du moins par rapport au pessimisme radical du chapitre précèdent. Ici la critique du progrès s’alterne avec une véritable quête de futur. L’impression est que dans ce film l’être humain puisse encore retrouver son rôle perdu d’homo faber, de celui qui peut encore déterminer son destin. Suivant le décalage entre les temporalités de la diégèse et l’extra-diégèse, le spectateur se trouve face à un dispositif de translation uchronique. Les différentes temporalités susceptibles d’exister se concrétisent dans le récit : l’anéantissement total de l’humanité (la mort de John Connor encore jeune), la survie et la renaissance de l’homme sous le guide de ce messie post-apocalyptique, mais surtout la possibilité que tout cela n’arrive pas du tout. À ce propos il est intéressant de noter comment, encore une fois, revient la métaphore de la route. Mais ici, par rapport au premier chapitre, l’image est très différente. La route est cadrée de très près, dans un noir total qui empêche la vue de toute autre chose. Pas de perspective, pas de destination, mais seulement un mouvement dans le noir. À souligner cet aspect c’est la voix off de Sarah : « The future, always so clear to me, has become like a black highway at night. We were in uncharted territory now… making up history as we went along ». Au final, non seulement les protagonistes empêcheront le meurtre du jeune John Connor, mais surtout, ils mettront en discussion le développement du super-ordinateur Skynet et donc sa révolté génocidaire. Il ne s’agit donc pas de retrouver un futur positif et idéal, mais tout simplement de reconstituer une temporalité brisée en reconstituant le caractère indéterminé du temps futur, qui après une perspective radicalement pessimiste, revient à son incertitude.
Le futur retourne donc ouvert, et toutes les différentes temporalités se redéploient dans le domaine du possible.
La complexe structure narrative des Terminators, ainsi que les évidentes liaisons avec le dispositif uchronique, ne relèvent pas en revanche d’un questionnement esthétique. Comme nous le rappelle Raymond Perrez, « au-delà d’un simple reflet, les films sont aussi des avertissement et participent à un débat philosophique et idéologique sur les fondements de la société et l’avenir de l’humanité »[13]. D’ailleurs nombreux sont les thèmes que Cameron exploite : le rapport au progrès et à la technologie, la capacité de l’homme d’intervenir sur son propre destin, le rôle des machines... Travailler sur l’aspect uchronique de la narration ne doit pas donc être considéré comme une démarche indépendante, mais au contraire doit s’insérer au sein d’une réflexion plus large sur l’expérience temporelle de la modernité et de ses modifications. De manière spéculaire, les films de Michael Mann, selon des codes esthétiques et des univers narratifs différents, proposent une réflexion tout autant importante. Los Angeles dans ce cas transcende ses spécificités locales pour devenir un univers idéel dont la morphologie si singulière (notamment pour un observateur européen) se veut comme la métaphore d’une expérience spatiale généralisée, caractérisée par une profonde tension dialectique entre l’« ici » dystopique et l’« ailleurs » utopique.
En conclusion on pourrait définir l’imaginaire que ces quatre films fabriquent comme « catastrophique », mais à condition de considérer la catastrophe dans un sens plus large. Elle ne doit pas se lier à la spécificité d’un événement néfaste, qui soit probable ou non, imminente ou futur. La véritable catastrophe prend la forme d’une expérience de l’espace et du temps caractérisée par le grand déséquilibre qui émerge entre l’idée de « projet utopique », tant dans le sens spatial que temporel (construction d’un lieu capable de contenir un avenir positif), et un contemporain qui apparaît marqué par la Dystopie. Cet imaginaire exprime l’idée d’un monde sans issue, d’un « ailleurs/demain » qui reste loin et souvent hors de portée et un « ici-maintenant » qui se voit souvent privé de toute perspective.
Bibliographie
AMENDOLA G., La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Milano, Laterza, 1997.
DAVIS M., City of quartz. Excavating the future in Los Angeles, Verso, 1990.
GHORRA-GOBIN C., Los Angeles. Le mythe américain inachevé, Paris, CNRS Éditions, 1997.
HIGUINEN E., JOYARD O., « Los Angeles », in La ville au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2005.
JOUSSE T., PAQUOT T., (dir.), La ville au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2005.
MESSAC R., « Voyage en Uchronie. Propos d’un utopien », in Les Primaires, no 83, novembre 1936.
PAQUOT T., Utopies et Utopistes, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2007.
PERREZ R., « Futurs imparfaits : Visions du troisième millénaire dans le cinéma de science-fiction contemporain », in Anglophonia. French journal of english studies, n° 3, 1999.
RENOUVIER C., L’Uchronie (L’Utopie dans l’Histoire), Paris, Bureau de la critique philosophique, 1876.
RICOEUR P., L’idéologie et l’Utopie, Paris, Seuil, 1997.
SERVIER J., Histoire de l’Utopie, Paris, Folio, coll. Essais, 1997.
TAGUIEFF P.-A., Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Paris, Flammarion, 2004.
THORET J.-B., « Michael Mann », in La ville au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2005.
[1] MESSAC R., « Voyage en Uchronie. Propos d’un utopien », in Les Primaires no 83, novembre 1936, p. 542.
[2] Cf. PAQUOT T., Utopies et Utopistes, Paris, La Découverte, 2007 ; RICOEUR P., L’idéologie et l’Utopie, Paris, Seuil, 1997 ; SERVIER J., Histoire de l’Utopie, Paris, Folio, coll. Essais, 1997 ; RENOUVIER C., L’Uchronie (L’Utopie dans l’Histoire), Paris, Bureau de la critique philosophique, 1876.
[3] GHORRA-GOBIN C., Los Angeles, Le mythe américain inachevé, Paris, CNRS Éditions, 1997.
[4] Idem, p. 7.
[5] AMENDOLA G., La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Milano, Laterza, 1997.
[6] DAVIS M., City of Quartz. Excavating the future in Los Angeles, Verso, 1990.
[7] HIGUINEN E., JOYARD O., « Los Angeles », in La ville au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, p. 452.
[8] THORET J.-B., « Michael Mann », in La ville au cinéma, Op. Cit., p. 756.
[9] Idem, p. 752.
[10] HIGUINEN E., JOYARD O., « Los Angeles », in La ville au cinéma, Op. Cit., p. 457.
[11] TAGUIEFF P.-A., Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Paris, Flammarion 2004.
[12] Idem, p. 260.
[13] PERREZ R., « Futurs imparfaits: Visions du troisième millénaire dans le cinéma de science-fiction contemporain », in Anglophonia. French journal of english studies, n° 3, 1999, p. 217.