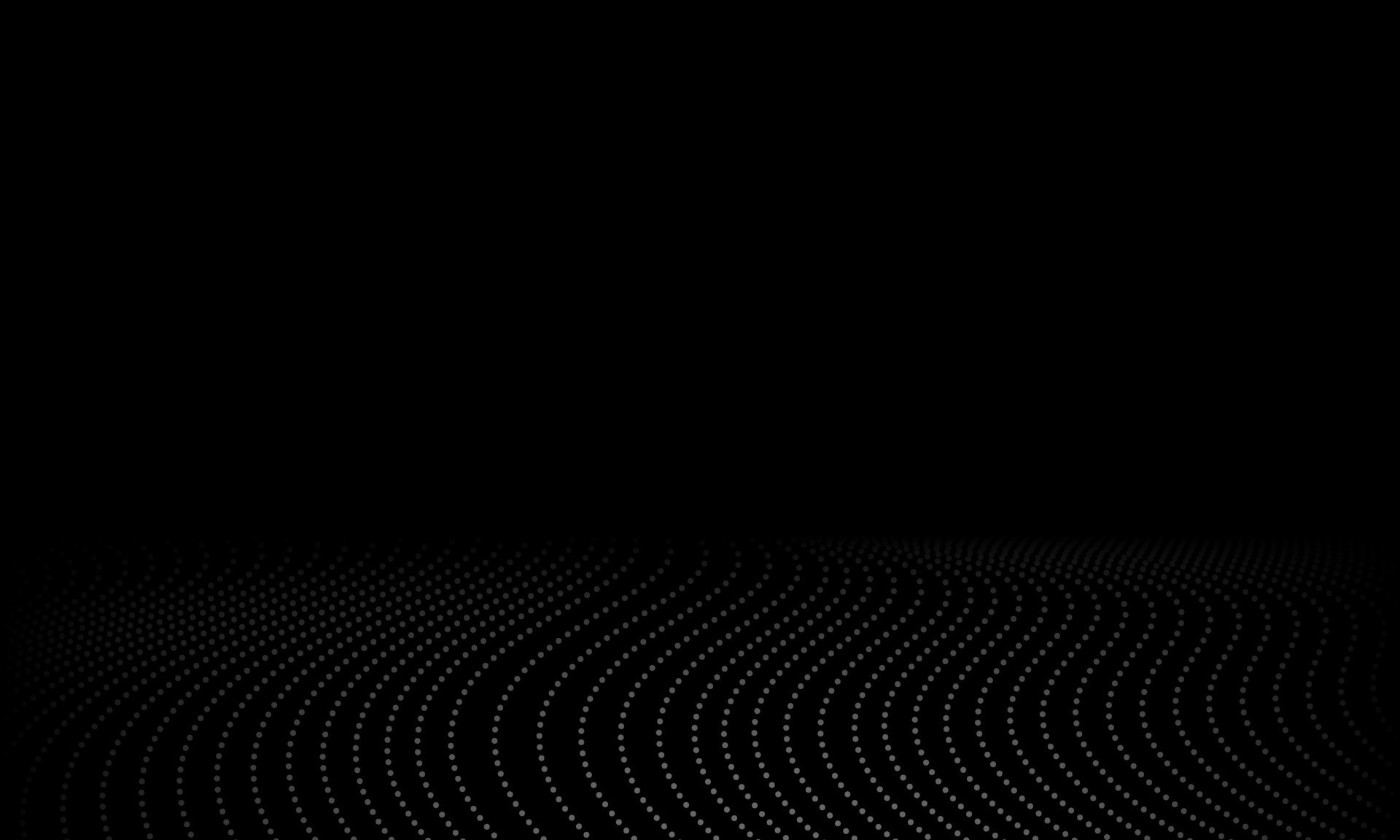Parler aujourd’hui de la présence des affects de haine dans les productions culturelles « populaires » transmedia, majoritairement à destination des adolescents, nous expose à plusieurs écueils. C’est pourtant ce que nous allons tenter de faire, en proposant une lecture, certes loin d’être exhaustive, et qui se veut éloignée de tout jugement de valeur. Aussi, nous ne postulerons pas que ces mangas, sagas, séries ou jeux vidéo seraient nocifs ou toxiques, encore moins qu’ils inciteraient les jeunes à la haine, pas plus qu’à la violence. Notre lecture, inspirée de la sociologie clinique[1], part d’entretiens avec des adolescents : ce qui importe, c’est la façon dont ils-elles parlent de ces œuvres, plus que les œuvres elles-mêmes. En revanche, il est vrai que beaucoup parmi celles-ci mettent en scène une violence démesurée, accompagnée ou non d’affects de haine. D’où la question : s’agit-il de haine, et de quelle haine s’agit-il ? Pour le savoir, il faut non seulement regarder les œuvres, mais écouter ce que les publics ont à en dire. Une oreille exercée pourrait être à même d’aller au-delà des propos de surface pour se demander ce qu’il en est des formes de haine les moins visibles, les moins explicites, les plus secrètes : celles qu’on tait parce qu’elles concernent une haine envers soi-même.
OBSTACLES ET MÉTHODES
D’abord, premier écueil, on se heurte à l’ampleur du corpus : si l’on s’intéresse à un support précis, par exemple les mangas, on a déjà affaire à une quantité considérable d’œuvres, dont la variété et la disparité (parler « des mangas » c’est comme parler « du livre » en général) rend impossible toute conclusion d’ordre général. Aucun travail sérieux ne s’aventurera à extrapoler au-delà de quelques corpus bien délimités : on trouve d’ailleurs fort peu, en France du moins, d’études globales du genre « manga » en soi. Il en va de même avec les jeux vidéo. Si l’on veut avoir une approche généraliste, on est condamné à un impressionnisme subjectif et forcément extrêmement partiel, sauf à se concentrer sur les œuvres plébiscitées par le public adolescent. C’est l’approche que nous avons choisie : sans préjuger au départ d’un corpus, nous avons interrogé les jeunes rencontré-e-s à propos des œuvres, quel que soit le support, qu’ils ou elles préféraient. L’échantillon concerne 61 garçons et filles de 17 ans en moyenne (certain-e-s étant plus âgé-e-s), pour la plupart élèves de lycée, issu-e-s de catégories sociales majoritairement modestes ou « moyennes » (enfants d’employés, d’ouvriers, d’artisans, certains chômeur-se-s, des professions intermédiaires, quelques enfants de petits patrons de PME) interrogé-e-s le plus souvent par téléphone, pendant des entretiens d’une trentaine de minutes au minimum. De fait, leurs réponses concernent davantage les animes, mangas, séries ou sagas, que les jeux vidéo, qu’ils-elles pratiquent pour la plupart mais sur lesquels ils-elles semblent moins enclin-e-s à se confier, nous y reviendrons.
On obtient ainsi un ensemble d’œuvres qui en aucun cas ne saurait représenter une « culture commune » : aucun titre ne touche tout le monde, contrairement sans doute à la génération précédente qui avait affaire à une offre culturelle bien plus réduite. A part peut-être, au moment de mon enquête, La Casa de Papel, on ne dépasse pas, avec Harry Potter, Naruto, Dragon Ball, One Piece ou Twilight, 75 % du public mais cette proportion est en général très inférieure. Beaucoup connaissent You (Bermanti, Gamble, 2018-en cours, The 100 (Rothenberg, 2014-2020), The Walking Dead (Darabont, Kirkman, 2010-en cours), Lucifer (Kapinos, 2016-en cours) ou Game of Thrones), Breaking Bad (Gilligan, 2008-2013), Prison Break (Scheuring, 2005-2009), déjà ancien; ainsi que, pour les films, Joker, les Avengers et les Marvel, les Harry Potter (Columbus, Cuaron, Newell, Yates, 2001-2011), les Twilight (Hardwicke, Weitz, Slade, Condon, 2008-2012), Hunger Games (Ross, Lawrence, 2012-2015), La Ligne Verte (Darabont, 1999), Percy Jackson ; quant aux mangas et animes, on a une dizaine de titres très « populaires » (One Piece, Naruto, Dragon Ball et ses suites, One-Punch Man (One, 2016-en cours), The Promised Neverland (Shirai, Demizu, 2018-2020), Fairy Tail (Mashima, 2008-2018), Hunter X Hunter (Togashi, 1998-en cours), Bleach (Kubo, 2003-2017), Inu-Yasha (Takahashi, 2002-2014), l’Attaque des Titans (Isayama, 2013-2021), My Hero Academia (Horikoshi, 2016-en cours)), ainsi que les Disney, pour les filles, (aucun garçon ne les mentionne). En ce qui concerne les jeux vidéo, on retrouve aussi les « univers » mentionnés plus haut, ainsi que Call of Duty, Dofus, GTA, FIFA, Battle Royale, Fortnite, Assassin’s Creed, et des jeux de survie, ainsi que Pokemon et Mario qui restent des valeurs sûres.
Seconde difficulté : on se heurte bien entendu, dans ce type d’investigations, aux limites du déclaratif. Comment faire la part entre les propos des personnes interrogé-e-s et les affects réels qui les animent ? Ainsi, s’agissant de la haine, il semble évident que peu de sujets seront enclin-e-s à avouer ouvertement qu’ils-elles pourraient être influencé-e-s dans un sens violent ou haineux par les productions culturelles qu’ils-elles fréquentent. Ce qui est mesuré dans les études existantes, c’est non la haine, mais l’agressivité. Rappelons comment procèdent la plupart des enquêtes expérimentales portant sur les effets des jeux vidéo (les enquêtes concernant les mangas sont beaucoup plus rares) sur l’agressivité : on propose aux participant-e-s une situation de conflit ou de provocation dans la vie quotidienne, et on leur pose des questions sur le comportement qu’ils-elles adopteraient[2]. La reconstitution expérimentale d’un comportement probable à partir d’une situation évoquée nous semble cependant insuffisante et possiblement biaisée ; les échelles de mesure des réactions émotionnelles (en 5 points allant de « pas du tout » à « extrêmement ») à partir d’un questionnaire étant également soumises à toute sorte de biais. Certains biais, comme le biais de confirmation aux attentes de l’expérimentateur, entre autres, sont mentionnés avec une grande honnêteté par Pahlavan, Drozda-Senkowska, Michelot[3] ; mais le moindre n’est pas la centration « behavioriste » (c’est-à-dire où l’on se contente d’observer des comportements, et où l’espace psychique est considéré comme une « boîte noire » inconnaissable) sur le comportement, qui réduit l’éprouvé interne à ses manifestations, en l’occurrence supposées. Faudrait-il alors, comme le font d’autres études, s’en remettre aux statistiques des actes violents pour juger de l’impact de ces œuvres sur leur public[4] ? Il s’agit d’études corrélationnelles, qui concluent d’ailleurs pour la plupart à une corrélation négative entre exposition aux jeux vidéo violents et augmentation de la criminalité. Une autre démarche consisterait à comparer la consommation de jeux vidéo violents chez une population de sujets mis en examen et chez une population ordinaire[5]. Ce serait confondre violence et haine, et les manifestations avec la cause ; ce serait, de plus, s’en remettre une fois de plus aux seules données observées et/ou déclarées, sans pousser l’analyse plus loin. Le paradoxe est que, dans la période des vingt à trente dernières années, les coups et blessures déclarés sont certes en augmentation, mais si l’on prend l’exemple des homicides, ceux-ci ont nettement régressé, divisés par deux ou plus[6]. Il est donc important de ne pas rabattre les affects et les ressentis sur les faits : ceux-ci ne traduisent qu’imparfaitement l’expérience vécue des sujets, les représentations et les affects. Or ce sont bien les représentations et les affects de haine qui nous occupent ici, et non les actes violents.
Nous avons choisi une approche différente de la sociologie quantitativiste ou expérimentale : celle de la sociologie clinique[7], en lien avec la lecture anthropologique de David Le Breton qui préfère les expériences singulières aux statistiques. Par ailleurs, nous préférons éviter le terme d’« émotions », concept connoté par son ancrage neurobiologique (la haine ne fait d’ailleurs pas partie des émotions dites « de base »). En quoi ces fictions activent les sujets, participent à leur construction de soi ? L’écoute orientée par notre expérience de psychanalyste permet parfois de saisir des non-dits, des éléments inconscients sous-jacents qui affleurent dans l’acte d’énonciation et les affects qui transparaissent. Par ailleurs, conformément à la démarche « ethno-méthodologique », une certaine familiarité avec les sujets, que nous connaissions par ailleurs et avec qui nous avions pu nouer des relations de proximité, a permis d’atténuer les réticences ou auto-censures inévitables dans ce genre d’entretiens. Tou-te-s, sauf à de rares exceptions, nous ont témoigné de la confiance, et aussi une certaine empathie due au contexte particulier au confinement (la majorité des entretiens ont été menés par téléphone pendant la période Covid où chacun-e était chez soi, et ces dialogues représentaient, beaucoup nous l’ont dit, des bouffées d’air).
LA PRÉSENCE DES AFFECTS DE HAINE DANS LES UNIVERS DE FICTION
Dans les œuvres citées par les jeunes que nous avons interrogé-e-s, l’imaginaire violent semble omniprésent. Les mangas et jeux vidéo, notamment dans le genre « shōnen », représentent souvent des explosions émotionnelles, sensibles dans le graphisme, et des combats poussés à l’extrême, contre des monstres surpuissants, dotés de pouvoirs toujours plus démesurés, qui requièrent des épreuves résolument inhumaines, à côté desquelles les douze travaux d’Hercule feraient bien pâle figure. Entre bien d’autres exemples, les combats de Naruto contre des créatures toujours plus puissantes et perverses (Kishimoto, 1999-2014) ou bien ceux de Gon Freecs dans Hunter X Hunter (Togashi, 1998-2023). La récurrence des combats ou, plus généralement, du registre « trash », que l’on peut définir par un excès choquant, de nature violente, dans les représentations est manifeste dans de nombreuses œuvres très « populaires » auprès des adolescent-e-s. Au point que la célèbre phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort » pourrait leur servir d’emblème : cette phrase de Nietzsche, vulgarisée par la culture populaire, est connue de la totalité des adolescent-e-s que nous avons rencontré-e-s, et régulièrement citée par eux, bien que la plupart du temps ils en ignorent l’auteur. Il en va de même pour les jeux vidéo, accusés pour cette raison de favoriser l’expression d’une agressivité désinhibée. A contrario, les fictions reposant uniquement sur des ressorts amoureux seraient en perte de vitesse. Si l’on excepte les lectrices de romance (il n’y a aucun lecteur masculin concerné dans notre échantillon), assez rares, filles comme garçons préfèrent regarder/lire des anime/mangas de type shōnen, ceux que nous avons énumérés plus haut. Le shôjô est totalement absent. Bien entendu, notre échantillon n’a pas vocation à être représentatif de tout public adolescent. Mais cela interroge. Par ailleurs, on peut observer que les intrigues centrées sur la relation amoureuse sont, non absentes, mais placées au second plan, comme dans la plupart des mangas cités, ainsi que dans des sagas comme Harry Potter, les sagas de fantasy les plus connues, et a fortiori dans les jeux vidéo. Bien entendu, Twilight par exemple apparaît comme une exception ; mais la règle semble être plutôt que les combats intéressent globalement davantage que la relation de couple, comme les producteurs de contenus (y compris télévisuels) semblent l’avoir intégré[8]. Thanatos aurait-il triomphé sur Eros[9] ?
Pour beaucoup d’adolescents que nous avons interrogé-e-s, l’agressivité ressentie est une réalité qu’ils verbalisent, et les jeux vidéo, y compris les plus frustes, en offrant un défouloir, permettent une expression désinhibée de ce besoin d’expression des pulsions. Les jeunes en ont tout à fait conscience, et « assument », suivant l’expression consacrée, de se servir de jeux qualifiés de « basiques » ou « bourrins » (sic), tels que les jeux de « survie » pour défouler leur agressivité, sans que cela ait évidemment le moindre rapport, pour elles-eux, avec leur comportement dans la vie réelle.
Joseph, par exemple, est un ancien gamer passionné par les animes d’horreur, tandis que Léo utilise les réseaux sociaux et les mangas pour naviguer entre exaltation et dépression, cherchant à apprivoiser ses pulsions violentes sans montrer le moindre signe d’un comportement violent. Kamel, victime, lui, de violences réelles, trouve refuge dans les jeux de survie et les combats, cherchant à se réparer psychiquement par ces fictions. La dimension cathartique de la fiction (on peut considérer que les jeux vidéo un minimum scénarisés appartiennent à cette catégorie de fictions) est indéniable. Même s’il est difficile de prouver que la pratique des jeux diminue la violence agie, elle ne semble pas en tout cas être un facteur d’augmentation de celle-ci.
Ce qui est intéressant à ce stade, c’est de se demander quel pourrait être le lien entre l’agressivité pulsionnelle dont nous parlons, et les affects de haine. En effet, les jeunes en parlent plutôt comme d’une sorte d’hygiène mentale ou psychique, se « vider la tête », et donc sur le mode d’une sorte de décharge d’une énergie excessive, plutôt que comme affect. Mais les exemples que nous venons de citer montrent que les choses sont plus complexes et qu’il ne s’agit pas seulement d’un mécanisme automatique comme les métabolismes biologiques, ou encore d’un mécanisme « émotionnel » au sens de la théorie bio-psychologique des émotions adaptatives[10]. De fait, Léo, même s’il ne fait pas preuve, semble-t-il, de comportements agressifs, finit par laisser transparaître, dans les divers entretiens que nous avons pu mener avec lui, certaines représentations de type « projectif », c’est-à-dire qui visent certaines catégories de personnes investies d’un fort sentiment négatif. Joseph et Kamel, quant à eux, tiennent plutôt des propos de type auto-dépréciatif, teintés parfois d’une forte composante anxieuse. Ici on touche à l’ambivalence, bien mise en avant par la psychanalyse, des affects haineux. Si l’on suit Freud, on ne peut isoler la haine envers l’autre de sa réciproque, la haine de soi : les pulsions, loin d’être des tendances instinctuelles stéréotypées et constantes dans leur objet, se caractérisent au contraire par leur réversibilité et leur capacité à changer d’objet, en particulier à se retourner sur la personne elle-même[11]. La haine n’est qu’un visage de la haine de soi… et inversement.
DE LA HAINE À LA VULNÉRABILITÉ
À l’extrême, il y a la figure récurrente, dans de très nombreux univers de jeux, du « berserk » ou « berserker », ce guerrier pris de folie meurtrière qui ne ressent plus la douleur et devient incontrôlable. On l’interprète comme manifestation d’une haine fondamentale ; la violence agie est comprise comme la traduction comportementale d’une agressivité qui semble même aller au-delà du désir de vengeance. Cet archétype illustre, pour les détracteurs de la culture « jeune », les excès d’une violence sans limites, qui serait devenue une hyper-violence, et qui entretiendrait des rapports ambigus avec la brutalité sans limites observée dans certains faits divers (par exemple dans les règlements de compte entre trafiquants). Mais si haine il y a, contre qui se dirige-t-elle ? Ici il ne suffit pas d’observer une attitude extérieure sur un mode « behavioriste ». Or il n’est pas indifférent que le mot « berserk », en norvégien, ait pu être interprété comme « sans protection »[12]. Hyper-violent, ou hyper-vulnérable ? Nu et sans protection, non pas face aux ennemis, mais face à ses propres pulsions destructrices. De quelle haine s’agit-il alors ?
Ce que nous entendons le plus, lorsque les ados parlent de leurs fictions favorites, c’est leur intérêt pour la psychologie (« tout ce qui touche à l’esprit ça m’intéresse »), bien au-delà de l’engouement pour la violence et les super-héros que l’on trouvait chez les générations précédentes dans un style bien plus primaire. Il semble que la relation aux fictions soit davantage « secondarisée » (c’est-à-dire plus réflexive, moins naïve), sans doute du fait de l’expertise due à la fréquentation d’un nombre bien plus grand d’œuvres disponibles[13]. Par ailleurs, lorsqu’au cours des entretiens ces jeunes en viennent à se confier sur elles-eux-mêmes, ils-elles évoquent fréquemment leurs angoisses, le manque de confiance en soi-même qu’ils ou elles ressentent. En ce sens, il semble que les fictions populaires peuvent résonner avec des préoccupations typiques du psychisme contemporain telles que les psychanalystes en parlent[14]. Outre le contexte fréquemment apocalyptique[15], les héros sont devenus souvent vulnérables ; outre les anti-héros, on constate dans les productions précitées un intérêt marqué pour les personnages ambivalents, porteurs de fêlures secrètes, de Deku dans My Hero Academia (Horikoshi, 2014-en cours) à Harry Potter (Rowling, 1998) ou encore Walter White dans Breaking Bad, pour choisir trois types de medias différents (manga , livre, série TV), tous très connus et cités par les participant-e-s à notre enquête. Préoccupations narcissiques, liées à une forme de perte de repères psychiques et de failles intimes, où l’agressivité et la lutte pour la survie sont certes présentes, mais plus comme le symptôme d’un désarroi profond que comme celui d’une haine. Comment ne pas mettre en relation la psychologie souvent très sombre de nombreux personnages et celle, également ténébreuse selon plusieurs travaux, de grands adolescent-e-s marqué-e-s par des fragilités, voire des tendances autodestructrices[16] ?
Il est certes délicat d’en conclure à une haine de soi : toutefois, en l’absence d’hypothèses qui fassent l’unanimité sur les origines de cette « nouvelle économie psychique », l’hypothèse psychanalytique est à considérer. Selon Freud[17] et ses continuateurs, la mélancolie (c’est-à-dire la dépression), comme les formes moins sévères de fragilité des assises narcissiques, serait à attribuer à une instance interne, qu’il nomme le Surmoi, capable d’exercer sur le sujet une véritable haine. Celle-ci est souvent attribuée, dans le fantasme, à des personnes ou des entités extérieures : ainsi les persécuteurs du héros-de l’héroïne incarnent-ils, dans de nombreuses fictions, le Surmoi, et ne sont que des projections de l’esprit du héros lui-même. Le sujet se sent écrasé, jugé, condamné : il ne s’aime plus, n’a plus envie de rien. Mais dans certains cas, il fuit ce sentiment d’anéantissement en tentant de détruire l’autre, comme dans les innombrables figures de « pervers narcissiques » ou autres serial killers dont les fictions populaires regorgent. Le personnage du Joker, revisité dans un film (Phillips, 2019) que presque tous les adolescent-e-s connaissent, est à cet égard archétypal : on y comprend l’histoire tragique de ce personnage que les anciennes versions de Batman traitaient comme un simple antagoniste stéréotypé. Si le Joker est devenu criminel, c’est d’abord parce qu’il a souffert et ne supporte plus de vivre. Sa haine est moins dictée par une méchanceté ou même un esprit de vengeance que par une difficulté à exister et des tendances suicidaires. Sans compter une relation fusionnelle avec sa mère, dont il accomplit, à son corps défendant, le désir (« donner le sourire et faire rire les gens dans ce monde sombre et froid »).
TENTER DE VIVRE, MALGRÉ LA HAINE, AVEC LA HAINE
La fiction offre toutefois un espace pour mettre à distance le monde psychique interne, aidant les jeunes sujets à se représenter par le truchement des personnages et, peut-être, à se construire, selon un cheminement initiatique qui ferait écho aux récits eux-mêmes. Ce processus cathartique, par lequel les spectateurs-lecteurs redoublent en quelque sorte, à leur manière et sur un mode certes bien moins violent, les épreuves des héros, n’est ni une identification naïve, ni une miraculeuse libération, et le résultat n’est évidemment jamais gagné d’avance. Il n’est pas question ici d’un lien mécanique entre violence des scénarios et violence agie dans la vie réelle ; mais plutôt d’un écho subtil entre la haine de soi (et d’autrui) que donnent à voir certains personnages, et les formes de haine, toujours un peu troubles, conscientes ou non, qui agitent les spectateurs. Les fictions n’induisent pas davantage de sentiments haineux qu’elles ne les combattent : en fait elles les mettent en scène de façon forcément ambivalente, invitant, au niveau de la réception, à une réappropriation personnelle non moins ambivalente ; et c’est bien pourquoi il est vain de vouloir les rendre responsable, ou les dédouaner entièrement, d’impacts sur les affects de celles et ceux qui en font usage. Les scénarios fictifs permettent de déplacer les combats du réel vers un terrain virtuel, au sens où il suspend le réel tout en en révélant des aspects importants. La violence dans les séries, jeux scénarisés et mangas, bien qu'imaginaire, traduit des haines mais aussi des angoisses inconscientes réelles, contribuant à la construction de soi des adolescent-e-s en offrant un espace de projection et de représentation des pulsions. Ces jeunes s’efforcent de naviguer entre désir de destruction et aspiration à (se) réparer, entre pulsions de vie et pulsions de mort, dans une quête perpétuelle d’équilibre psychique. Le fait que les mangas, sagas ou séries ne se limitent pas à montrer des débordements violents, mais creusent souvent l'intériorité des personnages, faisant appel ouvertement à une dimension psychologique (on peut penser au succès de la série The Sopranos (Chase, 1999-2007), où le personnage principal mafieux va consulter un psy) et à des schèmes initiatiques revendiqués (c’est le genre « nekketsu », qui correspond aux titres phares du shōnen) favorise évidemment le travail de catharsis. C’est bien entendu différent pour les jeux vidéo, où l’on incarne le personnage au lieu de le découvrir ; mais la distinction entre les supports, à l’heure du transmedia, est en réalité devenue floue et très relative.
Les supports de fiction, imbriqués dans la vie des adolescents, jouent un rôle crucial dans leur construction identitaire. Ils externalisent leur monde interne, aidant à se représenter et à se construire. La fiction offre un espace de confrontation avec leurs propres failles, et ainsi à élaborer les affects de haine. Par « élaborer », on entend un travail sur ses pulsions inconscientes afin de les « domestiquer » et de les mettre au service du Moi plutôt que de les subir passivement[18]. La haine est un affect fondamental, présent chez chacun-e, qu’il convient d’apprivoiser, en apprenant progressivement à lui donner une place et un sens dans notre psychisme singulier. Le passage par la fiction n’exonère pas d’avoir à s’y confronter dans la réalité, mais offre une dimension supplémentaire qui entre en résonance avec l’expérience vécue, tissant de subtiles relations entre les multiples personnages auxquels nous avons pu nous identifier, ne serait-ce que partiellement et momentanément, et les divers aspects de notre vie psychique elle-même contrastée et multiple. La fiction occupe le même genre de fonction que le jeu, pièce essentielle de la construction de soi[19]. Fréquenter ce genre d’œuvres, c’est donc jouer, et forcément jouer un peu avec le feu, en l’occurrence avec la haine.
En particulier, les spectateurs-lecteurs sont amenés à faire l’expérience, par le truchement des personnages de fiction, de l’intrication ambivalente de l’amour et de la haine, thème évidemment banal, mais dont il importe, pour chacun-e, singulièrement, de prendre toute la mesure, ce qui n’est jamais facile. Mais aussi de la réversibilité entre haine subie et haine vécue (comme dans l’exemple du Joker précédemment cité), et plus généralement de la complexité des destins des pulsions et des affects, amenés à se transformer et à prendre des formes inattendues. La saga Harry Potter, encore aujourd’hui très populaire auprès des nouvelles générations comme elle l’a été de la précédente, témoigne spectaculairement du chemin qu’il est nécessaire de parcourir : Harry, à l’origine victime d’une haine féroce (dans le monde réel, de la part de sa famille adoptive, et dans le monde de la magie, de la part des Mangemorts), doit éprouver lui-même de la haine (envers Rogue notamment, qui s’avèrera moins mauvais qu’il ne le croyait et particulièrement ambivalent), puis comprendre que l’affection qu’il ressentait de la part de son père spirituel Dumbledore cachait aussi sa part d’ombre. Et, surtout, que la haine de Voldemort allait de pair avec une très grande ressemblance, presque une gémellité : outre la similitude de destin entre les deux orphelins, doués tous deux de pouvoirs magiques exceptionnels, il s’avère qu’une partie de l’âme de Voldemort est logée dans Harry lui-même. Ce n’est qu’après tant d’épreuves que Harry parviendra enfin à grandir, à se libérer de sa haine de soi, que certaines lectures ont pu assimiler à une tendance dépressive[20] et à être lui-même. Les lecteurs-trices également auront à s’approprier leur propre haine et ses manifestations parfois déconcertantes pour réussir à entrer dans le monde des adultes… ou pas.
CONCLUSION
En résumé, la fascination des jeunes pour la violence dans les mangas, les séries, les sagas, les jeux vidéo et l’ensemble des univers transmedia ne se réduit pas à une simple attraction pour le choc visuel ni à un défoulement mécanique. Elle exprime bel et bien les destins d’une haine aux visages multiples et parfois paradoxaux, qui se traduit dans la psychologie souvent tortueuse des personnages des fictions contemporaines, plus complexes et sombres qu’autrefois, et en cela en accord avec la « nouvelle économie psychique » des générations actuelles. Les récits actuels les plus populaires, en laissant de côté les thèmes amoureux ou les intrigues traditionnelles trop lisses, se concentrent sur des quêtes existentielles et la lutte contre des forces destructrices, révélant une fascination pour la haine, inscrite dans une quête de sens et une recherche d’identité. La haine est indissociable d’une haine de soi, parfois inconsciente, qui pourrait en être à l’origine. La fréquentation des fictions s'inscrit dans une quête psychique de maîtrise des pulsions, et d’élaboration des vécus de haine. Les fictions violentes deviennent ainsi des outils de désappropriation et de réappropriation de soi, par lesquels les adolescent-e-s peuvent faire l’expérience d’un apprivoisement de la haine réelle.
BIBLIOGRAPHIE & FILMOGRAPHIE
ANDERSON C.A. & DILL K.E, « Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behavior in the Laboratory and in Life », Journal of Personality and Social Psychology, 78, vol. 4, 2000. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.772.
ANDERSON C., IHORI N., BUSHMAN B., ROTHSTEIN H. et al., « Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review », Psychological Bulletin, Vol. 136, No. 2, 2010, pp. 151–173. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-136-2-151.pdf
BESSON A., Constellations, Paris, CNRS Editions, 2015.
Chase, D. (1999-2007). The Sopranos. HBO.
CUNNINGHAM A. S., ENGELSTÄTTER B. ET WARD M. R., « Understanding the effects of violent video games on violent crime », ZEW Discussion Papers, 2011, 11-042, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1886419.
DURIEUX M.-P. & MATOT J.-P., « Variations psychanalytiques sur les aventures de Harry Potter », Le Carnet PSY, 184, pp. 19–34, 2014. DOI : 10.3917/lcp.184.0019
EKMAN P., Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, Times Books, 2003.
ENGÉLIBERT J.P., Apocalypses sans royaumes, Paris, Classiques Garnier, 2013
ESPARBÈS-PISTRE S., BERGONNIER-DUPUY G. & CAZENAVE-TAPIE P., « Le stress scolaire au collège et au lycée : différences entre filles et garçons », Éducation et francophonie, 43, n° 2, 2015. https://doi.org/10.7202/1034487ar
FOURNIS G., NABHAN-ABOU N., GAUTIER L. ORSAT M. et al., « L’écran et le truand : influence des jeux vidéo violents sur le passage à l’acte criminel », Annales Médico-psychologiques, 173, vol. 7, 2014, pp. 574-578. https://doi.org/10.1016/j.amp.2014.10.023.
FREUD S., « Remémoration, répétition et perlaboration », in Œuvres complètes tome XII, (trad. J. Altounian, P. Haller et D. Hartmann), Paris, PUF, 2004 (1914).
ID., Métapsychologie, trad. Altounian, Bourguignon, Cotet et Rauzy, Paris, PUF, 1994 (1915-1917).
DE GAUJELAC V. (dir.), La part de social en nous. Sociologie clinique et psychothérapies, Paris, Erès, 2017.
Gilligan, V. (2008-2013). Breaking Bad. AMC.
Horikoshi, K. (2014-en cours). My Hero Academia. Kana.
JEAMMET Ph., CORCOS M., Evolution des problématiques à l'adolescence, L'émergence de la dépendance et ses aménagements, Paris, Doin, 2010.
Kishimoto, M. (1999-2014). Naruto. Ki-Oon.
KRISTEVA J., Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, « Insécurité et délinquance en 2022 : bilan statistique - Fiche "Homicides" », 2022. https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Infractions/Homicides/Insecurite-et-delinquance-en-2022-bilan-statistique-Fiche-Homicides
PAHLAVAN F., DROZDA-SENKOWSKA E. & MICHELOT J., « Pratique des jeux vidéo violents et agression », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 75-76, 2007, pp. 51-63.
Phillips, T. (2019). Joker. DC Films
RICHARD F., L’actuel malaise dans la culture, Paris, L’Olivier, 2011.
Rowling, J. K. (1998). Harry Potter à l’école des sorciers. Gallimard.
SAMSON V., Les Berserkir, les guerriers-fauves dans la Scandinavie ancienne, de l'âge de Vendel aux Vikings, VIe-XIe siècle, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 2011.
Togashi, Y. (1998-2023). Hunter X Hunter. Kana.
WINNICOTT D. W., Jeu et réalité, l’espace potentiel (trad. Monod et Pontalis), Paris, Gallimard, 2002 (1971).
[1] Cf. DE GAUJELAC V. (dir.), La part de social en nous. Sociologie clinique et psychothérapies. Erès, 2017.
[2] Cf. ANDERSON C.A. & DILL K.E, « Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behavior in the Laboratory and in Life », Journal of Personality and Social Psychology, 78, vol. 4, 2000. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.772. ; PAHLAVAN F., DROZDA-SENKOWSKA E. & MICHELOT J., « Pratique des jeux vidéo violents et agression », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 75-76, 2007, pp. 51-63 ; ANDERSON C., IHORI N., BUSHMAN B., ROTHSTEIN H. et al., « Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review », Psychological Bulletin, Vol. 136, No. 2, 2010, pp. 151–173. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-136-2-151.pdf
[3] PAHLAVAN F., DROZDA-SENKOWSKA E. & MICHELOT J., Op. Cit.
[4] Par exemple CUNNINGHAM A. S., ENGELSTÄTTER B. ET WARD M. R., « Understanding the effects of violent video games on violent crime », ZEW Discussion Papers, 2011, 11-042. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1886419
[5] Cf. FOURNIS G., NABHAN-ABOU N., GAUTIER L. ORSAT M. et al., « L’écran et le truand : influence des jeux vidéo violents sur le passage à l’acte criminel », Annales Médico-psychologiques, 173, vol. 7, 2014, pp. 574-578. https://doi.org/10.1016/j.amp.2014.10.023.
[6] MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, « Insécurité et délinquance en 2022 : bilan statistique - Fiche "Homicides" », 2022. https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Infractions/Homicides/Insecurite-et-delinquance-en-2022-bilan-statistique-Fiche-Homicides
[7] DE GAUJELAC V. (dir.), Op. Cit.
[8] Ainsi, la désaffection progressive des programmes TV type « L’amour est dans le pré », « Mariés au premier regard », etc., serait une indication de ce manque d’intérêt de la part du public.
[9] Selon la psychanalyse freudienne, les pulsions inconscientes se subdiviseraient globalement en deux, les pulsions dites « de vie », qui vont de l’auto-conservation à la sexualité, sous l’égide d’Eros, et les pulsions dites « de mort », qui recouvrent l’hétéro- mais aussi l’auto-agressivité, rattachées à Thanatos. Ces deux « familles » de pulsions sont cependant intriquées.
[10] Selon certains chercheurs comme Paul Ekman, il existe six émotions primaires, communes à l’être humain et à un certain nombre d’animaux, surtout les mammifères : l’émotion est réduite à sa fonction adaptative, et à sa localisation cérébrale. Même les théories qui proposent un plus grand nombre d’émotions « de base » ne mentionnent pas la haine. Cf. EKMAN P., Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. Times Books, 2003.
[11] FREUD S., Métapsychologie, trad. Altounian, Bourguignon, Cotet et Rauzy. PUF, 1994 (1915-1917).
[12] SAMSON V., Les Berserkir, les guerriers-fauves dans la Scandinavie ancienne, de l'âge de Vendel aux Vikings, VIe-XIe siècle. Presses Universitaires du Septentrion, 2011.
[13] Cf. BESSON A., Constellations. CNRS Editions, 2015.
[14] Par exemple François Richard, Philippe Jeammet et Maurice Corcos ou Julia Kristeva et bien d’autres qui mettent l’accent sur une prévalence d’organisations narcissiques sur les névroses habituelles à l’époque de Freud. Cf. RICHARD F., L’actuel malaise dans la culture. L’Olivier, 2011 ; JEAMMET Ph., CORCOS M., Evolution des problématiques à l'adolescence, L'émergence de la dépendance et ses aménagements, Doin, 2010 ; KRISTEVA J., Pouvoirs de l’horreur, Seuil, 1980.
[15] Le genre « post-apocalyptique » ou « post-apo » est devenu un filon (cf. ENGELIBERT J.P., Apocalypses sans royaumes, Classiques Garnier, 2013), mais l’atmosphère de « fin du monde » imprègne bien d’autres fictions qui ne se réclament pas totalement du genre, à commencer par les sagas de Tolkien ou Rowling.
[16] Par exemple, Aline Vansoeterstede considère qu’un élève sur trois serait « fortement stressé » et en risque de décrochage, que 15% des lycéens montreraient des symptômes de burn-out; selon d’autres, « 17,1 % d’élèves se déclarant très stressés en sixième et jusqu’à 49,6 % en Terminale » (cf. ESPARBÈS-PISTRE S., BERGONNIER-DUPUY G. & CAZENAVE-TAPIE P., « Le stress scolaire au collège et au lycée : différences entre filles et garçons », Éducation et francophonie, 43, n° 2, 2015. https://doi.org/10.7202/1034487ar). Nous nous basons en outre sur un autre travail (à paraître) à partir d’entretiens menés pendant de nombreuses années en marge de notre activité d’enseignant en lycée, auprès de plusieurs dizaines d’adolescents.
[17] FREUD S., Op Cit.
[18] ID, « Remémoration, répétition et perlaboration », in Œuvres complètes tome XII, (trad. J. Altounian, P. Haller et D. Hartmann). PUF, 2004 (1914).
[19] WINNICOTT D. W., Jeu et réalité, l’espace potentiel (trad. Monod et Pontalis), Gallimard, 2002 (1971).
[20] Cf. DURIEUX M.-P. & MATOT J.-P., « Variations psychanalytiques sur les aventures de Harry Potter », Le Carnet PSY, 184, pp. 19–34, 2014. DOI : 10.3917/lcp.184.0019