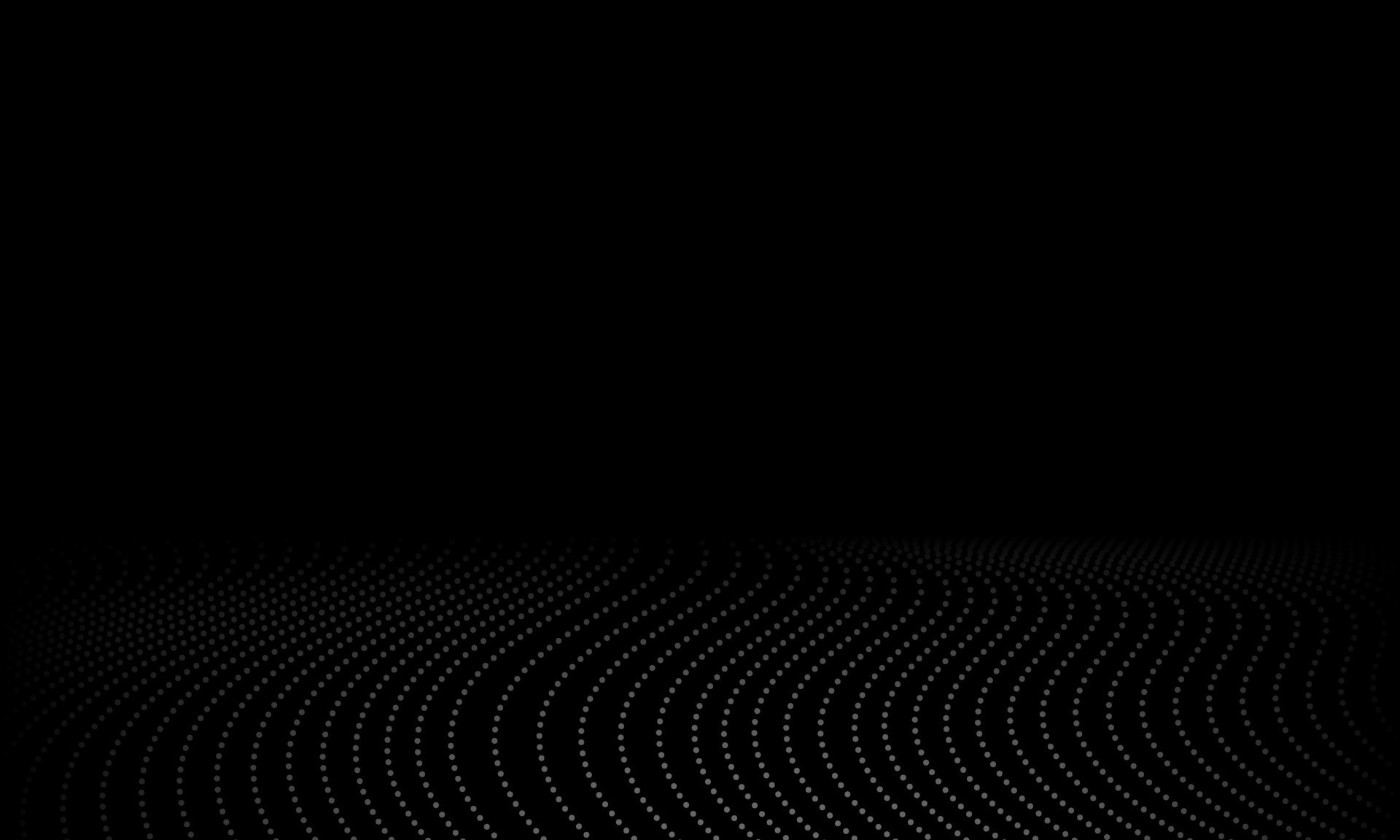Par Nelly Rousset, doctorante en sociologie à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire LEIRIS.
INTRODUCTION
La figure de la sorcière, telle qu’elle est perçue présentement en Occident, est empreinte d’une certaine dualité que l’on observe dans la façon dont elle est accueillie par les individus qui lui sont extérieurs et en parallèle dans la façon dont elle est utilisée et revendiquée par des groupes de femmes s’en saisissant pleinement.
Ce phénomène s’explique par les deux archétypes que l’on rencontre de la sorcière : d’une part la méchante et vielle femme à éliminer pour le bien de tous et de l’autre la femme libre, puissante, érudite, détenant de multiples talents, qui fait le choix, ou non, de la bienveillance.
Mais alors comment ces deux modèles, pourtant opposés, peuvent coexister ?
Ce sont deux malentendus ou mécompréhensions historiques qui vont ancrer cela dans l’imaginaire de tout un chacun et les faire perdurer jusqu'à devenir à son paroxysme, pour certaines femmes, un véritable idéal à atteindre pour s’émanciper à la fois des hommes et de la société, car construite sur un modèle ne leur convenant pas : celui du patriarcat. Ainsi, cette organisation sociale, basée sur un système de pouvoir détenus par les hommes et d'inégalités de genre peut conduire à de la misogynie, à savoir une aversion voire du mépris pour les femmes, et ce, jusqu'à la haine de celles-ci.
Ce constat serait d'autant plus véridique pour les sorcières contemporaines puisque leur histoire et leur héritage prendraient place dans un contexte historique, politique, social et religieux largement construit sur la haine de la femme.
LES CHASSES AUX SORCIERES, UNE HISTOIRE DE MISOGYNIE ?
L’image diabolique de la sorcière est très largement héritée de l’épisode des chasses aux sorcières durant la renaissance. Mais elle vient plus précisément du Malleus Maleficarum ou Le marteau des sorcières en français, le célèbre traité de démonologie et de lutte contre les sorcières.
Mais avant son édition et sa diffusion, la magie a eu un traitement particulier dans la loi et dans la société de l'époque, et cela, dans un objectif de démagification du monde (ou de désenchantement du monde, de l’allemand Entzauberung der welt), comme l’entendait Max Weber, à savoir un processus de rejet de tous les moyens magiques afin d'atteindre le salut[1] :
- La loi salique, IV-VIe siècle : Aborde une méfiance envers les maléfices, les empoisonneurs, les enchantements.
- Le canon Episcopi, Xe ou XIe siècle : Parle de quelques femmes qui ont des illusions envoyées par le Diable où elles chevauchent des animaux la nuit en compagnie de Diane, déesse des païens.
- Constitution Excommunicamus, 1231 : Le pape Grégoire IX va créer l’Inquisition pour lutter contre les hérésies.
- Vox in Rama, 1233 : Une bulle pontificale par Grégoire IX où il affirme que les hérésies diaboliques existent.
- Super illius Specula, 1326 ou 1327 : Une bulle pontificale par Jean XXII où il assimile la sorcellerie à une hérésie.
- Le manuel des Inquisiteurs, 1376 : Écrit par le théologien Nicolas Eymerich.
- Fortalitium fidei, vers 1465 : Est un exposé sur la foi chrétienne en cinq tomes de Alonso de Espina. Le cinquième aborde la lutte contre les démons, c’est le premier livre parlant de la sorcellerie.
- Formicarius, 1475 : Écrit par Johannes Nider, deuxième livre abordant la sorcellerie, la sorcière est décrite comme peu éduquée.
- Summis desirantes affectibus, 1484 : Une bulle pontificale par Innocent VIII reconnaissant officiellement l’existence des sorciers et des sorcières.
- Malleus Maleficarum, 1486 ou 1487 : Écrit par Henri Institoris et Jacques Sprenger, traité de démonologie et de lutte contre les sorcières qui aura un certain succès malgré sa condamnation par l’Église catholique dès 1490.
Ainsi, la mise en vigueur des lois et l'acceptation commune de ce qu'était la sorcellerie et les sorcières s’est renforcée au fur et à mesure des années, passant de la simple évocation de maléfices à la création même des termes, par la suite très largement adoptés par toute la société occidentale. Au départ, on parlera de la magie comme étant un art, et de la sorcellerie comme d’une volonté de contrôler les mêmes forces sans maîtriser quoi que ce soit[2]. Donc, au Moyen Age, la sorcellerie n’est pas appréciée mais reste tolérée et glissera graduellement dans le domaine de l’hérésie.
En réalité, sous le christianisme, il y a deux types de sorcellerie : la sorcellerie simple qui se passe du diable (qu’on peut traduire par Sorcery en anglais) et la sorcellerie diabolique (qu’on peut traduire en anglais par Witchcraft)[3]. Les chasses aux sorcières vont être un glissement de l’une vers l’autre, jusqu’à l’anéantissement de la première.
Le Malleus Maleficarum et les chasses aux sorcières sont une sorte de prémices de la sécularisation : Les chasses aux sorcières sont rendues possibles car le système juridique civil change, il se décentralise et les juges locaux sont libres de faire régner la loi comme ils le souhaitent. Là où d'ordinaire nous avons tendance à penser que l’Église catholique est entièrement responsable des actes des chasses, il se trouve que celle-ci a condamné l’ouvrage dès 1490, ce sont les civils qui se sont chargés de condamner les sorcières.
Ce que l’on retiendra de l’histoire c’est que la sorcière moderne est une invention de l’esprit, qui des siècles plus tard perdure. De ce fait, il n’y a vraisemblablement jamais eu de quelconques sorcières, telles que décrites, seulement des personnes accusées de sorcellerie pour une multitude de raisons, qu'il s'agisse d'homme ou de femme et peu importe l’âge. Même si ces dernières restent tout de même en surreprésentation, la majorité étaient des femmes sans éducation, n’ayant pas la possibilité de se défendre lors des procès, loin de l’idée de la femme savante et puissante représentant un danger pour les hommes et la société patriarcale.
Par conséquent, la réalité historique n’est pas identique à celle fantasmée par les femmes s’identifiant à la figure de la sorcière et surtout s’estimant comme étant des héritières de toutes les femmes, de toutes les sorcières injustement brûlées pour leurs dons ou encore pour leur proximité avec le diable. Car si les femmes ont été prises pour cible c’était notamment dans un temps d’incertitude, de méconnaissance de nombreux sujets et donc se trouver un ennemi commun à blâmer pour tous les désastres (météorologiques, les maladies courantes et dévastatrices, la faible espérance de vie des nouveaux nés, les dangers des grossesses et des accouchements…) était coutumier.
Cependant, le Malleus Maleficarum, ce manuel en deux parties, une pour expliquer ce qu’est une sorcière et la seconde pour détailler le déroulé d’un procès, reste un ouvrage profondément misogyne, et qui révèle à chacune de ses pages une vive haine pour la femme de la part des auteurs mais aussi naturellement de ses utilisateurs. Il sera donc à l’origine de l’image de la sorcière diabolique, persistant encore au XXIe siècle, que l'on peut fréquemment retrouver dans les contes pour enfant sous l'image d'une vieille femme dangereuse. Il expliquera qu’« il n'y a rien d'étonnant à ce que parmi les sorciers il y ait plus de femmes que d'hommes. Et en conséquence on appelle cette hérésie non des « sorciers » mais des « sorcières », car le nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut qui jusqu'à présent préserve le sexe mâle d'un pareil fléau »[4]. Avec cet extrait, la haine pour les femmes à cette période, mais surtout de cet écrit en particulier, paraît indéniable. C'est en partie cela qui va motiver les sorcières d’aujourd’hui à ne plus rester dans l’ombre, mais également déterminer certains groupes à se saisir de cette figure afin de lutter contre les injustices, de s'en saisir comme outil politique, comme un outil de revendication et de libération de la condition féminine.
LA SORCIERE, UNE FIGURE SUBVERSIVE ?
Presque cent ans après la fin des chasses aux sorcières, en 1862, l'historien Jules Michelet va publier son ouvrage La sorcière dans lequel il va largement la romantiser. Il en parle comme d'une femme révoltée contre la société et contre l’Église qui l'opprime par aversion envers son genre. Pour lui, il s'agit d'une jeune femme libre, rebelle, elle est la mère de la science moderne, qu'il va situer dans un Moyen Age obscur dominé par Satan. Or, comme abordé précédemment, il s'agissait en réalité, pour la majorité des accusées, plutôt de vieilles femmes, mal éduquées, voire pas du tout, et qui ne savaient et ne pouvaient se défendre correctement durant leurs procès et qui finissaient par avouer sous la torture.
Ses erreurs, malgré leurs dénégations de la part de nombreux historiens, vont nourrir l'imaginaire positif de la figure de la sorcière et vont continuer à le faire puisque c'est de part ses idées que les sorcières contemporaines puisent les éléments de leur identification. Ceci, de la même manière que le Malleus Maleficarum continue à nourrir l'imaginaire négatif que l'on retrouve encore au cinéma, à la télévision et dans la littérature.
Cette évolution raisonne comme une dérivation du mythe. Ici, le mythe de la sorcière est réinvesti par un autre schéma narratif, nous passons de l'écriture masculine pendant les chasses à l'écriture de Michelet, plus féminine, et donc, elle va être très largement réutilisée et amplifiée dans les mouvements féministes des années soixante, car plus séduisante que la réalité historique.
Cette transformation du mythe raisonne comme une réanimation herméneutique, il y a un nouveau contexte de réception, la réception féministe qui suit l'émancipation de la femme dans la société. Il y a un engagement actif autour de la représentation de la sorcière. C'est une herméneutique symbolique qui vise à amplifier le mythe, où l'on va « […] reconstituer, par l'acte de lecture, les sens dénivelés et cachés d'un texte, leur multiplicité et leur richesse, pour les actualiser en différents champs et moments de l'expérience humaine »[5].
En ce sens, plusieurs mouvements récupérant la figure de la sorcière, à travers des slogans, des actions et des accoutrements qui lui sont propres vont voir le jour.
En 1968, à New York, un collectif créé par environ treize activistes féministes va voir le jour, c'est le « Women's International Conspiracy from Hell » (W.I.T.C.H, ou la Conspiration terroriste internationale des femmes venues de l'enfer), il s'agira du groupe ayant le plus marqué l'histoire. Leur lutte se dirige au départ plus vers la domination des riches sur les pauvres que celle des hommes sur les femmes, estimant alors que le capitalisme et les grandes entreprises américaines sont la véritable source des problèmes, les véritables ennemis des femmes. Leur première action se déroule le jour d'Halloween, le 31 octobre 1968, où elles seront vêtues de noir avec des chapeaux pointus, des capes et des balais, contre Wall Street, la Bourse de New York. Les activistes sont apparues avec une tête de cochon en papier mâché dans une assiette dorée et leurs balais et ont entouré la statue de George Washington se trouvant sur les escaliers du Federal Hall National Memorial à New York. Elles ont ensuite lancé un sort dans l'optique de rendre l'argent à la population.
Quelques mois plus tard, en février 1969, le lendemain de la Saint-Valentin, le collectif s'est de nouveau réuni pour lutter contre l'institution du mariage, qu'elles trouvent déshumanisante, lors d'un salon du mariage au Madison Square Garden. Ainsi, elles vont s’inscrivent dans une lutte contre le patriarcat, l'objectivation de la femme et la misogynie.
Par la suite, plusieurs actions, de groupes différents ont surgies dans le paysage médiatique, luttant contre la fête des mères, contre l'enfermement de femmes activistes au sein des Black Panthers, contre la hausse des tarifs du métro de Chicago, plus récemment contre l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis ou en faisant face à la haine raciale en participant aux mouvements Black Lives Matter. Mais aussi en France, avec le Witch bloc paname qui manifeste contre la loi travail vêtu de chapeau de sorcière et de longues robes noires ou se réunissant contre la marche pour la vie clamant le droit à l’interruption volontaire de grossesse.
Encore aujourd'hui, le célèbre slogan féministe « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler », parle a énormément de femmes dans la lutte féministe et raisonne comme une réalité.
De surcroît, la figure de la sorcière ne va pas seulement être utilisée à des fins politiques, elle est aussi une métaphore pour l'acceptation des caractéristiques féminines stigmatisantes, tels que les attributs propres à la vieillesse (les cheveux blancs, les rides, la ménopause...), du non-désir de maternité, du souhait de rester célibataire, etc. Caractéristiques qui pour beaucoup s'approchent de celles qui auraient mené les femmes à être considérées comme des sorcières et accusées de pratiquer la sorcellerie à la Renaissance, puis condamnées. On assiste à une sorte d'inversion du stigmate, ce qui auparavant devait être tu peut désormais être abordé avec fierté en permettant de se présenter comme une sorcière contemporaine. C'est notamment ce que la journaliste Mona Chollet s’efforce de faire dans son essai à succès Sorcières : La puissance invaincue des femmes, en récupérant des faits en partie erronés (volontairement ou non, par manque de diversités de ses sources, se penchant plus sur des écrits féministes que sur des travaux historiques), elle souhaite conduire les femmes à accepter leurs stigmates, encourage l'identification à la prétendu figure forte et libre de la sorcière. Être une sorcière serait donc par extension une lutte contre le patriarcat et contre toutes les idées qu'il diffuse, c'est une lutte contre la haine des femmes.
Par conséquent, des femmes sont susceptibles de s'identifier à la sorcière soit par féminisme, soit par forte conviction d'en être une et par ce processus, celles-ci vont éventuellement exercer la sorcellerie, ou tout du moins une version contemporaine de cette pratique.
LA SORCELLERIE COMME MODE DE RELIGIOSITE
Largement rendu possible par Jules Michelet, cette haine de la femme, fantasmée ou non, conduit les sorcières contemporaines à se retrancher dans une religiosité alternative, celle de la sorcellerie. Cela va se déployer dans différentes pratiques ésotériques plus ou moins grand public et qu'il est possible désormais de retrouver dans le commerce : le tarot, le pendule, les oracles, le ouija, les bougies, les dés de divination, etc.
Ainsi, il est possible de faire un parallèle avec le mouvement New Age, qui serait un phénomène social, une nouvelle forme sociale de religion sans institution. Il répondrait à des besoins de plus en plus spécifiques dont la religion classique monothéiste ne se saisirait pas. Tantôt considéré plutôt comme une « nébuleuse mystique ésotérique » (F. Champion), ou comme un « marché de la spiritualité » (H. Van Hove) ou d'autre part comme une religiosité postmoderne (V. Vaillancourt et A. Kubiak), le New Age aurait une vision holiste du monde.
Le chercheur Martin Geoffroy, soutient le fait que ce mouvement « a une structure, mais aussi qu'il est traversé par de grands courants idéologiques identifiables et qu'il est une nouvelle forme de religion. »[6]. Pour lui, il existe donc différentes dimensions dans le New Age : une dimension sociale, culturelle, ésotoréro-occultiste et biopsychologique.
La sorcellerie contemporaine, telle que pratiquée en occident à notre époque, serait au carrefour de toutes ces idées, en ayant une sensibilité pour le féminisme, l'environnement et l'écologie, accordant une place centrale à l'ésotérisme et à l'occultisme dans une perspective de soin, de bien-être et de guérison.
Mais il existe cependant une nuance non négligeable, puisque la sorcellerie peut se traduire par des pratiques moins explicites, car pour beaucoup, elle reposerait sur les intentions que l'on met dans ce que nous faisons. Alors, pour certaines femmes n'ayant pas le temps de se consacrer pleinement à la sorcellerie, ou n'en n'ayant pas l'envie ou les connaissances nécessaires, mettre des intentions magiques sur des actes du quotidien constitue une première approche. Si bien que faire des tâches ménagères, ranger son lieu de vie, prendre une douche, boire un café ou un thé, arroser ses plantes, etc., peut intégralement faire partie de sa pratique magique, puisque l'intention que l'on place dans son geste est essentielle. Jeanne Favret-Saada, estime dans son ouvrage Corps pour corps[7] que la parole est pouvoir dans la sorcellerie et non un savoir ou une information.
Cependant, si ces pratiques peuvent être considérées comme de la sorcellerie, elles ne représentent pas l'intégralité de ce qui la compose, bien au contraire, si ici c'est une version simplifiée, pour de nombreuses femmes cela se rapproche d'un art difficilement perceptible. Être une sorcière, c'est avoir des dons, des dons de guérison, de médiumnité, de voyance ou de clairaudiance, puis se perfectionner avec de nouveaux outils, avec de nouvelles connaissances, grâce à des livres, des formations ou autres conférences.
De plus, les sorcières vont venir développer tout un système de hiérophanies dont certaines ayant pour but de sacraliser le corps féminin et donc de mettre naturellement les hommes à distance, qui par le simple fait de parler de sorcière au féminin et non au masculin l'étaient déjà. Ceci va être intégralement récupéré par le mouvement dit du féminin sacré, où l'idée est de vénérer le corps de la femme pour se le réapproprier, mais aussi de vénérer certaines déesses telles qu'Artémis, Aphrodite, Isis, etc.
Le culte des déesses de mythologies anciennes tient une place parfois centrale dans la pratique de la sorcellerie, nous pouvons notamment retrouver Hécate, la déesse de la lune et de la magie ou encore Lilith considérée comme la première femme de l'Histoire, avant Eve, et qui aurait tenu tête à Adam puis à Dieu avant d'être bannie du Jardin d’Éden. Le besoin de diriger sa croyance vers des déesses et non des dieux ou un dieu unique, traduit un vrai besoin de s'inscrire dans une religiosité entièrement féminine, à l'écoute des femmes souvent mise au second plan dans les grandes religions historiques.
En somme, les sorcières vont resacraliser leur vie, des moments de leur journée, des périodes de l'année, mais en particulier, elles ont une vraie volonté de resacraliser la nature. C'est une sorte de « naturalisation du sacré »[8], la lune, le soleil, les cycles végétatifs, les quatre éléments, la nuit, etc., constituent les axes des hiérophanies des sorcières. Certaines d'entre elles suivent la roue de l'année (ou roue du temps) où chaque période va être une célébration : Imbolc : 1-2 février, célébration de Brigit, déesse des arts de la guérison et de la fertilité, de la magie, de la divination ; Ostara : 20-23 mars, célébration de l'équinoxe de printemps ; Beltane : 30 avril-1er mai, célébration du printemps ; Litha : 20-22 juin, célébration du solstice d'été ; Lughnasadh : 1er août, célébration des récoltes ; Mabon : 20-23 septembre, célébration de l'équinoxe d'automne ; Samain : 31 octobre, considéré comme le nouvel an des sorcières ; Yule : 20-25 décembre, célébration du solstice d'hiver.
Si initialement ces célébrations se trouvent dans la culture celte et/ou païenne, elles ont grandement été récupérées par la Wicca, qui se veut comme une religion. Le terme vient du vieil anglais wiccian, qui signifie « ensorceler, pratiquer la magie ».
Son histoire va débuter en 1954 avec Gerald Gardner, qui fait apparaître ce mouvement religieux néopaïen dont les membres seront, et sont encore, adeptes de sorcellerie. Globalement, nous y retrouvons des éléments de la mouvance New Age : des médecines alternatives, un intérêt plus ou moins grand pour l'écologie et pour les religions antiques, pour la psychologie et des croyances magiques en tout genre.
La Wicca va largement s'inspirer des travaux de l'égyptologue Margaret Murray, notamment l’ouvrage the Witch-Cult in Western Europe qui prétend annoncer d'où la sorcellerie européenne prend ses origines. Il s'agirait d'un culte de la fertilité, une sorte de religion pré-chrétienne qui consiste à honorer un Dieu cornu en groupe de treize, quatre fois par an. Néanmoins, ses travaux vont très vite être discrédités par d’autres historiens, ils vont estimer qu’elle manipule les informations, qu’elle s’attarde sur des détails pour créer ses théories. Aujourd’hui encore rien n’est sûr, certains tentent de réhabiliter ses travaux, mais ils ne font absolument pas consensus dans le milieu scientifique. Malgré cela, des adeptes sont encore nombreux et nombreuses, même si le mouvement a connu plusieurs changements notamment la création de différentes branches, souvent par des femmes et répondant à des besoins plus spécifiques. Si la Wicca est à l'origine un mouvement créé par un homme, elle se compose en immense majorité de femmes et si quelques-unes n'ont pas toujours été d'accord avec ce dernier, elles ont alors orienté leurs pratiques et leurs croyances vers des éléments leur parlant plus. C'est le cas avec Zsuzsanna Budapest, qui fondera la wicca dianique, centrée sur la déesse et sur le féminin.
Ainsi, la sorcellerie, peu importe la forme qu'elle prend, se présente comme un mode de religiosité alternative, qui vient compenser ce que les religions traditionnelles ne parviennent pas à fournir à ces femmes. On peut la voir comme un nouveau mouvement religieux, composé « à la carte » comme Jean-Louis Schlegel[9] l'entend, car celle-ci prend des éléments du christianisme, du bouddhisme, mais aussi d'autres cultures ou société, notamment avec l'adoption des pratiques chamaniques. Cela fait intégralement partie de ce que la sociologie des religions considère comme une recomposition du religieux.
En effet, la sorcellerie reste un moyen de mettre la femme au centre, de la sacraliser de la même manière que l'adoption de l'identité de sorcière reste un moyen de s'approprier une figure malmenée par les décennies et les hommes, et concernant seulement le genre féminin.
CONCLUSION
En définitive, même si l’identification à la figure de la sorcière, aujourd’hui, est née de malentendus et d’une certitude d’être les héritières de femmes puissantes qui ont péries dans les flammes ; et que le principal mouvement religieux de sorcellerie, lui, est né de travaux académiques à la véracité discutable, le besoin de s’identifier à cette figure prétendument forte et le besoin de pratiquer une religiosité alternative reviennent à compenser une société qui ne fonctionnerait plus.
S’identifier à la sorcière, c’est aussi une forme de solidarité féminine, les femmes appartenant à ce même groupe se nomment entre elles des soeurcières, témoignant ainsi, d’un fort besoin de sororité, d’union et de partage qui va accentuer cette mise à distance du genre opposé.
On souligne de ce fait, une multi-causalité à l'identification claire et assumée à la figure de la sorcière et à la pratique de la sorcellerie contemporaine au XXIe siècle. Ici trois ont été spécifiquement avancées : celle d'un besoin de réponse au patriarcat, celle d'une volonté de remagifier le monde, et celle d'un besoin de répondre à une certaine nostalgie du sacré. On ajoutera également le fait que la sorcellerie, dans une perspective de soins et comme religion de guérison, tant physique que psychologique, fait face à la déliquescence du système de santé dont elle se vante d'être une alternative efficace.
De surcroît, en réaction à une haine perçue des hommes de la Renaissance qui haïssaient les sorcières, et plus généralement les femmes, celles d'aujourd'hui, trouvent dans le fait d'assumer pleinement et d'aller jusqu'à revendiquer parfois leur identité un moyen d'honorer les femmes autrefois accusées et brûlées. Il est donc logique de voir apparaître la sorcière dans les mouvements féministes, en effet, quelle autre figure mythique aurait autant sa place dans la lutte pour les droits des femmes ou dans la lutte pour les droits civiques ?
Cependant, lorsque que la revendication du genre féminin, sa sacralisation et sa vénération sont poussées trop loin, il est nécessaire de veiller à ce que les mouvements, les pratiques et les croyances ne tombent pas dans le domaine de la dérive sectaire.
BIBLIOGRAPHIE
ARNOULD C., Histoire de la sorcellerie. Texto. Paris: Tallandier, 2009.
BECHTEL G., La sorcière et l'occident, Plon, coll. « L'abeille », 2019 (1997).
CHOLLET M., Sorcières : La puissance invaincue des femmes, Zones, 2018.
DU CHÉNÉ C., Les sorcières : Une histoire de femmes, Michel Lafon, coll. « France culture », 2019.
FAVRET-SAADA J., Corps pour corps, Enquête sur la sorcellerie dans le bocage, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1981.
INSTITORIS H. SPRENGER J., Le marteau des sorcières, Plon, coll. « Civilisations et mentalités », 1973 (1486-1487).
MARTIN G., « Pour une typologie du nouvel âge ». Cahiers de recherche sociologique, no 33 (2000): 51‑83.
PALOU J., La sorcellerie, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1995 (1957).
PICQUART Y., Le retour des sorcières : Qu'en disent les chrétiens ? Saint-Léger éditions, 2020.
SALLMANN J., Les sorcières, fiancées de Satan, Gallimard, coll. « Découvertes », 1989.
SCHLEGEL J., Religions à la carte, Hachette, coll. « Questions de société », 1995.
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Witches : histoires de sorcières [exposition, 27 octobre 2021-16 janvier 2022, Espace Vanderborght, Bruxelles]. Éditions de l’Université de Bruxelles, 2021.
WEBER M., L’Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Pocket/Plon, coll. « Agora », 1998 (1964).
WUNENBURGER J., Le sacré, PUF, coll. « Que sais-je », 2019 (1981)
WUNENBURGER J., L'imaginaire, PUF, coll. « Que sais-je », 2003.
[1]WEBER M., L’Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Pocket/Plon, coll. « Agora », 1998 (1964), p.117.
[2]PALOU J., La sorcellerie, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1995 (1957), p.8.
[3]BECHTEL G., La sorcière et l'occident, Plon, coll. « L'abeille », 2019 (1997), pp.83-84.
[4]INSTITORIS H., SPRENGER J., Le marteau des sorcières, Plon, 1973 (1486-1487), p.209.
[5]WUNENBURGER J., L'imaginaire, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2003, p.38.
[6]Martin Geoffroy, « Pour une typologie du nouvel âge », Cahiers de recherche sociologique, n° 33, 2000, pp. 51-83.
[7]FAVRET-SAADA J., Corps pour corps, Enquête sur la sorcellerie dans le bocage, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1981.
[8]WUNENBURGER J., Le sacré, PUF, coll. « Que sais-je? », 2019 (1981), p.18.
[9]SCHLEGEL J., Religions à la carte, Hachette, coll. « Questions de société », 1995.