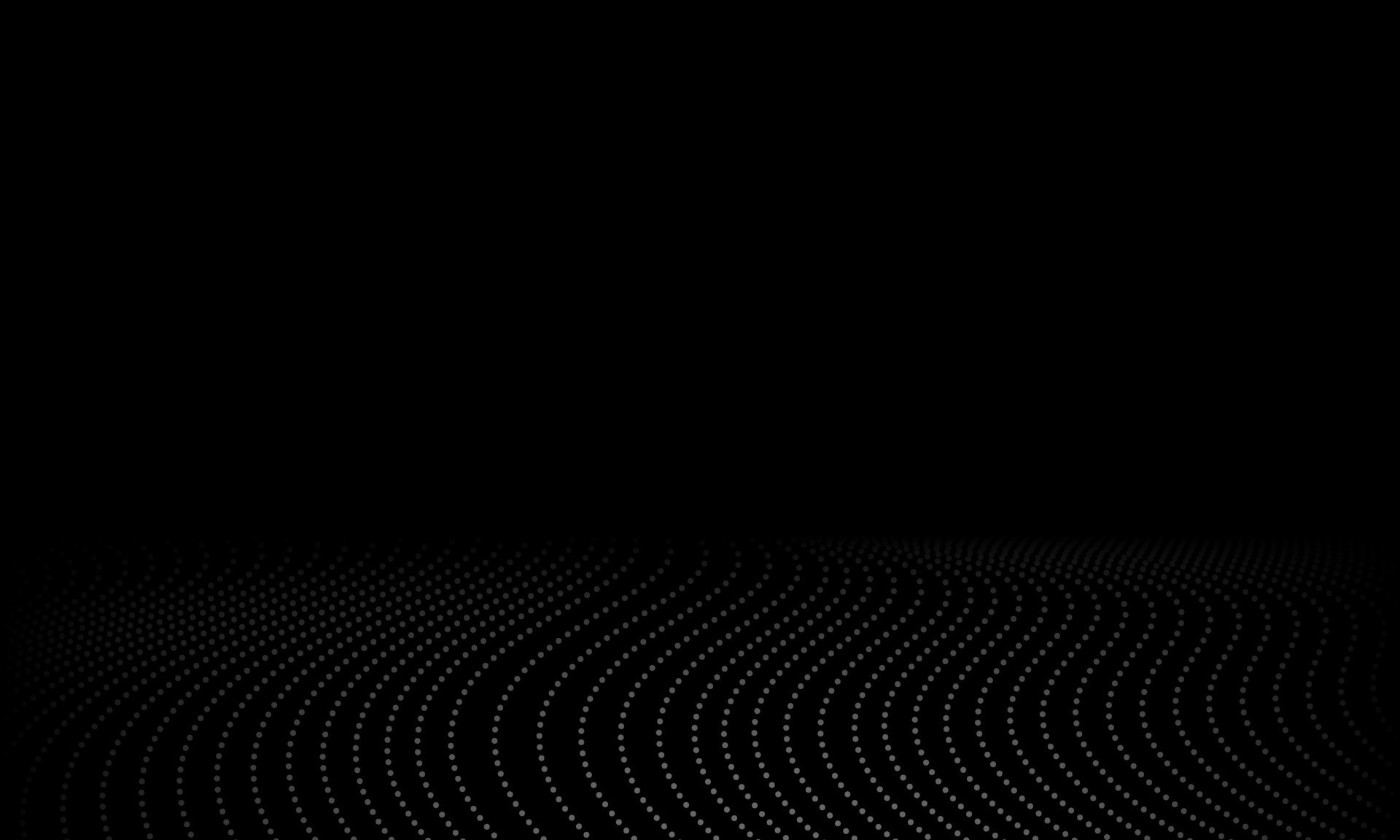Par Sebastian Acevedo Ojeda, Docteur en Etudes romanes spécialité Etudes hispaniques et hispano-américaines, Membre du Crimic, ATER à Sorbonne Université.
Dans les années 1930, la fin de l’hégémonie conservatrice et l’avènement de projets libéraux réformateurs, avec une forte tonalité sociale et progressiste, déclenchèrent une véritable réaction conservatrice en Colombie. Dès lors, pour attaquer et saborder les différents projets politiques de réformes sociales, s’installe dans les discours des droites colombiennes une véritable diabolisation des gauches colombiennes, favorisée par la haine des élites traditionnelles colombiennes envers le socialisme et le communisme. Dans cette optique, les différents projets de gauche vont systématiquement être stigmatisés et amalgamés avec le péril rouge, sans distinction entre les différentes tendances de gauche, confondant les guérillas marxistes avec des hommes politiques modérés de gauche ou des libéraux réformistes. En effet, cette propagande anticommuniste ne différenciait pas entre les partisans de l’action violente et ceux qui prônaient la conquête du pouvoir par les urnes et le respect des institutions. Sans surprise, l’argument omniprésent de l’épouvantail « rouge » deviendra l’une des pierres angulaires de la stratégie des élites politiques colombiennes et de la réaction conservatrice contre les revendications populaires et la politisation des masses.
Dans les faits, la désignation de l’ennemi communiste sera le moteur d’un tournant autoritaire qui va justifier la mise en place des piliers du terrorisme d’État qui va sévir durant la seconde moitié du XXe siècle en Colombie. Comprenant le terrorisme d’État comme une manière de gouverner, dans laquelle au nom d’une prétendue cause supérieure, la terreur et la répression deviennent des instruments politiques légitimes pour annihiler les oppositions[1]. Dès lors, ce projet de répression sociale et de marginalisation des alternatives politiques va s’intensifier dans le contexte continental de la doctrine de la sécurité nationale et de la lutte contre l’ennemi intérieur. Dans cette atmosphère de Guerre froide, la Colombie va graduellement institutionnaliser et légaliser le terrorisme d’État par des décrets, des lois, des déclarations d’État d’exception qui vont renforcer la capacité répressive de l’État.
En définitive, en s’appuyant sur la presse, les lois et les discours de l’époque, cet article propose d’analyser l’instrumentalisation de la haine anticommuniste et le prétexte de la lutte contre l’ennemi intérieur comme alibi pour légitimer les crimes de l’État contre les différents courants de gauche en Colombie durant le XXe siècle.
LA DESIGNATION DE L'ENNEMI ET L'INSTRUMENTATLISATION DE L'ÉPOUVANTAIL « ROUGE » AU COURS DU XXe SIECLE
C’est face à l’agitation sociale croissante des années 1920 et 1930 que les élites colombiennes, libérales comme conservatrices, vont développer et manifester une véritable haine du « rouge », l’érigeant au rang d’ennemi principal de la nation et l’utilisant comme un véritable bouc émissaire qui allait permettre de justifier et de légitimer la marginalisation et l’éradication des alternatives politiques tout au long du XXe siècle.
En effet, les années 1930 avaient accentué et intensifié les tensions et fractures sociales. Dans les faits, les ondes de la crise de 1929 qui remettaient en question le modèle de développement agro exportateur et la pénétration des idées des Révolutions russe et mexicaine, ont contribué à façonner une atmosphère générale de turbulences politiques et sociales. Ces tensions politiques et sociales allaient déboucher sur une crise de légitimité et de représentativité du bipartisme hégémonique[2], facilitant une crise interne des deux forces historiques : le Parti libéral et le Parti conservateur. Dans ce contexte agité, affleuraient dans les rangs libéraux des réformateurs sociaux populaires qui avaient le soutien des classes populaires, des partis de gauche et des syndicats. Parmi eux, sont apparus des hommes politiques populaires, comme Alfonso Lopez Pumarejo et Jorge Eliécer Gaitán, qui incarnaient l’espoir social d’une voie réformiste pacifique et légale qui puisse répondre aux attentes populaires, sans détruire l’ordre existant ni les institutions.
Toutefois, cette fin de l’hégémonie conservatrice déclencha une véritable réaction conservatrice en Colombie. Effectivement, face à la pression sociale, populaire et politique, ces élites allaient s’opposer violemment aux prétentions réformistes et sociales, manifestant une véritable haine envers les idées socialistes, communistes et progressistes qu’ils assimilaient à la contagion du bolchevisme dans le monde.
C’est réellement à partir des années 1930 que l’on peut repérer clairement la désignation de l’ennemi « rouge » dans les discours et la presse, ce qui fut une constante omniprésente de l’argumentaire des élites politiques colombiennes pour contrer le spectre d’une révolution sociale. Dès lors, bien que l’ennemi communiste changeât de visage au fil des contextes historiques fluctuants, se maintenait au cours du XXe siècle, de manière permanente, la stratégie de la diabolisation des alternatives politiques qui prônaient des changements. De cette façon, bien que les époques changent et que les ennemis évoluent, le bouc émissaire « rouge » restait au centre des discours et des diatribes politiques, comme le prouvent l’analyse de la presse et des discours des élites traditionnelles colombiennes de l’époque.
Au départ, au début des années 1930, les droites colombiennes dénonçaient avec hargne la conjuration maçonnique et communiste, comme le prouvent les déclarations virulentes dans la presse réactionnaire en 1937 de Lucio Pabón, figure majeure du national-catholicisme en Colombie[3]. Par la suite, l’infusion des idées fascistes dans les années 1930 et 1940 favorisèrent un antisémitisme croissant dans une frange importante des élites colombiennes, qui allaient dénoncer sans relâche une supposée « conspiration judéo-bolchevique ». Pour preuve, le journal conservateur le plus influent de l’époque El Siglo, reprenant certaines idées réactionnaires européennes, ne cessait d’assimiler judaïsme et bolchevisme en 1936[4]. De manière plus éclatante, le 11 août 1942, Laureano Gómez, l’une des figures notoires du Parti conservateur colombien du XXe siècle, prononça un discours violent avec des relent racistes, en pleine tribune du Sénat, désignant explicitement le danger de la franc-maçonnerie et du communisme, les présentant comme des « avortons juifs »[5].
Postérieurement, avec les prémices de la Guerre froide, s’imposait dans les textes de l’époque la « supposée » menace asiatique, qui faisait référence aux soviétiques et à la propagation communiste en Asie, qui selon les droites colombiennes, avaient pénétré le pays et donnaient des ordres aux mouvements de gauche colombiens[6]. Il faut dire que cette hantise anticommuniste favorisa en terre colombienne l’exaltation de l’esprit de croisade, la glorification de l’hispanité et du catholicisme, qui étaient présentés comme un bouclier culturel et idéologique contre cette « pénétration asiatique ». D’ailleurs, le politicien et diplomate conservateur -Alfredo Carrizosa Vázquez-, avait salué le triomphe de la république chrétienne de Laureano Gómez au début des années 1950, insistant sur le fait que, sans elle, l’ordre catholique aurait été remplacé par l’ordre marxiste[7]. Spécialement, avec la victoire de la révolution cubaine, la menace communiste prit un visage latino-américain. La figure des barbus qui détrôna Fulgencio Batista à La Havane en 1959, avait affolé les dirigeants colombiens et latino-américains, justifiant la mise en place de la doctrine de la sécurité nationale dans le cadre de l’endiguement anticommuniste en Amérique latine.
Par la suite, la prolifération des mouvements guérilleros colombiens[8] durant les années 1960 et 1970, allait recentrer la question de l’ennemi « rouge » dans le cadre national privilégiant dans les discours le danger de la lutte contre l’ennemi intérieur et la mise en place d’une répression brutale contre toute opposition contestataire qui était immédiatement stigmatisée avec les mouvements insurrectionnels. Finalement, à partir des années 2000 et l’avènement du chavisme chez le voisin vénézuélien et d’une vague progressiste sur l’ensemble du continent, est apparue en Colombie l’instrumentalisation d’une menace Castro-chaviste, ce qu’allaient subir, de manière récurrente, Gustavo Petro et la gauche démocratique. Par conséquent, il faut bien comprendre que la désignation de cet ennemi « rouge » a constitué l’un des traits essentiels des discours et de la stratégie politique pour se maintenir au pouvoir et justifier, par la suite, la mise en place d’un régime autoritaire qui n’hésitait pas à faire usage des instruments du terrorisme d’État.
Il est indéniable que le rejet et la haine anticommuniste partagés par les élites traditionnelles colombiennes furent l’un des moteurs de leur réconciliation, s’accordant sur le diagnostic que la menace communiste et des gauches réformatrices ou socialistes, par là-même leur permanence au sommet de l’État, constituaient un danger existentiel pour la nation. Ainsi, l’épouvantail « rouge » était donc devenu la menace prioritaire qu’il fallait anéantir à tout prix, comme le prouve l’abondance de sources de l’époque sur cette thématique. À ce sujet, dès le 19 février 1938, le journal Obrero Católico déclarait que le communisme était l’ennemi le plus redoutable des Colombiens[9]. De la même façon, le 4 janvier 1939, dans les lignes de La Patria, le parti nationaliste colombien déclarait explicitement que le véritable ennemi était le communisme et qu’il devait être combattu sans relâche par l’État[10]. Pour sa part, le célèbre conservateur et nationaliste Augusto Ramirez, dans son livre Dialectique anti-communiste, effectuait une étude systématique du marxisme, pour mieux mettre en exergue les raisons du danger qu’il représentait pour la Colombie[11]. D’ailleurs, de manière publique, en 1952, le directoire du Parti conservateur avait érigé le communisme non seulement au rang d’ennemi conservateur, mais aussi national, car il menaçait toutes les « forces du bien » du pays Les quatre principaux mouvements insurrectionnels colombiens (FARC, ELN, EPL, M19) apparurent dans les années 1960-1970. De même, dans cette lutte frontale contre le communisme, l’Église catholique joua un rôle central. En 1944, l’évêque de Santa Rosa de los Osos, Miguel Ángel Builes, énumérait les multiples activités communistes dans le pays, prouvant, selon lui, que le pays était la cible de l’infiltration communiste qu’il fallait abattre à tout prix[12].
De cette façon, l’utilisation de la peur sociale et la menace communiste devenaient une arme politique redoutable des élites traditionnelles colombiennes. Sur ce point, Abel Carbonell, une personnalité conservatrice de premier plan, reconnaissait dans les années 1930 que libéraux et conservateurs s’entendaient sur la nécessité de se soutenir pour défendre l’ordre social face au communisme[13]. Sans surprise, un langage guerrier de croisade et de reconquête imprégnait les textes de l’époque. En 1944, à son tour, le futur président conservateur, Roberto Urdaneta, appelait explicitement à une croisade anticommuniste qui devait unir les élites raisonnables des deux partis (Abel,1987). Les élites politiques traditionnelles colombiennes avaient incubé une véritable obsession contre le communisme, qui devint le bouc émissaire par excellence, accusé d’être le principal responsable du désastre et du chaos général.
Dès lors, dans un contexte de radicalisation continentale et mondiale de Guerre froide, la désignation de l’ennemi communiste comme principale menace nationale constituait l’instrument principal mis en valeur par les élites colombiennes pour justifier une politique répressive et excluante. Concrètement, depuis la dixième Conférence panaméricaine de Caracas, en 1954, s’était manifestée, à l’échelle continentale, la volonté de former un front commun continental pour faire face à la pénétration communiste[14]. Naturellement, cette haine anticommuniste s’est accentuée par la suite, par des événements comme la Révolution cubaine et la doctrine de la sécurité nationale, qui ont accentué les antagonismes de la Guerre froide en Amérique latine.
AMALGAME ET STIGMATISATION DES ALTERNATIVES POLITIQUES : L’UTILISATION DE L'ÉPOUVANTAIL « ROUGE » POUR DÉCRÉDIBILISER LES ALTERNATIVES POLITIQUES
Évidemment, cette désignation de l’ennemi communiste fut instrumentalisée par les élites politiques colombiennes, elles en abusèrent pour décrédibiliser toute manifestation réformiste et alternative politique, en les caricaturant immédiatement de « rouge ». En effet, un brassage volontaire fut opéré : on ne distinguait plus entre les groupes insurrectionnels illégaux et les hommes politiques d’opposition qui envisageaient la voie institutionnelle et démocratique. Dans une situation pareille, tout opposant, quelle que soit son idéologie, pouvait être suspecté d’être un communiste ou un guérillero terroriste. En la matière, la Colombie fut une bonne élève dans l’implantation de la doctrine de la sécurité nationale. Sous prétexte de combattre l’ennemi intérieur et la vague rouge, l’État persécuta toute dissidence sans nuances.
Bien qu’il soit incontestable que les idées communistes aient influencé certaines franges des classes populaires et une part importante des dirigeants de gauche, pour autant, une révolution prolétarienne en Colombie n’apparaissait pas comme un horizon réaliste. Indubitablement, le communisme en Colombie ne constituait pas une force capable de prendre le pouvoir, et il a joué un rôle politique secondaire dans la vie politique colombienne. Ainsi, il était clair que le brandissement du « chiffon rouge » permettait l’amalgame de la mobilisation avec la protestation sociale d’un côté, et le communisme de l’autre. Sur ce point, dès 1933, la grande figure de l’aile gauche du parti libéral, Jorge Eliécer Gaitán, qui fut assassiné alors qu’il était au bord de la victoire présidentielle[15], avait déjà mis en garde contre cette stratégie de propagande et de stigmatisation des alternatives de gauche, qui consistait à toutes les assimiler au communisme[16].
À dire vrai, sous l’étiquette communiste diffuse et nébuleuse, toutes les alternatives militantes ont été broyées et agglutinées, depuis les leaders de la société civile aux guérilleros, en passant par les libéraux progressistes ou les sociaux-démocrates. Par ce mécanisme, socialisme, social, communisme, révolution, devenaient des synonymes sur les lèvres des droites colombiennes. Sous le label « rouge », toutes les critiques du régime étaient diabolisées, devenant un signe distinctif de la stratégie des élites colombiennes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Par ce biais, dès qu’apparaissait un mouvement contestataire, critique ou proposant une posture critique au bipartisme, alors immédiatement, il se voyait blâmé par les discours officiels comme agent du Komintern ou de la Révolution cubaine.
En effet, l’autre réflexe régulier utilisé par les élites colombiennes fut de rendre responsables les mouvements de gauche, tant insurrectionnels que démocratiques, de tous les maux. Ainsi, toute réforme qui bouleversait l’ordre dominant était considérée comme une injonction du « communisme international ». Par exemple, le projet social et démocratique de « la Révolution en Marche » de Lopez Pumarejo dans les années 1930, fut dénoncé comme la preuve de la force du communisme international et de la consécration d’un front populaire en Colombie, alors qu’il n’y avait aucun accord programmatique, ni même d’alliance électorale avec le parti communiste colombien. De la même façon, les différentes tentatives de laïcisation de l’éducation, pourtant d’inspiration libérale, furent interprétées comme ordres du communisme[17]. Plus étonnant encore, la mort de Gaitán, homme politique de gauche le plus populaire de l’époque, fut dénoncé, sans preuve, par les élites colombiennes comme le résultat d’une conspiration « rouge » pour créer l’anarchie dans le pays et justifier ainsi une révolution bolchévique[18]. De fait, le 9 avril 1948, en pleine Conférence panaméricaine, l’assassinat de Gaitán déclencha une fureur populaire qui mit le feu à Bogota et provoqua des manifestations de violence dans tout le pays, initiant la sanglante période connue comme la « Violencia »[19]. Tragiquement, cette guerre civile a été la cause d’une violence sanglante qui, entre 1948 et 1953, provoqua la mort de plus de trois cent mille Colombiens. Sans surprise, cette atmosphère de chaos et d’anarchie facilita la reprise en main des forces de l’ordre traditionnelles qui lancèrent une répression sanglante, la justifiant, selon eux, par la nécessité d’éteindre la révolution ordonnée par Moscou.
Bien sûr, dans beaucoup de cas, la dénonciation de la pénétration communiste avait évidemment pris des airs d’exagération pompeuse. Un éminent conservateur comme Aquilino Villegas, en 1936, parlait même de la Colombie comme « du paradis de Lénine »[20]. En 1949, Roberto Urdaneta, activant toujours les mêmes mécanismes de propagande, avait soutenu une fois de plus que la Colombie n’était pas immunisée contre le communisme et que, par conséquent, les forces de l’ordre devaient faire preuve d’une main de fer pour renverser les agents colombiens « de l’impérialisme slave »[21].
À partir des années 1960, face au tournant autoritaire et à la fermeture politique pour les forces de gauche, ce sont les groupes insurrectionnels qui vont être placés au centre de la diabolisation, accusés d’être les principaux responsables de la violence endémique et multidimensionnelle sévissant dans le pays. Ainsi, dans la représentation du conflit interne contre les mouvements révolutionnaires, on peut percevoir clairement une volonté d’accentuer les crimes des guérillas, dans l’optique de décrédibiliser tout mouvement de gauche, tout en ménageant d’une certaine manière, les crimes perpétrés par l’État et son bras armé paramilitaire. Il convient de rappeler que les élites au pouvoir ont utilisé leur mainmise sur les médias aux fins d’exagérer la part de responsabilité des mouvements insurrectionnels dans les nombreux crimes commis dans le pays durant la seconde moitié du XXe siècle. C’est pourquoi, les actions illégales des guérillas ont été amplifiées avec l’arrière-pensée de décrédibiliser tout mouvement apparenté, de près ou de loin, aux courants de gauche. D’ailleurs, cette méthode avait été dénoncée par le prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, dès 1986, dans un texte dans lequel il affirmait que l’État utilisait une stratégie de l’amalgame, créant des boucs émissaires -les guérilleros -, auxquels on adossait tous les crimes sans investigation approfondie[22].
De cette manière, l’État allait profiter de la distorsion de la réalité auprès de l’opinion publique pour se défaire des nombreux crimes d’État dont il était accusé, aidé par de nombreux médias nationaux qui tentèrent de dédouaner les relations de l’État avec les paramilitaires, en présentant ces derniers comme un troisième acteur, un électron libre qui ne pouvait être contrôlé par un État affaibli et victime, lui-même, des terroristes et groupes violents.
Cela traduisait à la fois la peur et la haine face aux contestations sociales, mais aussi une stratégie redoutable : car en diabolisant les alternatives, en essentialisant les divers opposants avec le chiffon rouge, on justifiait, par là-même, leur répression et leur exclusion de la société, afin de rendre impossible l’émergence de toute opposition.
UNE PLOARISATION RADICALE / L'ORIGINE DE L'INTOLÉRANCE ET DE LA VIOLENCE POLITIQUE EN COLOMBIE AU XXe SIÈCLE
Cette haine anticommuniste, à la fois réelle et fantasmée, a radicalisé la polarisation en Colombie, rendant impossible la réconciliation entre deux pôles qui se considéraient mutuellement, non plus comme des concurrents politiques, mais comme des ennemis retranchés dans des postures idéologiques rigides. Ainsi, après un début prometteur au début des années 1930, la voie institutionnelle démocratique qui aurait permis de régler pacifiquement les antagonismes a été sabordée par cette polarisation des esprits et des discours, ne laissant d’autre voie pour la contradiction politique que la violence. Depuis cette rupture, pour les oligarchies repliées dans leurs privilèges, il fallait réprimer par la violence étatique ou paraétatique tout soupçon de mécontentement social qui était synonyme, selon leurs perspectives, de révolution sociale et d’anarchie. À l’opposé, face à cette répression et ce cloisonnement politique, de nombreux militants de gauche prirent le chemin de la rébellion insurrectionnelle et formèrent de nombreuses guérillas à partir des années 1960. En définitive, à partir de l’échec de la voie démocratique s’installait en Colombie une dialectique négative, comprise au sens d’Ardono[23], c’est-à-dire comme un antagonisme sans possibilités de dépassement, qui ne se résout jamais positivement dans une synthèse supérieure pacifique et intégratrice.
Au contraire, en renforçant la tension et l’affrontement permanent contre cet ennemi désigné, se développa la négation progressive de l’altérité politique en Colombie, c’est-à-dire l’effacement des alternatives politiques. Cette haine des élites traditionnelles vers les revendications sociales et politiques a empêché les débats démocratiques et constructifs, cristallisant un fossé rempli de haine, de frustration et de rancœur. Cette polarisation radicale allait entraîner des conséquences néfastes pour l’histoire colombienne dans la seconde partie du XXe siècle, en faisant de la Colombie l’un des pays les plus violents du monde.
C’est pourquoi, en diabolisant l’ennemi communiste qui, par amalgame, englobait aussi les courants progressistes et socialistes, on rendit possible son exclusion, voire la justification de son anéantissement. Alors, après avoir signalé cet ennemi juré, les élites pouvaient matérialiser ce bannissement par des politiques publiques excluantes et répressives, les justifiant par la nécessité d’extirper et de vaincre cet adversaire dangereux. De cette manière, se développait une dialectique ami-ennemi, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, structurant les politiques publiques et institutionnelles autour de la lutte contre les ennemis internes (Schmitt, 2009). En conséquence, l’objectif de gouverner par la terreur devenait une nécessité, et durant la seconde moitié du XXe siècle, il fut possible de percevoir une stratégie globale de l’État pour anéantir les groupes d’opposition, armés ou non.
DE LA MARGINALISATION À L'ÈRADICATION DES GAUCHES COLOMBIENNES
La désignation de l’ennemi communiste comme menace principale s’accompagnait d’une essentialisation des oppositions et d’une marginalisation des gauches colombiennes qui furent progressivement exclues du champ politique, leur fermant les canaux démocratiques. Plus précisément, ce processus s’est déroulé en deux grandes phases : une première étape de marginalisation et d’exclusion du champ politique qui se déroula des années 1930 jusqu’au début des années 1980 ; puis un second cycle d’anéantissement des opposants de gauche, marqué par l’usage du terrorisme d’État et des groupes paramilitaires.
C’est pourquoi il est important de mentionner que l’assaut contre la menace « rouge » ne se borna pas seulement à des déclamations discursives. De manière concrète, il se matérialisa dans de nombreuses lois et décrets qui, au fur et à mesure, sous couvert de lutte contre le communisme, tentaient de limiter ou d’exclure de la vie politique les organisations « suspectes ».
Dans les faits, dès août 1942, Laureano Gómez, devant le Sénat, présentait un projet de loi pour interdire la personnalité juridique aux loges maçonniques considérées comme complices des communistes et des juifs[24]. De même, dans les années 1940, commençait une guerre contre le syndicalisme politique qui était accusé d’être infiltré par les idées socialistes et auquel on reprochait son soutien indéfectible au réformiste Lopez Pumarejo durant les années 1930. C’est pour cette raison que le décret 2513 de 1946 prohibait plusieurs confédérations du travail[25]. Plus explicitement encore, le 7 septembre 1955, fut officiellement approuvée l’interdiction du parti communiste colombien (Martz, 1969). Postérieurement, le Front National qui s’emparait du pouvoir en 1958, poursuivit la fermeture politique, en modifiant la Constitution lors du plébiscite de 1957, qui fit exclure constitutionnellement toute opposition, quelle qu’elle soit. Effectivement, la création du Front National en 1958, entre les deux partis historiques, consacra la répartition bipartite du pouvoir et des postes administratifs, s’accordant sur une candidature commune pour les quatre élections présidentielles suivantes[26]. Par conséquent, cet accord effaça les grandes différences idéologiques entre les deux grands partis dominants depuis l’indépendance au début du XIXe siècle, provoquant une uniformisation antidémocratique en rejetant du champ politique et institutionnel toutes les oppositions, qui se voyaient contraintes de chercher d’autres solutions pour exister politiquement, comme la voie insurrectionnelle.
Pendant un temps, l’exclusion fut suffisante et la violence fut circonscrite aux montagnes et aux zones rurales colombiennes, à savoir loin des grandes métropoles, dans ce que le conservateur Alvaro Gómez définissait comme « les républiques indépendantes »[27]. En revanche, au début des années 1980, voulant la paix et légaliser leurs situations, les différents courants de gauche se réimplantèrent dans les grandes villes, retentant la voie démocratique, avec un certain succès. Sans surprise, ce retour prometteur des gauches réactiva et justifia un durcissement des politiques répressives. De nombreux politiciens et militants de gauche furent assassinés ou durent s’exiler. Cette violence brutale contre les hommes politiques de gauche ou progressistes s’amplifia avec l’apparition de groupes meurtriers comme les cartels de narcotrafiquants et la multiplication de groupes paramilitaires à partir des années 1980.
En définitive, à partir des années 1980, face au développement du pluralisme et à l’apparition de forces politiques d’opposition différentes du bipartisme traditionnel, l’assassinat politique, la torture et les enlèvements devinrent des moyens légitimes de l’action politique. Donc, afin d’éviter les réformes sociales et les turbulences populaires, l’État colombien eut recours aux instruments du terrorisme d’État, considéré comme légitime, car justifié dans ce contexte de polarisation mondiale.
De sorte que, durant la seconde moitié du XXe siècle, se mit en place une stratégie globale de l’État pour anéantir les groupes d’opposition. Plus précisément, à partir de 1980, les opposants furent persécutés, voire exterminés. En effet, on parle d’extermination, car un parti historique d’opposition, l’Union Patriotique (UP)[28], a été victime d’une campagne sanglante de persécution et d’assassinat systématique, certains évoquent même un « génocide avec mobiles politiques »[29], ce qu’a confirmé quelques années plus tard la justice internationale. En effet, le 30 janvier 2023, après trente ans d’attente, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) s’est prononcée en faveur des victimes de l’extermination de cette organisation politique, considérant que l’Etat colombien avait bien été responsable de graves violations des droits de l’homme, commises contre plus de six mille victimes[30].
Sans surprise, entre 1980 et 2010, la Colombie connut sa période de violence la plus sanglante et qui lui avait valu la réputation mondiale d’un des pays les plus violents au monde. Trente années obscures qui cristallisèrent cette haine politique, cette dialectique négative entre forces qui prônaient le changement et forces traditionnelles, saturant le pays de massacres, d’assassinats politiques, de disparitions forcées et de fosses communes. Bien que depuis «la Violencia », la Colombie ait toujours souffert des massacres collectifs et d’assassinats politiques, la situation s’aggrava dans ce contexte sanglant des années 1980 et 1990. Aussi, il n’est pas étonnant que, durant cette période, la Colombie ait souvent été condamnée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour sa responsabilité dans la violation du droit international : soit directement par l’intermédiaire des forces armées ou indirectement en raison de sa complaisance et complicité avec les paramilitaires[31]. Il faut dire que, durant ces années sanglantes, les massacres collectifs s’accompagnèrent d’assassinats politiques à tel point que, rien qu’entre les années 1980 et le milieu des années 1990, le terrorisme d’État avait fait disparaître quelque 25 000 personnalités progressistes et membres de la gauche[32]. De plus, durant cette période obscure, plusieurs candidats présidentiels représentants des gauches démocratiques avaient été assassinés, faussant le résultat des élections[33]. Une violence politique qui, rappelons-le, était encore une réalité récente, puisque lors de l’élection présidentielle de 2018, le candidat de la gauche progressiste Gustavo Petro, qualifié au deuxième tour, avait été victime d’une tentative d’attentat et ne devait son salut qu’à la protection d’une voiture blindée. De plus, il convient de rappeler également que cette stratégie du terrorisme d’État contre les mouvements de gauche va s’étendre au reste de la population, afin de terroriser et de neutraliser le terrain fertile du mécontentement social.
L’ÉPOUVANTAIL « ROUGE », UN PRÉTEXTE POUR JUSTIFER LE TERRORISME D'ÉTAT EN COLOMBIE
Un contexte international de radicalisation politique a permis l’imposition de l’ennemi communiste comme principale menace nationale et continentale. Au fil du temps, cette hantise s’est intensifiée, en raison d’événements de premier plan, comme la Révolution cubaine et l’implantation de la doctrine de la sécurité nationale, qui ont accentué les antagonismes de la Guerre froide. Dans cet ordre idées, au cours des années 1960, dans le cadre continental de l’endiguement du communisme, se sont multipliés les accords de défense entre la Colombie et les États-Unis, comme le plan Lazo en 1932[34] qui renforça la capacité répressive de l’Etat colombien par des progrès militaires, un soutien logistique et une formation de milices civiles armées. À cette fin, des généraux américains ont été envoyés en Colombie, comme le vétéran William Yarborough, qui avait été missionné pour former les forces armées colombiennes à la lutte contre-insurrectionnelle, favorisant ainsi l’éclosion d’embryons paramilitaires[35]. D’ailleurs, sur ce point, en 2001, l’ONG Human Rights divulguait un rapport polémique nommé « Sixième division »[36], qui faisait référence à la connivence et à la complicité entre l’armée colombienne et les groupes paramilitaires et recommandait aux États-Unis de prendre davantage de précautions et de mesures de contrôle sur les aides financières et militaires accordées à l’État colombien, souvent utilisées pour aider ou collaborer avec les groupes paramilitaires responsables de la violation des droits de l’homme.
C’est donc par ce biais, afin d’éviter les réformes sociales et les turbulences populaires, que surgissaient les piliers du terrorisme d’État comme instrument légitime de l’action politique, prétextant des luttes contre des ennemis intérieurs communistes et des narcotrafiquants. Ainsi, alléguant l’urgence du « péril rouge », les autorités colombiennes justifiaient toutes les mesures répressives, excluantes et violentes, rendant possible l’avènement d’un État criminel qui, par la suite, n’hésita pas à assassiner ses opposants. Véritable terrorisme d’État, la « sale guerre » qu’il mena reposait sur trois piliers fondamentaux : les opérations cachées ou clandestines des forces militaires, la mise en place de groupes paramilitaires et une institutionnalisation de la terreur par des lois et des décrets.
En conséquence, on peut retracer durant la seconde moitié du XXe siècle un processus de rationalisation institutionnelle de la terreur étatique. Dans ce sens, pour renforcer l’action répressive en lui donnant une dimension légale, a été normalisé l’usage permanent des états d’exception, alors qu’en principe ils ne devaient être déclarés qu’exceptionnellement. C’est alors dans le cadre de ces états d’exception, que fut élaboré un cadre juridique – décrets, règlements, décisions juridiques, doctrines des forces armées – qui réglementait la violence étatique. Un exemple flagrant de cette institutionnalisation de la terreur fut la genèse de la création des groupes paramilitaires qui, en toute légalité, sous prétexte de lutter contre les guérillas, furent implantés par des décrets datant du début des années 1960. Concrètement, le décret 3398 de 1965 permit, au nom de la défense nationale, d’armer des civils, avant que la loi 48 de 1968 ne pérennise cette pratique.
En définitive, ce réflexe de justifier des actions répressives au nom de la lutte contre l’ennemi intérieur va persister jusqu’à la première décennie de l’an deux mille. Ainsi, le programme politique et sécuritaire dénommé la « Sécurité démocratique » de l’ex-président Alvaro Uribe (2002-2008), va adapter en Colombie l’esprit de la doctrine de la sécurité nationale continentale et de l’ennemi intérieur. En effet, sous couvert de combattre les FARC et les guérillas, la « Sécurité démocratique » va légitimer une terreur d’État contre l’ensemble de la société civile.
CONCLUSION
Dès les années 1930, les élites colombiennes ont commencé à désigner le « péril rouge » comme l’ennemi principal. C’est pourquoi les échos du « danger » communiste ont imprégné avec récurrence les discours et la presse de l’époque. En réalité, l’État colombien profita de cet alibi pour éradiquer toute alternative politique et revendication sociale, constamment amalgamées avec les communistes, les groupes insurrectionnels et la révolution cubaine. Ainsi, le prétexte de la guerre contre l’ennemi interne subversif et communiste cachait une volonté d’anéantir les oppositions et toute contestation sociale, quelle qu’elle soit.
Effectivement, le discours de l’ordre contre l’ennemi intérieur s’est avéré un catalyseur politique efficace afin de légitimer les pratiques autoritaires et l’institutionnalisation de la violence d’État. Ainsi, en Colombie, le terrorisme d’État s’est accompagné d’un discours et d’un cadre juridique et institutionnel qui le légitimaient, en diabolisant les alternatives et instrumentalisant la menace « rouge ». À cette fin, les élites traditionnelles colombiennes ont stigmatisé et empêché toute alternative politique, même les plus modérées.
BIBLIOGRAPHIE
ABEL C., Política, Iglesia y Partidos en Colombia : 1886-1953, 2ª ed. FAES, 1987.
ADORNO T., Dialéctica negativa, la jerga de la autenticidad, Editorial Akal, 2005.
ÁLZATE AVENDANO G., Obras selectas : pensamiento político, Banco de la República, 1984.
CALVO OSPINA H., Colombia, laboratorio de embrujos : democracia y terrorismo de Estado, Foca Ediciones, 2008.
CARBONELL A., Obras selectas, Colección Pensadores Políticos Colombianos, Imprenta Nacional, 1981.
FORERO BENAVIDES A., Por la conciliación nacional : un testimonio contra la barbarie política, Editorial los Andes, 1953.
GAITAN JORGE E., Obras selectas, Camara de Representantes, 1979.
GANDILHON M., La guerre des paysans en Colombie, de l’autodéfense agraire à la guérilla des FARC, Les nuits rouges, 2011.
GOMEZ L., Obras selectas, Cámara de Representantes, 1981.
GRAJALES LOPEZ J., Le pouvoir des armes, le pouvoir de la loi : groupes paramilitaires et formation de l’État en Colombie, Institut d’études politiques, Science Po, 2014.
HOBSBAWN E., ¡Viva la revolucion !, Madrid, Editorial crítica, 2018.
HYLTON F., Colombie les heures sombre, Édition IMHO, 2008.
LAROSA M. et MEJIA G., Una historia concisa de Colombia (1810-2013), Universidad Javeriana, 2013.
MARTZ J., Colombia un Estudio de Política Contemporánea, Universidad Nacional, 1969.
RAMIREZ MORENO A., Dialéctica anticomunista, Ediciones Tercer Mundo, 1973.
SCHMITT C., La notion de politique – Théorie du partisan, Champs classiques, 2009.
WOLF M., La Colombie écartelée, le difficile chemin de la paix, Editions Khartalia, 2005.
[1] MARTIN R., Terreur et terrorisme, Revue juridique de l’Orient, vol. 2, 2005, p.174.
[2] Depuis son indépendance en 1810, les rivalités entre les deux partis hégémoniques, libéraux et conservateurs, ont structuré l’histoire de la Colombie depuis le XIX siècle.
[3] (1937, 16 janvier) Mensaje a los obreros, Haz de fuego, El Fascista. p. 1.
[4] (1936, 4 avril) Una equivocación comunista, El Siglo, p. 1.
[5] GOMEZ L., Obras selectas. Cámara de Representantes, 1981, p. 682.
[6] NARANJO VILLEGAS A., (1936, 20 novembre), Generalísimo Franco, La Tradición, vol. 2.
[7] VAZQUEZ CAEEIZOSA A., (1939, 31 janvier), La pendiente liberal radical marxista, El Siglo. p. 4.
[8] Les quatre principaux mouvements insurrectionnels colombiens (FARC, ELN, EPL, M19) apparurent dans les années 1960-1970.
[9] (1938, 19 février) El comunismo es el enemigo más temible de Colombia, El Obrero Católico. p. 5.
[10] (1939, 4 janvier) Tesis nacionalistas, La Patria.
[11] RAMIREZ MORENO A., Dialéctica anticomunista. Ediciones Tercer Mundo, 1973.
[12] (1944, 16 août) El enemigo: el comunismo, El Obrero Católico. p. 9.
[13] Quincena LXXX, 15 de septiembre de 1936, dans Carbonell Abel. Obras selectas, op. cit., p. 238.
[14] ÁLZATE AVENDANO G., (1954, 5 mars), El frente anticomunista, Diario de Colombia.
[15] Il venait de gagner avec marge les élections législatives et était le grand favori pour la présidentielle.
[16] GAITAN JORGE E., Obras selectas, Cámara de Representantes, 1979 p. 138.
[17] (1936, 14 février) Entre Méjico y Rusia, El Siglo, p. 2.
[18] URDANETA ARBELAEZ R., (1948, 16 mai) Declaraciones sobre la situación política y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, El Espectador. p. 1.
[19] Affrontement sanglant qui, entre 1948 et 1953, a provoqué la mort de plus de trois cent mille colombiens.
[20] VILLEGAS A., (1936, 23 avril) El paraíso de Lenin, El Siglo, p. 5.
[21] URDANETA ARBELAEZ R., Discurso en el restaurante Temel en marzo de 1949, El Siglo, p. 3.
[22] MARQUEZ GABRIEL G., (1986, janvier) Chronique d’une attaque annoncée, Le Monde diplomatique, p 9.
[23] ADORNO T., Dialéctica negativa, la jerga de la autenticidad, Editorial Akal, 2005, 512 p.
[24] (1942, 19 août) Los grandes y verdaderos enemigos de la patria están adentro, El Siglo, p. 1.
[25] ÁLZATE AVENDANO G., (1954, 28 avril) La libertad sindical, Diario de Colombia, p. 3.
[26] GANDILHON M., La guerre des Paysans en Colombie, de l’autodéfense agraire a la guérilla des Farc, Edition les nuits rouges, 2011, p. 114.
[27] Au sein de l’État colombien, en référence aux seize zones sur lesquelles le gouvernement central n’exerçait aucune souveraineté territoriale.
[28] Parti créé en 1984 qui réunissait divers courants de gauche, même des guérilleros qui voulaient revenir à la vie civile. Après des avancées démocratiques importantes lors d’élections, le parti fut victime d’une véritable politique de persécution et d’extermination.
[29] CEPEDA I. et GIRON ORTIZ C., (2005, mai) Comment des milliers de militants ont été liquidés en Colombie, Le Monde diplomatique, p. 26.
[30] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023,30) Comunicado, caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia.
[31] On peut évoquer les cas suivants : Massacre Mapiripan vs Colombie (2005), Massacre de Puerto Bello vs Colombie (2006), le cas des 19 commerçants vs Colombie (2002), Massacre de Ituango vs Colombie (2006), Massacre La Rochela vs Colombie (2008), Massacre Santo Domingo Vs Colombie (2012) et d’autres.
[32] OSPINA CALVO H., (2003, avril) Les paramilitaires au cœur du terrorisme d’État colombien, Le Monde diplomatique, p. 10.
[33] On peut citer Jaime Pardo Leal, candidat de l’Union Patriotique assassiné le 21 octobre 1988. Quelques années plus tard, un autre candidat présidentiel issu du même mouvement, Bernardo Jaramillo, est assassiné le 22 mars 1990. Luis Carlos Galan, représentant d’un libéralisme progressiste, est assassiné par les cartels et la classe politique le 18 août 1989. Le 26 avril 1990, l’ex-guérillero du M 19 reconverti en candidat présidentiel Carlos Pizarro et assassiné.
[34] Plan Lazo (Latin America Security Operation). Accord militaire avec les États-Unis, qui a été mis en place à partir de 1962, dans le cadre de la stratégie contre-insurrectionnelle en Colombie, sous le gouvernement de Guillermo León Valencia et son ministre de la défense, le général Alberto Ruiz Novoa.
[35] (2009, 18 juin) Colombia para los americanos », El Espectador, p. 2.