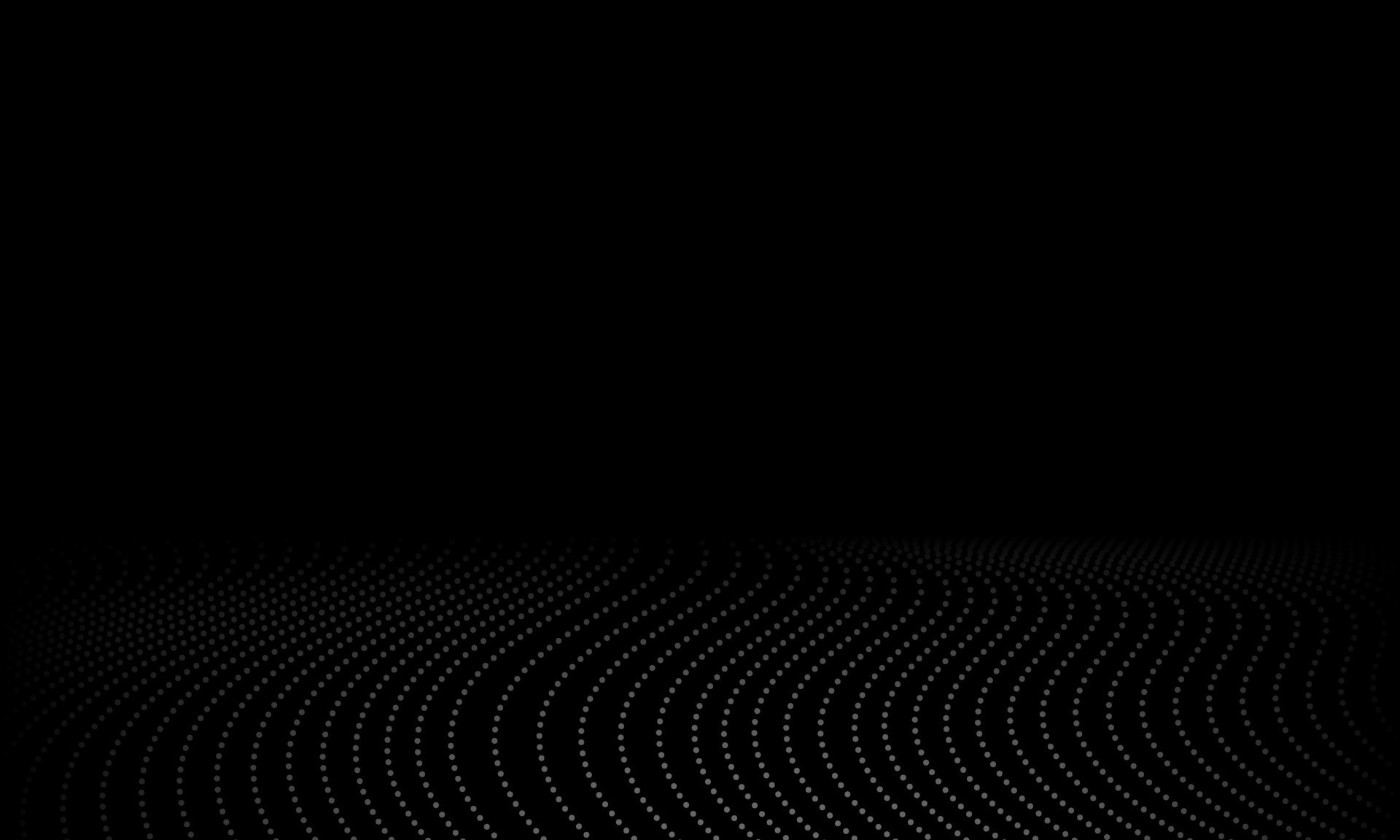Par Denis Fleurdorge, Professeur au département de sociologie de l’université de Montpellier Paul-Valéry, et membre du LEIRIS.
Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, grand serviteur cathodique devant l’Éternel médiatique, est une figure paradigmatique qui s’inscrit dans une des grandes liturgies de la télévision. Il aura tenu le « 13 heures » de TF1 pendant plus de 30 ans[1]. Du lundi au vendredi entre 13h. et 13h.30, c’est le même rituel. Son apparition médiatique remonte à la fin des années 1980 au moment de la recomposition du paysage audiovisuel français et de l’avènement de nouvelles manières de présenter et de promouvoir l’information.
En effet, Jean-Pierre Pernaut hérite du créneau jusque-là tenu par une « bête médiatique » Yves Mourousi. L’héritage est lourd, d’autant que paradoxalement, même si le style de la présentation du journal de la mi-journée avec Mourousi semble avoir été renouvelé et parfois verse dans l’impertinence, le ton général reste néanmoins dans un certain conformisme. Ceci peut se comprendre puisque que la « première chaîne » de télévision française a longtemps été l’emblème d’une diffusion de l’information sous contrôle politique de Charles de Gaulle à Valéry Giscard d’Estaing. Cette chaîne bien que privatisée sous la Gauche, et entrant dans une logique commerciale et concurrentielle, n’en demeure pas moins liée avec les pouvoirs politiques. La rupture avec le pouvoir n’est pas consommée puisque l’acheteur, le groupe de BTP Bouygues, bien que s’ouvrant et se diversifiant vers les marchés de la communication et des médias, n’en demeure pas moins le premier maître d’œuvre de la politique des « Grands travaux d’État » du président Mitterrand et de bon nombre de ses successeurs (pont de l’île de Ré, pont de Normandie, Arche de la Défense, Grande Bibliothèque Nationale, stade de France, etc.). In fine, la chaîne garde l’empreinte d’une certaine proximité avec les pouvoirs dans une singulière neutralité, pour le dire pudiquement, qui l’« oblige ».
LES TROIS RUPTURES JOURNALISTIQUES
Jean-Pierre Pernaut ne laisse pas indifférent suscitant rejet et mépris ou reconnaissance et adhésion. Il impose obligatoirement en un premier trait de coupe bien clair et bien nette entre trois parties distinctes : une inversion des hiérarchies des thématiques et des manières de présenter des sujets ; un rééquilibrage dans la manière de traiter des informations nationales et régionales ; la distinction entre culture « élitiste » et culture « populaire ». Comme le soulignent à juste titre Pierre Leroux et Philippe Teillet : « Il réactive les oppositions anciennes entre des médias à destination d’un public cultivé et ceux ciblant un public “populaire”, exacerbées en France par la domination de plus en plus forte de la télévision sur l’ensemble des autres types de médias »[2].
Première rupture : l’inversion de la hiérarchie des informations
C’est Pernaut qui va opérer, discrètement, la première véritable rupture entre l’information télévisée « voix de son maître », héritage de l’ORTF[3], tout en développant une « nouvelle information » plus soucieuse de proximité avec les téléspectateurs. Par une sorte de « dé-institutionnalisation » de « certaines » informations, il réussit progressivement à trouver une justesse de ton et une autonomie de contenu. Traduit en langage des médias, cela signifie une augmentation du taux d’audience et des parts de marché. Il relègue les informations politiques en milieu de journal et ne rend plus compte systématiquement du Conseil des ministres du mercredi. Et puis, quelle que soit l’actualité politique, sociale, économique, le journal s’ouvre avec le temps qu’il fait : l’état météorologique de la France[4]. Le temps qui fait est le temps qui va – weather is time. Autre incongruité notable, le journal est fermé avec le temps de l’argent : les cours de la Bourse. Au-delà de cette petite révolution formelle, il a su saisir la transformation des mentalités sur la question de l’environnement et de l’écologie. Michel Houellebecq souligne parfaitement cette intuition :
Le trait de génie de Jean-Pierre Pernaut avait été de comprendre qu’après les années 1980, fric et frime, le public avait soif d’écologie, d’« authenticité », de « vraies valeurs ». Même si Martin Bouygues pouvait être crédité de la confiance qu’il lui avait accordée, le journal de 13 heures de TF1 portait entièrement la marque de sa personnalité visionnaire. Partant de l’actualité immédiate – violente, rapide, frénétique, insensée – Jean-Pierre Pernaut accomplissait chaque jour cette tâche messianique consistant à guider le téléspectateur, terrorisé et stressé, vers les régions idylliques d’une campagne préservée…[5]
D’un point de vue sociologique, Leroux et Teillet montrent qu’une hiérarchie s’impose dans une forme de priorité du proche sur le lointain, du quotidien sur le politique, du social sur l’économique, du banal sur le scoop :
Le succès venant, la séparation relativement nette existant au début entre le récit de l’actualité “chaude” et la partie magazine tend à s’estomper et à faire de ce journal télévisé un modèle de réussite par l’adéquation qu’il semble opérer entre des contenus et un public. Renversant de façon ostentatoire des hiérarchies légitimes (le journal commence toujours par un rappel du temps qu’il fait), traitant l’actualité noble (politique, économique ou sociale) très brièvement et sans jamais se situer dans la logique du scoop, passant allègrement du fait au commentaire pour des nouvelles, il est vrai, sans grande portée, construisant son succès en dehors de tous les principes de légitimation du champ journalistique – directs (il n’a jamais été consacré par la profession et selon lui “le seul sondage qui compte c’est l’audience”, Libération, 14 octobre 1994) ou indirects (il n'y a jamais d’invité, ni d’interview de personnalité politique ou culturelle, par exemple)[6].
Incidemment, et par une sorte de continuité, cette manière de séparer ou de se séparer de l’« actualité chaude » ou du « scoop » au profit d’une proximité des préoccupations quotidiennes, d’une empathie des conditions de vie des « français », a contribué à l’écarter des autres formes de journalisme, voire des journalistes. Leroux et Teillet résument parfaitement ces « effets » par la violence des qualificatifs utilisés pour le définir : « Créant puis améliorant imperceptiblement les recettes qui ont fait son succès, ce journal et son présentateur représentent le négatif de toutes les valeurs mises en avant par la presse écrite à destination du public cultivé. Ainsi Le Monde (13 novembre 1999) propose de se désinfecter après l'avoir vu, Télérama le surnomme “L'idole du village” (9 décembre 1998), et Libération (14 octobre 1994) titre sa chronique télévision sur “l'overdose de Pernaut” »[7]. La liste est loin d’être exhaustive !
Deuxième rupture : l’harmonisation entre un centre et une périphérie multiple
Une deuxième rupture est à porter au crédit de Jean-Pierre Pernaut en ces débuts des années 80 avec une concurrence sauvage et une tyrannie de l’audimat. La première concurrence, à laquelle il s’attèle, est celle de la chaîne, encore d’État, que l’on nommait au début la 3ème chaîne couleur[8] (FR3). Sur le modèle de cette chaîne d’État, qui dispose de moyens audiovisuels considérables dans chaque région de France, il va développer et tisser un réseau de correspondants en province en s’appuyant sur la presse régionale, y compris dans les Départements et Territoires d’outre-mer. Comme le souligne la journaliste Catherine Pacary : « […] Jean-Pierre Pernaut a l’idée de créer un réseau de correspondants (aujourd’hui composé de 19 bureaux et 150 journalistes. Résultat, cinq mois après son arrivée, son “13 heures” passe devant celui d’Antenne 2 »[9]. Cette création n’est donc pas originale dans sa forme mais a le mérite d’offrir une structure plastique pouvant « coller » aux réalités locales du moment. Et comme on a pu le signifier précédemment, il y a une sorte de rupture entre le JT de « 13 heures » et la presse écrite parisienne principalement. Ce qui est vrai pour la presse parisienne, ne l’est pas pour la presse régionale puisqu’elle est toujours associée, présentée, louée dans toutes les incursions régionales du JT. On peut même ajouter que cette presse régionale se porte beaucoup mieux, en niveau de tirage, en nombre de lecteurs et financièrement, que la presse parisienne quasiment subventionnée à 100%, directement ou indirectement par l’État.
Ainsi, Jean-Pierre Pernaut réconcilie la Province avec Paris, la ruralité avec l’urbanité, les Régions avec leurs traditions. Comme on le verra, il s’agit plus d’un rapport dialogique que dialectique. En ce sens, Il restera le gardien des « Marronniers ». En bon arboriculteur ou gardien du verger de l’information, il aura donné ses lettres de noblesse à une activité journalistique considérée souvent comme secondaire et dépréciée. En effet, dans le jargon des journalistes le « marronnier » est un reportage ou un article dont le sujet présente un caractère répétitif et connu dans leur accomplissement. Souvent ce sont des articles de transition entre deux sujets, un moyen aussi de combler l’interstice d’une information générale peu importante. Avec Jean-Pierre Pernaut le « marronnier » s’est transformé en un « sujet de proximité » à part entière. Il renvoie à des émotions personnelles, au partage de souvenirs collectifs, voire d’une intimité vécue dans la richesse et la diversité des provinces françaises. Pour incarner humainement et intensifier en émotions les sujets, sont convoqués au présent de la mémoire les « vieux métiers » (sabotier, forgeron, coutelier, ferblantier, tonnelier, maréchal-ferrant, orfèvre, souffleur de verre, vitrailliste, luthier, facteur d’orgue, etc.), les quatre saisons dans les jardins et les potagers (la préparation des jardins l’hiver et la nature endormie, les premiers semis de la fin d’hiver, les plantations du début de printemps, les premières récoltes de printemps, l’été avec l’explosion des fruits et légumes, l’importance de l’arrosage les dernières récoltes d’automne), les vacances (avec l’arrivée au camping du « Pylone » à Antibes, puis avec la série populaire des films Camping[10] ce sera le camping de la « Dune » à Pyla-sur-Mer près d’Arcachon), la première rentrée des classes, les carnavals, les marchés, etc. La liste est loin d’être exhaustive. Nous sommes ici au-delà d’une routine mais dans l’entretien de la mémoire populaire des « gens de peu »[11].
Houellebecq a parfaitement saisi cette qualité d’un « commun anthropologique » en la définissant comme une dimension essentielle de ce qu’il synthétise sous la forme du « progrès lent » : « Par sa manière de dater systématiquement l’apparition des différents artisanats qu’il décrivait, les progrès majeurs intervenus dans leur pratique, Jean-Pierre Pernaut semblait moins se faire l’apologiste de l’immobilisme que celui du progrès lent »[12]. Il reprendra cette thématique du « progrès lent » de manière plus confuse lors d’un entretien avec la journaliste Nelly Kaprièlian, du journal Les Inrockuptibles en répondant à une question sur la place de Jean-Pierre Pernaut dans le paysage médiatique :
Oui. C’est très important dans l’histoire de la télévision française et même de la France… Y a des… J’ai entendu dire à un moment donné…Enfin à un moment donné, ça montre bien la pathétique capacité en fait du milieu intellectuel français à penser l’état réel de la société, Jean-Pierre Pernaut était défini comme pétainiste, ce qui est vraiment… En fait, Jean-Pierre Pernaut, c’est l’avenir économique de la France, c’est la réutilisation commerciale, touristique du territoire français qui effectivement ce qui vaut très cher, ce qui va valoir très cher et que les étrangers vont nous acheter très cher… En fait, la France qui gagne, c’est les fromages, c’est la charcuterie de pays, c’est les hôtels de charme, c’est la réfection de manoirs. C’est ça qui va nous valoir des touristes venus d’Inde, d’industriels indiens ou chinois, c’est l’avenir économique de la France, et donc Jean-Pierre Pernaut par une espèce d’acte de génie a compris tout ça dès l’extrême fin des années 80. La France qui gagne, c’est pas Airbus, c’est pas le TGV, c’est le relais du Haut Cézallier… […][13].
Non seulement Jean-Pierre Pernaut est l’apôtre du « progrès lent » mais aussi en constituerait l’expression visionnaire puisque le progrès n’est pas à rechercher dans la technologie et ses innovations sophistiquées mais dans la valorisation d’un patrimoine régional : la « désindustrialisation » de la France au profit d’une industrie du touristique locale et de masse.
La troisième rupture : une culture « populaire » contre une culture « élitiste »
Souvent dépeint comme un présentateur « populaire », plus qu’un journaliste, comme un personnage « franchouillard » voire « populiste », les propos à son égard peuvent être d’une rare violence comme le fait remarquer Pierre Marcelle :
Ainsi le “Treize heures” de TF1 est-il devenu ce JT RPR-FNSEA, crypto-pétainiste, ombilic des champs à destination prioritaire des ruraux goûtant la soupe dans le reflet d’un récepteur posé sur la cheminée comme un chromo d’Angélus de Millet, comme une horloge battant un autre temps – fiction de paix, ersatz de veillée d’antan, rêve de nation ilienne protégée des massacres algériens ou de la guerre civile cambodgienne par l’océan tiédasse du verbe de Jean-Pierre Pernaut...[14].
Si le propos reste dans un registre ironique et fortement critique, il exprime parfaitement les trois formes de ruptures instituées par Jean-Pierre Pernaut dans sa manière de présenter l’information. Pernaut n’est pas un journaliste neutre. Il agace ses confrères puisqu’il ne cherche pas à adopter la posture/imposture du journaliste neutre et impartial. Sans revendiquer ouvertement une opinion politique claire et précise, il reste imperturbable sur son positionnement valorisant une tradition et un patrimoine clairement identifiable. Nous verrons que derrière cette apparence, presque lisse, se dissimule un positionnement politique bien réel.
Originaire d’Amiens, il ne manque jamais de marquer son attachement à sa ville et à sa région, d’un père « centralien » et chef d’entreprise (mécanique et machines-outils) et d’une mère pharmacienne. Il est un représentant de l’aristocratie des journalistes présentateurs d’information puisque diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, l’une des meilleures écoles de journalisme en France. Petite touche française, il est marié à Nathalie Marquay qui fut Miss France 1987.
Jean-Pierre Pernaut est un catalyseur, il rendit possible ce qui ne l’aurait été spontanément. Il relie, dans une perspective simmelienne[15], ce qui est séparé pour lui donner un sens accessible par tous. Pernaut permet non seulement d’établir un lien, mais aussi d’offrir un franchissement provisoire et éphémère entre des formes sociales discontinues. Il concilie et réconcilie pour unifier. Autrement dit, dans un monde social et économique qui est d’une violence parfois indiscernable et indomptable qui tente toujours de s’affranchir de toutes limites, Jean-Pierre Pernaut rétablit les ultimes points de repères sociaux immatériels et matériels : les fêtes, les carnavals, la météorologie, les marchés, les jardins et les potagers, les artisans et les métiers d’art, les chants et musiques régionales. Il pose des jalons et rétablit les bouées cardinales d’une vie sociale harmonieuse et parfois surannée. L’« instabilité symbolique » des institutions, le « polythéisme des valeurs » (Weber) se trouvent dépassés par un système d’exposition dialogique s’exprimant par des jeux d’oppositions entre la capitale/la province, la ville/la campagne, le temps qui va/le temps qu’il fait, la modernité/la tradition, l’économique/le social, voire le populaire/le populiste. Mais il ne faut peut-être pas en tirer des conclusions hâtives, comme si un tel parti pris relevait d’une identification politique simple et univoque comme le soulignent Leroux et Teillet : « Ce regard sur le passé, l’attachement au terroir, la peur de l’ouverture et du changement, que l’on peut associer à coup sûr à une certaine forme de “conservatisme” au sens propre du terme, peuvent trouver aujourd'hui comme hier des traductions politiques multiples et contradictoires »[16].
UNE NEUTRALITÉ ET UNE IMPARTIALITÉ DE DROITE
Si le métier de journaliste est un métier exposé à plus d’un titre, il est de bon ton, surtout dans les médias du service public, de revendiquer une certaine neutralité et impartialité. S’ajoute un affichage systématique d’une volonté de « décrypter l’actualité » selon le mantra sempiternellement répété comme un gage de sérieux et un satisfecit d’objectivité sur ce que serait la bonne compréhension d’un fait journalistique. Tout ceci relève d’un vœu pieu si ce n’est d’une forfaiture. En effet, il n’est pas honteux, voire même recommandable, que tout journaliste s’affiche comme producteur d’une d’opinion, d’un point de vue, d’une subjectivité assumée, surtout dans cette finalité professionnelle de vouloir « décrypter l’information ». Cela ne signifie pas que les journalistes doivent être affilié à un parti politique ou revendiquer une idéologie mais simplement exprimer et assumer un sentiment et une pensée personnels à un moment donné dans un contexte donné sur des faits précis. Ils peuvent tout simplement s’inscrire dans une ligne éditoriale comme c’est le cas pour la presse quotidienne (Le Monde, Libération, Le Figaro, etc.).
L’objectivité, sans entrer dans un long et complexe débat sur la construction épistémologique d’un fait, n’est pas possible pour un « fait journalistique » (une information). La rapidité et l’urgence de la transmission de l’information sont incompatibles avec une démarche sociologique – explicative, compréhensive, interprétative. Les journalistes choisissent un fait ou un événement, le cadre (en image, en discours), le commente et le transmettent (par l’écrit, par l’image, par le son). C’est un travail à chaud dont la finalité est d’informer mais pas de transmettre de la connaissance. Dans un tel protocole de pratique, choisir, cadrer, commenter, transmettre, il devient difficile d’affirmer ce que sont les « nouveaux faits sociaux », les « nouveaux faits de société », les « faits de société ». Ce sont des notions de journaliste pas de sociologue.
La sociologie demande du temps, du recul, une construction de l’objet, l’élaboration et la vérification d’hypothèses. Dans une démarche de « chercheur débutant », mais qui peut aussi être valable et illustratif pour un journaliste, Pierre Bourdieu nous donne un éclairage parfait sur la problématique qui se joue en termes épistémologiques et plus largement sur la production de connaissances scientifiques : « Nombre de sociologues débutants agissent comme s’il suffisait de se donner un objet doté de réalité sociale pour détenir du même coup un objet doté de réalité sociologique : sans parler des innombrables monographies de village, on pourrait citer tous ces sujets de recherche qui n’ont pas d’autre problématique que la pure et simple désignation de groupes sociaux ou de problèmes perçus comme conscience commune à un moment donné du temps »[17]. Le métier de journaliste, n’est pas celui de sociologue. Il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie entre ces deux activités, mais juste de signaler la différence entre deux métiers aux attendus et finalités différentes, et parfois complémentaires. Pour éviter toute animosité, il faut reconnaître que des enquêtes d’investigation (sur une longue durée) peuvent être assimilées à de véritables enquêtes sociologiques.
Pour Houellebecq tout commence par un refus, presque une position étique : « […] Jean-Pierre Pernaut s’était toujours refusé à réinvestir son immense notoriété dans une tentative de carrière ou d’engagement politique ; il avait voulu, jusqu’au bout, rester dans le camp des entertainers »[18]. Certes, il y a un refus d’engagement politique mais cela n’exclue en rien un positionnement politique sur la base de conviction parfaitement assumées. Et comme le souligne la journaliste Sarah Lecœuvre :
En homme de conviction, la star de TF1 ne lésinait jamais sur les coups de gueule. Il suffisait de regarder son JT pour connaître le fond de sa pensée. Une oreille attentive pouvait déceler dansses lancements, tous rédigés sur feuilles et jamais au prompteur, une remarque acerbe. En 2016, il oppose par exemple les sans-abris aux migrants, ce qui lui avait valu une remontrance du CSA. Deux ans plus tard, il se prononce contre la réforme de la Sécurité routière sur la limitation à 80 km/h et, pendant le confinement, il ironise à sa manière sur certaines mesures prises depuis le début de l’épidémie de coronavirus[19].
Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas laissé envoûter par les sirènes de l’infotainment, c’est-à-dire l’union contre nature de l’information et du divertissement – « infodivertissement ». Même si parfois il semble faire la « retape » pour l’office du tourisme de telle ou telle ville, il a toujours un plaisir esthétique et gourmant (avec souvent des reportages sur les spécialités gastronomiques) à faire découvrir une diversité et une originalité de ce qui constitue une tradition française. Sa jubilation est souvent l’expression d’un paroxysme de sa joie lorsqu’il évoque sa région d’origine la Picardie et sa ville d’Amiens. Houellebecq va encore plus loin puisqu’il lui trouve une proximité intellectuelle avec William Morris :
Il y avait peut-être, se dit Jed, des points de convergence entre la pensée de Jean-Pierre Pernaut et celle de William Morris — ancrage socialiste mis à part, bien entendu. S’il était situé par la plupart des téléspectateurs comme étant plutôt à droite, Jean-Pierre Pernaut s’était toujours montré, dans la conduite quotidienne de son journal, d’une prudence déontologique extrême. Il avait même évité de paraître s’associer à l’aventure Chasse, Pêche, Nature, Traditions, mouvement fondé en 1989 – un an tout juste après qu’il eut pris le contrôle du 13 heures de TF1[20].
Ainsi, le sociologue possédant tous les attributs de la connaissance de sa science peut se prévaloir, à plus ou moins juste titre, d’une position privilégiée – institutionnelle et reconnue et d’une certaine condescendance sociale, voire de classe non dissimulée. Il est donc « celui qui sait », et qui peut s’autoriser de dire, d’entrée de jeu, tout le mépris qu’inspire Jean-Pierre Pernaut : démagogue, conservateur, « réac’ », poujadiste, pétainiste, etc. Bien évidemment le propos va faire hurler dans les chaumières universitaires, et sans offenser l’homme, Pernaut n’est pas un universitaire, ni un intellectuel mais indirectement il participe d’une connaissance, plus intuitive que construite, d’une nécessité de la valorisation d’une économie intime des sociétés. Cette « valorisation » implique de fait la production d’une connaissance de ce qu’est la société, à un moment donné et dans un contexte donné, et qui révèle par petites touches une véritable « économie intime » faite de solidarités courtes, d’entraides spontanées, de bénévolat, d’associations, de collectifs, de traditions communes et partagées. C’est par exemple le facteur qui apporte le courrier mais aussi des médicaments ou du pain auprès de personnes souvent âgées et très isolées, c’est un groupe de passionnés qui s’investit dans la restauration d’un vieux lavoir, c’est un commerce de village tombé en désuétude repris par un « jeune couple » et qui offre de multiples services outre celui de base, c’est l’initiative d’une commune qui décide de produire l’intégralité de son électricité, ce sont les petits marchés ou halles comme autant de machines à produire des relations sociales. Les grands moments de communion ne sont pas oubliés avec non seulement les fêtes religieuses et les processions, mais aussi les plus profanes avec les festivals locaux célébrant des activités ou des productions spécifiques. Il est vrai que c’est moins ambitieux que de vouloir « changer la société » ou « sauver la planète » mais surtout cela montre que face à l’impéritie des politiques publiques centralisées, désincarnées, techniciennes, obnubilées par le moindre coût et la rentabilité maximale, il existe des forces modestes mais efficaces qui réussissent à préserver ce qui a été reçu, et qui doit être rendu et enrichi, parce que le passé – ce qui est transmis en indivision, n’est jamais parfait.
Tout ceci, in fine, est loin d’une forme de conservatisme ou de vision réactionnaire, puisqu’il s’agit d’un « mécanisme spontané » – actions collectives qui poussent des individus partageant une même « concrétude », un même attachement à ce qui constitue les « besoins de l’âme » pour rester dans l’esprit de Simone Weil. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, n’est pas un dangereux idéologue faisant le jeu du Rassemblement national et voulant revenir à un l’âge d’or des mythes du « jadis » et du « c’était mieux avant ». Il n’adopte pas une posture, c’est un passeur et un catalyseur. Il rend possible les manifestations des « forces sociales » qui font le quotidien d’acteurs partageant un même espace et un même temps. Effectivement, il ne traite pas des questions internationales sauf lorsqu’il s’agit d’attentat ou de grandes catastrophes naturelles ou industrielles, mais cela reste un choix éditorial comme un autre, sur une chaîne privée, avec un journaliste libre et qui assume son cadrage et sa subjectivité, et sans fausse prétention à une quelconque impartialité et neutralité. C’est une position assumée dont s’exclue la duperie qui serait de prétendre à délivrer une vérité, alors qu’il s’agit, presque anthropologiquement, d’offrir un regard sur des manières de « penser », de « sentir » et d’« agir ».
Il faut aussi se rendre à l’évidence, personne n’est obligé de suivre le journal de 13 heures sur TF1. Dans une société du zapping et du next, c’est une chaîne privée à l’ambition de fournir du « temps de cerveau disponible »[21] pour les publicitaires et qui offre une véritable rencontre populaire. Il ne s’agit pas de justifier le « 13 heures » de Jean-Pierre Pernaut, mais de porter un regard sociologique sur un « fait social » qu’il convient de construire en tant que tel avant tout jugement idéologique, politique, voire « épidermique ». II est regardé et écouté sans obligation, sans contrainte de manière massive avec des records d’audience comme en novembre 2013 avec 8,1 millions de téléspectateurs ce qui correspond à presque 42% de part de marché[22]. Il devient une construction sociologique possible. Que veut-on savoir de sociologique sur le potentiel phénomène social Jean-Pierre Pernaut, d’autant qu’il restera une inconnue de taille en ce qui concerne la « logique de réception » ? Autrement dit, pourquoi des millions de téléspectateurs le suivent ? Pourquoi provoque-t-il des effets en termes de mobilisations individuelles et collectives, voire politiques ?
Ainsi, au-delà de la seule prestation télévisuelle, le « fait social » Pernaut trouve même des prolongements et des applications dans la vie sociale courante au Journal de 13 heures de TF1 en l’utilisant comme moyen de diffusion de masse. Conséquence directe suite au constat journalistique récurrent de la disparition de commerces dans le monde rural, c’est la mise en place, en 1993, de « SOS villages », sorte de bourse aux offres mettant en relation des demandes locales de reprise de commerces, de cafés, de restaurants, etc., suite le plus souvent à un départ en retraite ou d’absence de successions. Cette initiative, prolongée au-delà de Jean-Pierre Pernaut, a rencontré, contre toutes attentes et bien des railleries, un vif succès puisque chaque jour sur un site dédié sont proposées plus de 10 000 annonces en ligne. Dans la même veine, en 2018, sera mis en place un concours annuel « Votre plus beau marché ». Il s’agit pour les téléspectateurs de voter pour le plus beau marché de France après un reportage de présentation. « Beau » en termes de convivialité, de diversité, de traditions locales, d’histoire. Tout ceci peut bien sembler futile, mais les élus ont compris les enjeux d’une telle publicité pour l’image d’une ville, pour le développement local, pour le tourisme, pour la reconquête de nouveaux habitants. Obtenir le label « Votre plus beau marché de France » s’ajoutera à celui de « Villes et Villages Fleuris »[23]. Loin de la vision d’une société sans solidarités, « anomique », déstructurée, apparaît l’image d’une France rurale « amoureuse » de son patrimoine, de sa qualité de vie, de ses traditions et spécificités, mais aussi inquiète pour son avenir : désertification démographique, perte des administrations publiques, perte des écoles, non renouvellement générationnel.
Pour nuancer le propos et ne pas laisser penser que l’auteur se livre à une apologie qui tournerait un éloge de Jean-Pierre Pernaut, il convient de souligner que le journaliste n’est pas exempt de « petits travers » qui affirment une manifestation subjective et orientée. Il déteste les grèves, les impôts, l’argent public gaspillé[24], l’État, les migrants, et comme le rappelle le journaliste François Rousseaux :
La mondialisation et le libre échange l’effraient. Il déteste le désordre, les manifs, l’administration. Préfère Johnny, Sheila et les courses automobiles. Il défend les chasseurs, les 90 km/h, les petits commerçants. Le prix de l’essence ou la fermeture d’une classe l’obsèdent au point d’en faire l’ouverture de ses JT. Un pari gagnant : en vingt ans son journal passe de 2 à 7,5 millions de téléspectateurs, dessinant une France intemporelle, pétrie de nostalgie[25].
Il présente dans des rapports oppositionnels et négatifs le rural et l’urbain, la modernité et la tradition, la France et l’Europe, ce que Leroux et Teillet note comme une totale inversion avec les pratiques journalistiques habituelles :
À l’inverse des grands médias de presse écrite parisienne, mais aussi de la plupart des autres chaines de télévision, le journal de TF1 laisse une place très importante à la vision d'un pays que l’expression « France profonde » permettrait de désigner de manière caricaturale, autant par son incontestable authenticité que par son arriération et le peu de prise qu’elle offre à la modernité. Pour autant, le fantasme identitaire décliné dans le journal rejoint à la fois les fondements de l’identité française et certaines formes plus modernes de manifestations d’un attachement identitaire local que ce journal présente sous les aspects d’un combat pour la préservation de traditions ou de valeurs qui font l’identité des “régions” (au sens ancien du mot). Le pendant négatif et menaçant de ce pays idyllique est représenté par la bureaucratie étatique (les services fiscaux notamment) ou supranationale (l’Europe économique), Paris et ses élites politico-administratives ainsi que les zones urbaines en général comme lieux propices à la prolifération du désordre social[26].
Jean-Pierre Pernaut manifeste un certain manichéisme, ponctuant souvent la fin du déroulement d’un reportage, avec un petit claquement de langue et un œil noir, et surtout d’une remarque acerbe ou d’un commentaire ni goguenard, ni ironique. Tout ceci s’inscrit dans une logique où le proche sera toujours supérieur au lointain, le concret à l’abstrait, le simple au compliqué, sorte de « sens commun », « ce qui va de soi » et qui fait appel à la perception immédiate et à la sensibilité individuelle. Leroux et Teillet résument parfaitement cet état de fait :
Une telle grille de lecture du réel privilégie le proche plutôt que le lointain, le connu plus que l’inconnu, le concret plutôt que l’abstrait, les explications simples sur les causalités multiples, la vérité du “terrain” et de ses habitants aux points de vue extérieure. Ainsi, à titre d’illustration, l’instauration du couvre-feu dans certaines villes de Pologne est présentée comme une possible solution à la violence urbaine en France, la parole d’un autochtone est opposée aux analyses chimiques de propreté des eaux effectuées dans le cadre européen, la prime de naissance aux parents “français” décernée par une ville dirigée par le Front National devient un cadeau “aux heureux parents”, la question de la réduction du temps de travail traitée de manière univoque comme une menace pour les entreprises et la réglementation européenne sur la chasse une atteinte aux traditions ; tous ces exemples, relevés ou non par la presse cultivée, sont servis, selon son auteur, par “un style journalistique le plus concret et le plus direct possible” (Libération, 14 octobre 1994)[27].
L’« ENRACINEMENT » CONTRE LE « DÉRACINEMENT »
De la désolation à la consolation
La grande philosophe Simone Weil, commence la deuxième partie de son ouvrage L’enracinement, par le « déracinement ». Plus précisément, elle décline les différentes formes de déracinement à l’œuvre dans nos sociétés comme le déracinement de l’ouvrier, celui du paysan ou encore de la Nation. Toutes proportions gardées, et la limite est rapidement franchie, le « journal de 13 heures » de Pernaut, expose sous différentes formes et thématiques une vision d’une France « déracinée ». Avec les « petits tracas du quotidien » comme l’augmentation de la facture du chauffage au moment du remplissage de la cuve de fuel, la disparition d’un service public ou d’un commerce, le prix élevé des légumes ou de la viande il offre une vision du « déracinement » non seulement comme une perte mais aussi comme un élément de comparaison, presque anthropologique, entre « ceux qui ont » et « ceux qui n’ont pas », « ceux qui bénéficient des commodités » d’une société intégrée et « ceux qui en sont exclus » presque ontologiquement. Si le déracinement est là, comment concevoir ce que peut être l’enracinement ? Comment éviter sa perte ? Comment retourner à une forme d’enracinement ?
Sans entrée dans le détail de la richesse de la pensée de Simone Weil, ce qui doit être premier et essentiel pour comprendre la notion d’enracinement, et pour ne pas tomber dans une sorte de nostalgie d’un passé ou un grand retour en arrière, réside dans la nécessité de considérer l’enracinement comme le besoin le plus important :
L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie[28].
En généralisant, l’enracinement est d’abord un réseau racinaire constitué d’un lieu, d’une filiation, une activité sociale reconnue assurant une stabilité, et ensuite une forme morale et spirituelle. À partir de cet « état contextuel », Simone Weil va développer un principe articulant « besoins vitaux » ou « terrestres » et les « besoins de l’âme » :
La première étude à faire est celle des besoins qui sont à la vie de l’âme ce que sont pour la vie du corps les besoins de nourriture, de sommeil et de chaleur. Il faut tenter de les énumérer et de les définir. Il ne faut jamais les confondre avec les désirs, les caprices, les fantaisies, les vices. Il faut aussi discerner l’essentiel et l’accidentel. L’homme a besoin, non de riz ou de pommes de terre, mais de chauffage. De même pour les besoins de l’âme, il faut reconnaître les satisfactions différentes, mais équivalentes, répondant aux mêmes besoins. Il faut aussi distinguer des nourritures de l’âme les poisons qui, quelque temps, peuvent donner l’illusion d’en tenir lieu. L’absence d’une telle étude force les gouvernements, quand ils ont de bonnes intentions, à s’agiter au hasard[29].
Plus précisément encore, les besoins de base (la nourriture, le sommeil, la chaleur) ne sauraient être suffisants pour une satisfaction complète de la condition humaine, et de ce fait, ils nécessitent d’être suppléés en leur adjoignant des « besoins de l’âme ». Elle va faire la distinction de treize besoins : l’ordre, la liberté, l’obéissance, la responsabilité, l’égalité, la hiérarchie, l’honneur, le châtiment, la liberté d’opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la vérité. Ces besoins possèdent une dimension individuelle, de l’ordre d’une conscience individuelle et d’une dimension universelle puisqu’ils relèvent d’une obligation envers les autres, et se retrouvent impliqués dans l’ensemble de la vie sociale. Le danger réside dans les risques d’anonymat, d’écrasement par la masse, et donc de déresponsabilisation. En ce sens ces « besoins de l’âme » doivent être entendus comme des moments d’équilibre entre la liberté et l’obéissance, entre l’égalité et la hiérarchie, entre l’honneur et le châtiment, entre la vérité et la liberté d’opinion, entre la sécurité et le risque, etc. L’apparente contradiction entre ces différents couples se comprend et se confond parce qu’ils sont, en tout état de cause, des rapports dialectiques servant en définitive l’ensemble des interactions sociales et des rapports de pouvoir ou de domination. C’est une façon de pacifier et d’harmoniser les contraires générés par des besoins humains qui peuvent être potentiellement contradictoires et source de conflits. Cette approche humaniste offre une sorte de modèle explicatif de base.
Il convient de noter que ce qui caractérise nos sociétés contemporaines, repose sur un apparent paradoxe de la pensée de l’enracinement qui trouve, à bien des égards, son origine dans le droit. Depuis l’avènement des Droits de l’Homme les sociétés qui s’y soumettent sont définies par des droits et des devoirs. Le droit étant premier, subordonnent les devoirs. Le droit est tout et à la source de tout. Pour Simone Weil, ce qui doit être premier ce sont les devoirs. Autrement dit, ce qui est déterminant dans la fixation des individus dans la société, quelle qu’en soit la nature de sa structuration, ne peut se concevoir que dans un rapport entre des droits et des devoirs permettant d’établir les formes de l’enracinement. Plus précisément encore, si les droits contemporains peuvent être réduits aux Droits de l’homme, les devoirs sont soumis à une double contrainte : les besoins et les obligations. Obligations envers les hommes (envers leurs besoins) de manière inconditionnelle et impersonnelle. Besoins reposant sur un environnement et des racines. Cette dualité plus qu’opposition entre « droit » et « devoir » – opposés et complémentaires, ne peut se comprendre que dans le cadre d’une philosophie de l’action, loin des grands dispositifs et des systèmes abstraits. Si les droits peuvent être réduits, sans trop simplifier et comme il l’a déjà été dit dans nos sociétés modernes, aux Droits de l’homme, la question des devoirs devient plus complexe puisque enchâssée directement dans la diversité des interactions humaines. Incidemment, il n’est pas abusif d’établir un lien ou un prolongement avec la perspective développée par Hannah Arendt, puisque l’« enracinement » s’oppose très clairement à la « désolation ». Pour Arendt la « solitude » constitue le moment par excellence de la création, tandis que la « désolation » est le moment de l’abandon de « son soi », de la perte d’une certaine intimité[30]. Cette désolation se retrouve chez Houellebecq dans ce désir éperdu, cette quête mystique de (re)trouver une consolation – « l’art de la consolation »[31]. En ce sens, Pernaut lui apparaît certainement comme un homme de la consolation, même de manière éphémère et incomplète.
D’aucun trouverons qu’il est présomptueux et malvenue d’associer Simone Weil et Jean-Pierre Pernaut. Ce serait abaisser l’une pour élever l’autre. D’autant que ce qui par certains traits peut apparaître comme la mise en relief ou la révélation de manifestions d’un « déracinement » est réduit par la critique, à des « prurits réactionnaires », une nostalgie « vieille France », un « néo-pétainisme » rappelant « les heures les plus sombre de notre histoire ». Certes, une première analyse pourrait se rallier à ce type de constat plus que d’argumentaires, mais il faut tenir compte d’un temps long. Le « JT de 13 heures » s’est imposé dans le paysage de l’information de la mi-journée en s’adressant directement à ceux qui le regardent[32].
Jean-Pierre Pernaut, un écologiste et un européen malgré lui
Étrangement, défendre la campagne contre la ville, parler de la chasse et de la pêche, s’intéresser au rythme des saisons, suivre des agriculteurs et des éleveurs dans leurs activités, s’initier aux particularismes gastronomiques régionaux, dénoncer la désertification administrative et la disparition des commerces ruraux, valoriser des « petits métiers » entre savoir-faire et artisanat d’art, place Jean-Pierre Pernaut du côté de la « campagne » mais pas pour autant de celui de la « nature ». Il ne s’agit pas d’une nuance lexicale ou d’une figure de style mais bien une manière d’articuler deux visions d’un même monde. L’humain – l’homo faber dans une perspective bergsonienne, apparait comme essentiel face à un monde qui se bureaucratise avec ses fonctionnaires, ses directives et ses lois, ses impôts. La ruralité devient le point central, paradigmatique, d’un positionnement qui pourrait être que « franco-français » mais qui trouve aussi une continuité dans le rapport de la France à l’Europe.
Tout d’abord, dans une perspective hexagonale, en langage politique, la Campagne devient la Nature, une entité essentialisée et idéalisée, et se transmute rapidement en concept de Territoires lorsqu’il s’agit de la « développer » et surtout de la « sanctuariser » à travers des politiques publiques interventionnistes. Si l’on regarde rétrospectivement les évolutions de la « cause écologique » comme le font Leroux et Teillet, il existe parfois de saisissantes conjonctions :
L’écologie comme force politique, le régionalisme comme forme de résistance au centralisme modernisateur des débuts de la Cinquième République, sont des mouvements qui ont croisé et parfois accompagné les entreprises politiques de gauche. D’un certain point de vue, cette émission (en cela emblématique de toute exaltation de la terre, de la ruralité et du particularisme régional) propose à ceux qui partagent de telles préférences politiques des thèmes et des valeurs qui, pour partie, sont les leurs[33].
Loin de se constituer un unique enjeu local, la question va se prolonger dans des préoccupations élargies à l’Europe :
Face à des politiques globales (de l'Europe ou des nations qui la composent) peu lisibles pour le commun des citoyens et dont les résultats sont promis sur le long terme, les relais politiques, économiques et associatifs ont depuis longtemps proposé des actions valorisées par leur aspect de proximité. Les thématiques du développement local, du néo-ruralisme, du télétravail, les nécessités admises d'un aménagement du territoire luttant contre la « désertification » des campagnes, mettant en valeur le patrimoine et les manifestations culturelles locales va de pair avec un écologisme du quotidien dont le marketing de l'authenticité a su vanter les mérites (« vérité » des produits « bio » originaires des terroirs opposée à la « mal bouffe » industrielle mondiale (dont Mc Donald semble être le symbole), etc.[34].
Sans calcul éditorial, sans volonté strictement politique directe, de manière aléatoire au gré des informations locales, toutes les questions traitées sur ces thématiques se retrouvent de manière souvent hétérogène dans le journal de Jean-Pierre Pernaut :
[…] Il est difficile d’affirmer qu’il en serait à l’origine, qu’il en constitue en quelque sorte l’avant-garde formatant les aspirations, déterminant les comportements. Il semble plutôt devoir son succès à l’adéquation de sa cité idéologique avec un mouvement protéiforme de valorisation des terroirs dont l’analyse reste à faire. Accompagnant et répondant à des aspirations aux ressorts multiples mais identiquement orientées, le 13 heures de TF1 ne peut s’analyser comme la simple résurgence d’aspirations politiques à la fois traditionnelles et passablement enfouies[35].
L’« enfoui » doit aussi se comprendre dans un fait anthropologique, que les « néo-écologistes » contemporains oublient ou ne connaissent pas, l’homme depuis la nuit des temps à toujours, peu ou prou, modifié son environnement proche et la nature plus largement, Philippe Descola en offre une lumineuse réflexion[36]. Cela pose la question anthropologique fondamentale de l’usage et d’une sanctuarisation de la nature. Rien n’est acquis en ce domaine et demande une réflexion sur les principes d’un constat irréfutable sur l’état de la Nature et sur le rapport entre une concentration acceptable des populations et un espace naturel disponible et limité.
Ensuite, dans le contexte des politiques européennes Jean-Pierre Pernaut ne manque jamais une occasion de manifester sa désapprobation par un : « […] Discours “eurosceptiques”, tantôt tacites, tantôt explicites, du présentateur J.-P. Pernaut, qui oppose à l'unité européenne la diversité française des paysages et des pratiques, peut se trouver en harmonie avec (et parfois même illustrer) certaines réalisations concrètes des politiques de développement local en zone rurale que, de son côté, la communauté européenne encourage »[37]. Ce que soulignent ici Pierre Leroux et Philippe Teillet relève de l’invisibilité et d’une méconnaissance des politiques européennes en matière de développement, d’investissement dans les grandes régions rurales. L’eurosceptique est d’abord un ignorant. S’ajoute à cela une sorte de paradoxe : « […] Ils [les discours “eurosceptique”] favorisent de la sorte une identité européenne réactive. La valorisation du pluralisme culturel (de la diversité des pratiques et des traditions) est opposée à une volonté unificatrice (attribuée aux instances européennes) tout en constituant un intérêt commun (aux médias européens et à leurs publics) »[38].
BIBLIOGRAPHIE
ARENDT H., Les origines du totalitarisme. Le système totalitaire, Paris, Seuil, 1972
BOURDIEU P., CHAMBOREDON J-Cl. et PASSERON J-Cl., Le métier de sociologue, Livre 1, Paris, Mouton / Bordas, 1968.
HOUELLEBECQ M., La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010.
LEROUX P., TEILLET Ph., « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans Revue Mots, « La politique à l’écran : l’échec ? », no 67, décembre 2001.
NOVAK-LECHEVALIER A., Houellebecq, l’art de la consolation, Paris, Stock, 2018.
PACARY C., « Jean-Pierre Pernaut, journaliste », dans Le Monde, vendredi 4 mars 2022.
SANSOT P., Les gens de peu, Paris, PUF, 1991.
SIMMEL S., « Pont et porte », dans La tragédie de la culture et autres essais, Paris, Éditions Rivages, 1988.
[1] Du 22 février 1988 au 18 décembre 2020.
[2] P. LEROUX, Ph. TEILLET, « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans Revue Mots, « La politique à l’écran : l’échec ? »,no 67, décembre 2001, p. 60.
[3] Office de Radiodiffusion Télévision Française
[4] Quelques exceptions ont été faites lors d’attentats sur le sol national et de catastrophes collectives importantes.
[5] M. HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010, p. 234.
[6] P. LEROUX, Ph. TEILLET, op. cit., p. 61.
[7] Ibid., pp. 61-62.
[8] Cette troisième chaîne, pour la première fois en couleur, de l’ORTF est créée le 31 décembre 1972. Elle deviendra vingt temps plus tard France Région 3, le 7 septembre 1992.
[9] C. PACARY, « Jean-Pierre Pernaut, journaliste », dans Le Monde, vendredi 4 mars 2022.
[10] Les films Camping (trois à ce jour) sont des comédies populaires réalisées par Fabien Onteniente.
[11] Le terme est emprunté à P. SANSOT, Les gens de peu, Paris, PUF, 1991.
[12] M. HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, op. cit., p. 235.
[13] Entretien avec Michel Houellebecq réalisé par Nelly Kaprièlian pour Les Inrockuptibles le 9 août 2010.
[14] P. MARCELLE, Contre la télé, Lagrasse, Verdier, 1998, p. 32. Cité par Pierre Leroux et Philippe Teillet « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », op. cit., pp. 59-69. Pierre Marcelle a été chroniqueur pendant deux ans à Libération pour la rubrique télévision.
[15] G. SIMMEL, « Pont et porte », dans La tragédie de la culture et autres essais, Paris, Éditions Rivages, 1988, p. 59.
[16] P. LEROUX et Ph. TEILLET, « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », op. cit., p. 63.
[17] P. BOURDIEU, J-Cl. CHAMBOREDON et J-Cl. PASSERON, Le métier de sociologue, Livre 1, Paris, Mouton/Bordas, 1968, p. 60.
[18] Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010, p. 236.
[19] Sarah Lecœuvre, « Jean-Pierre Pernaut, 33 ans d’information au plus proche des français », journal Le Figaro, du jeudi 3 mars 2022.
[20] Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010, p. 235.
[21] Ceci est une allusion à une déclaration cynique faite par l’ancien président de TF1 Patrick Le Lay qui déclarait : « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible ». Propos parus dans Les associés d’EIM, Les dirigeants face au changement. Baromètre 2004, Paris, Éditions Huitième jour, 2004.
[22] Source : étude statistique Médiamétrie, 2013.
[23] Concours créé en 1959, en France, qui a pour finalité de promouvoir le fleurissement des espaces publics et des espaces verts. Les villes lauréates peuvent se voir attribuer 1 à, 2, 3, 4 fleurs en fonction de leur niveau d’excellence.
[24] Sur TF1, entre 1991 et 2010, Jean-Pierre Pernaut animera l’émission hebdomadaire « Combien ça coûte ? ». Il s’agit d’une émission s’intéressant à l’argent, aux dépenses des ménages et de l’État et proposera une rubrique spéciale sur l’argent gaspillé par l’État et les collectivités territoriales. Si la formule semble naviguer sur les vagues d’une certaine démagogie (critique de l’État dans l’utilisation des impôts), elle rencontrera un franc succès avec des pics d’audience à plus de 10 millions de téléspectateurs.
[25] François Rousseaux, « La région pour religion », hebdomadaire Télérama, du 09/ 03/22.
[26] Pierre Leroux et Philippe Teillet « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans La politique à l’écran : l’échec ? Revue Mots n°67, décembre 2001, p. 62.
[27] Ibid., pp. 62-63.
[28] S. Weil, L’enracinement, Paris, Gallimard, 1949, p. 61.
[29] Ibid., pp. 17-18.
[30] H. ARENDT, Les origines du totalitarisme. Le système totalitaire, Paris, Seuil, 1972, pp. 228-229.
[31] Sur ce point essentiel voir l’excellente analyse dans l’ouvrage d’Agathe Novak-Lechevalier, Houellebecq. L'art de la consolation, Paris, Stock, 2018, pp. 19-25.
[32] Jean-Pierre Pernaut a toujours travaillé sans prompteur préférant une spontanéité, même imparfaite, à une lecture contenue et sans risques.
[33] Pierre Leroux et Philippe Teillet « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans La politique à l’écran : l’échec ? Revue Mots n°67, décembre 2001, pp. 65-66.
[34] Ibid., p. 66.
[35] Ibid., p. 66.
[36] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
[37] Pierre Leroux et Philippe Teillet « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans La politique à l’écran : l’échec ? Revue Mots n°67, décembre 2001, p. 65.
[38] Pierre Leroux et Philippe Teillet « La politique de l’apolitique. Le 13 heures de TF1 », dans La politique à l’écran : l’échec ? Revue Mots n°67, décembre 2001, p. 65.