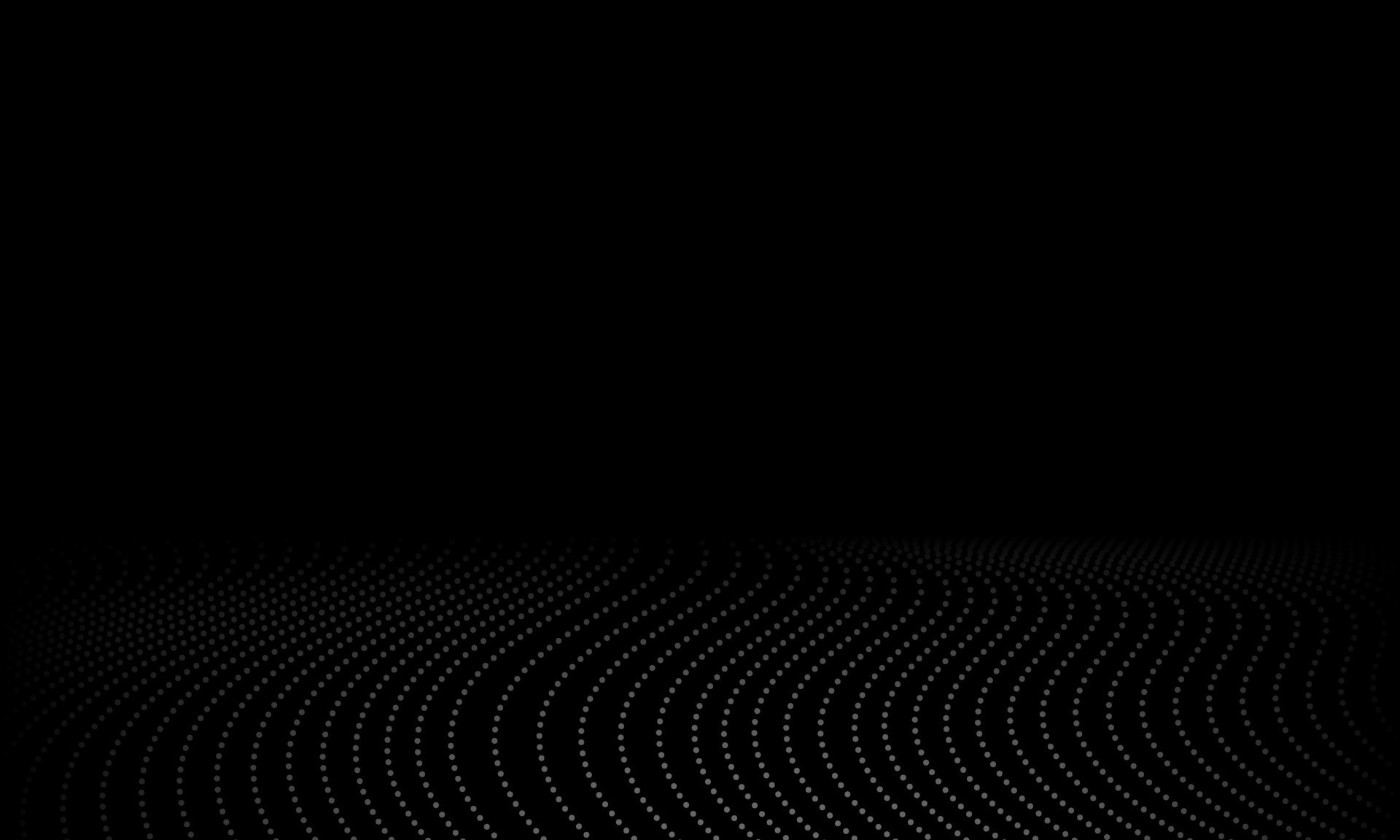Michel AGIER, Les migrants et nous. Comprendre Babel. CNRS Éditions, 2016, 64 p.
Les migrants et nous. Comprendre Babel est un livre écrit par Michel AGIER et publié en 2016 aux CNRS EDITIONS. Pour cet anthropologue français qui explore « les relations entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux de l’exil, et la formation de nouveaux contextes urbains »[1], « l’anthropologie doit s’intéresser [également] à la mobilité »[2].
C’est ce qu’il a essayé de faire à travers son ouvrage qui s'appuie sur deux conférences et un projet de recherche sur les migrants et les villes, Agier avait pour but d’éclairer les enjeux complexes de la migration et contribuer à la réflexion scientifique sur ce phénomène global.
Dans son introduction intitulée « un moment politique européen », l’auteur évoque « La crise » migratoire de 2015 en Europe et considère qu’elle a mis en lumière les problèmes de frontières et de flux migratoires et que face à l'indifférence et aux mesures de sécurité des gouvernements, les citoyens et les ONG se sont mobilisés pour aider les migrants. En soulignant le rôle clé que l'Allemagne a joué en accueillant 140 000 réfugiés syriens et qui a incité d'autres pays à faire de même, Agier affirme que l'été 2015 a vu naître une vague de solidarité, notamment grâce à la photo du petit Aylan Kurdi. Pour l’auteur, il s’agissait d’une épreuve pour l'Europe, mais aussi une chance de bâtir un monde plus solidaire en accueillant les migrants de façon humaine.
Dans la première partie de son livre portant pour titre la question « la cause des migrants existe-t-elle ? », Agier questionne l'existence d'une "cause des migrants" unique et unifiée. Il examine les justifications les plus courantes de l'aide aux migrants : la souffrance, la ressemblance et la différence et critique chacune d'elles en soulignant leurs limites et leurs pièges. L'argument de la souffrance peut mener à une relation inégale entre l'aidant et l'aidé, et ignorer la subjectivité et les aspirations du migrant. L'argument de la ressemblance, basé sur des expériences communes, peut nier les différences des migrants et les enfermer dans une identité stéréotypée. L'argument de la différence peut exotiser et idéaliser la figure du migrant, l'éloignant de la réalité complexe de ses expériences et aspirations.
L'auteur propose de dépasser ces catégories et de changer de description. Il appelle à une réflexion épistémologique sur la manière de comprendre et de nommer les migrants et leurs situations. Il souligne l'importance de prendre en compte la relativité culturelle et la complexité des parcours migratoires. Agier critique également l'usage du mot « migrant » comme terme générique et propose de le distinguer du terme « réfugié ». Il rappelle l'histoire et la signification précise du statut de réfugié, défini par la Convention de Genève de 1951.
Dans la deuxième partie qui s’intéresse à « une nouvelle cosmopolis », l'auteur examine les situations de frontière dans le monde contemporain à travers le prisme des migrants. Il trouve que la mondialisation ne supprime pas les frontières : « elle les transforme, les déplace, elle les multiplie et les élargit, tout en les rendant plus fragiles et incertaines » (p. 29). Pour Agier, ces espaces liminaires créent une existence précaire et incertaine pour les migrants, qui se retrouvent dans des positions d'errance, de parias ou de métèques. Son analyse s'appuie sur l'étude de trois lieux-frontières : un campement de réfugiés, un squat et un camp de migrants. L'auteur montre que ces lieux obligent les migrants à un « travail culturel » (p. 39) et à une « imagination sociale » (ibid.) pour s'adapter et survivre. L'expérience de la frontière - pour lui- est une épreuve de l'altérité qui conduit à une distance vis-à-vis des identités héritées et à une compréhension du monde « global ».
Michel Agier propose une nouvelle conception du cosmopolitisme basée sur l'expérience concrète des migrants en situation de frontière. Cette expérience est distincte du cosmopolitisme des classes globales, de la citoyenneté du monde et de la conscience globale médiatisée. Il trouve que le cosmopolitisme des migrants naît de leur décentrement, de leur double désidentification vis-à-vis des sociétés d'origine et d'accueil, et de leur confrontation quotidienne aux frontières. Agier estime que ce cosmopolitisme ordinaire est pragmatique, ancré dans la réalité du monde globalisé et marqué par les inégalités sociales et qu’il implique une « science du concret » (p. 50) et une perspective décentrée sur le monde. Pour l’auteur c’est un appel à reconnaître la centralité de l'expérience des migrants dans la compréhension du cosmopolitisme contemporain.
Pour conclure et sous le titre de « La politique de Babel », Michel Agier estime qu’en 2015, la « crise migratoire » a mis en lumière la situation des migrants bloqués aux frontières européennes. Il trouve que l'exemple de Calais montre comment ces migrants, face à l'impossibilité de passer légalement, se sont politisés et ont exprimé une « politique du sujet cosmopolite » (p. 54) centrée sur la frontière et la mobilité humaine. L'auteur propose de « démocratiser la frontière » (ibid.) pour reconnaître l'existence d'une scène politique à la frontière et pour aller au-delà des approches humanitaires ou sécuritaires.
Cet ouvrage court concis et précis suggère que la « cause introuvable des migrants » (ibid.) est celle qu'ils portent eux-mêmes sur la frontière, devenue leur lieu de vie et de politique.
Les mots « nous » et « migrants » ; qui font référence à « Nous » (qui nous dirons établis, sédentaires, autochtones, mais aucun de ces termes n’est absolument exact) et « eux » (les migrants, les réfugiés, les nomades, les étrangers, mais là non plus, aucun des termes n’est absolument exact) » (p. 12); représentent une invitation claire à une approche plus fine et nuancée de la question des migrants, basée sur une meilleure compréhension de leurs situations et de leurs voix, c’est une invitation à relire le mythe de Babel en tenant compte de la diversité des expériences et des aspirations et en la considérant comme source d’enrichissement mutuel.
[1] Le site de L'École des hautes études en sciences sociales EHESS. (3 octobre 2019). Michel Agier. EHESS. https://www.ehess.fr/fr/personne/michel-agier
[2] Michel Agier était l’invité de Pierre-Edouard Deldique sur RFI dans l’émission « Idées »
Deldique, P. (23 octobre 2016). Idées - Michel Agier : « Les migrants et nous ». RFI. https://www.rfi.fr/fr/emission/20161023-agier-anthropologue-migrants-babel-cnrs-editions