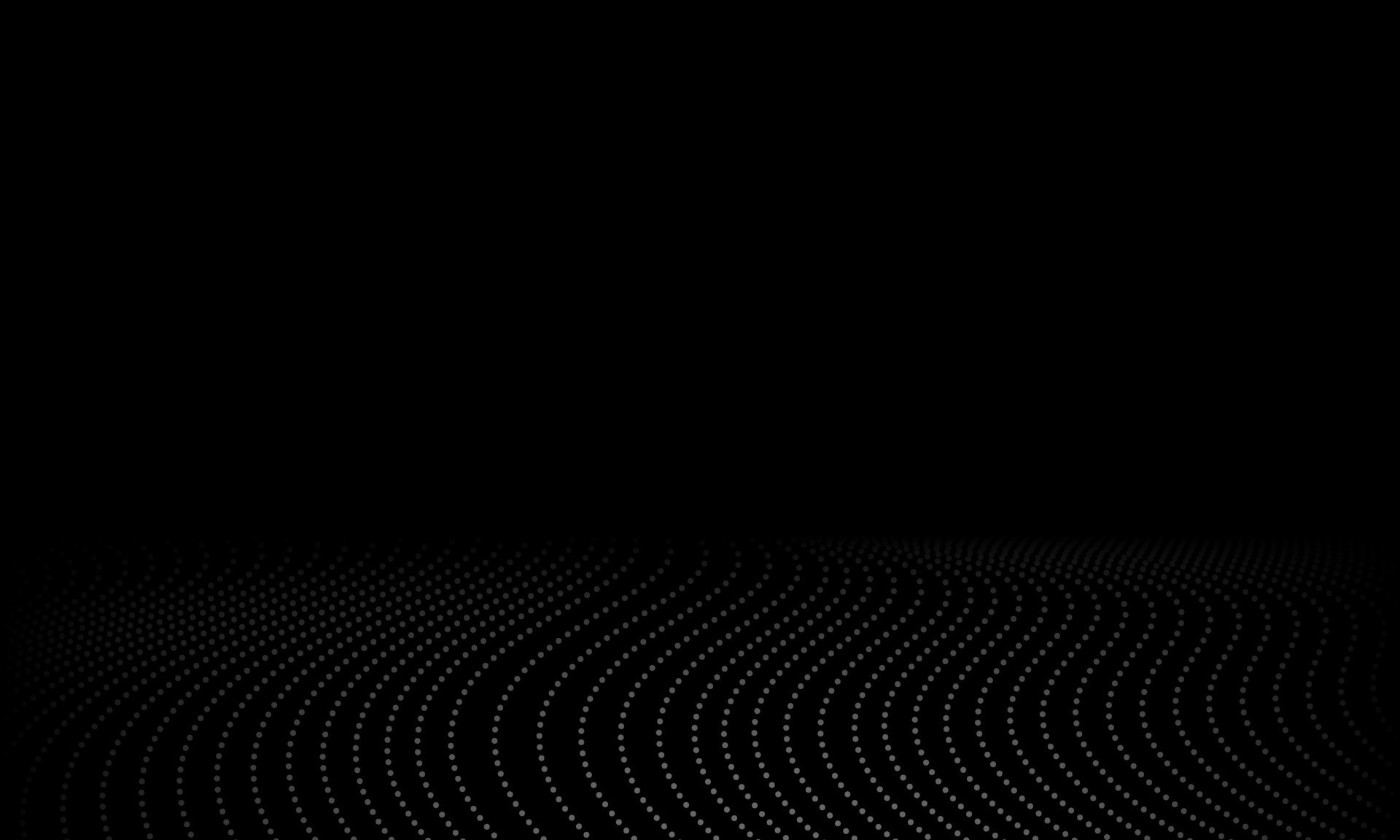Par Dhouha Wiem Mbazaa, doctorante en sociologie à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire LEIRIS.
Pendant des siècles, les arabes d’Espagne ont diffusé un savoir-faire artisanal considérable dans les pays où ils ont été accueillis, que ce soit avant ou après la chute de Grenade, notamment en Tunisie, ce pays qui a reçu le plus grand nombre de ces réfugiés. Une part importante de ce savoir-faire, de cet apport civilisationnel qu’on considère aujourd’hui comme le legs andalou, a disparu. Beaucoup d’ateliers ont été détruits. Plus aucune trace des hréyriyya (les tisserands de soie) dont les ateliers étaient situés à Denden pas loin du Bardo, plus aucune trace non plus des ateliers de céramique qui étaient situés dans les faubourgs de la médina de Tunis. De tous les métiers apportés par ces musulmans d’Espagne, la chéchia est la seule à continuer à être fabriquée dans les ateliers qui lui ont été dédiés depuis des siècles.
UN LIEU SYMBOLIQUE DE LA MÉMOIRE DES ARABES
C’est à l’intérieur de ce souk édifié sous le règne des Mouradites - une dynastie beylicale qui régna en Tunisie de 1613 à 1702 - que la confection des chéchias, qui s’était d’abord implantée à Kairouan puis à Bab Souika sous le règne des hafsides, a pu prospérer. A l’inverse de la céramique andalouse par exemple qui n’a existé en tant que telle en Tunisie que pendant une période relativement courte avant de prendre une forme résiduelle, mixée avec le langage des Qallaline[1], la fabrication de la chéchia s’est perpétuée telle quelle.
![]()

Figure 1 : Atelier-boutique au Souk Chaouachine. Tunis.
Demeure donc, à l’intérieur de ce gisement culturel qu’est la vieille ville de Tunis, ce Souk Chawachine, un espace singulier, composé d’une série de boutiques-ateliers où on trouve des objets divers, utiles pour la confection de ces bonnets rouges ainsi que des meubles peints de couleurs à dominante verte. Cette couleur connue comme étant la couleur de l’islam, dont la symbolique est associée à l’idée de bonheur, d’espérance et de paradis est d’un ton si particulier - on ne le retrouve nulle part ailleurs qu’en Andalousie - qu’elle donne un caractère unique à ce souk situé près de la Kasbah de Tunis (Fig 1, 2). Cette zone de la vieille ville de Tunis se présente aujourd’hui comme l’allégorie d’une époque lointaine et ignorée de certains, qui a connu un afflux massif de groupes humains réputés pour leur délicatesse dans l’exécution des produits de l’artisanat d’art. Ces derniers ont aussi laissé une couleur comme héritage, ce vert qu’on retrouve d’ailleurs en abondance à Testour, ville fondée par les musulmans d’Espagne au début du XVIIe siècle. Michel Pastoureau avait souligné la particularité de cette teinte en disant qu’« alors que dans toute société chaque couleur possède des aspects positifs et des aspects négatifs. En terre musulmane, le vert est constamment pris en bonne part. C'est là un cas presque unique »[2].
![]()

Figure 2 : Artisan chaouachi dans son atelier au Souk Chaouachine. Tunis.
Il est utile de rappeler que ce souk compte parmi les lieux les plus importants qui avaient été aménagés pour cette population venue d’Espagne, laquelle a manifestement cherché à reproduire un schéma de la terre natale à la terre d’accueil. Le style, si tant est qu’il soit possible de parler de style, est le même que ce qu’on peut encore retrouver dans différentes régions en Espagne. Les motifs décorant les meubles en bois, les banco (comptoirs derrière lesquels travaillent les chawachias), les portes et les vitrines sont teints suivant la même palette que celle qui décore encore aujourd’hui certaines boutiques en Espagne (Fig 3,4). Cette réalité témoigne en fait d’une volonté de la part des migrants arabes d’Espagne de partager et d’afficher leur mémoire collective ce qui a largement contribué à l’émergence d’un cadre de vie unique dans le paysage urbain du vieux Tunis. « Nul anthropologue ne peut contester la volonté des groupes humains d’élaborer une mémoire commune ; une mémoire partagée dont l’idée est très ancienne »[3].

Figure 3 : Boutique exposant les chéchias au Souk Chaouachine. Tunis.

Figure 4 : Intérieur d’une boutique de chéchias au Souk Chaouachine. Tunis
Des familles comme Terouel, originaires de Teruel, ou Haddad, ou encore El Béji avaient alors participé à l’implantation d’un savoir-faire venu principalement de Tolède. Ils ont collectivement participé à la création d’un espace qui était alors composé de 130 boutiques hautes en couleurs et qui est aujourd’hui incontestablement un lieu de mémoire.
Que reste-t-il de ce souk aujourd’hui ? Qu’est-ce qui est arrivé jusqu’à nous ? Et qu’est-ce qui pourrait en être transmis à la postérité ?
Notre propos est d’attirer l’attention sur le fait que ce lieu mérite aujourd’hui une plus grande attention de la part des institutions et d’étudier des possibilités d’actions dans un esprit qui obéit à ce devoir de mémoire, ce concept forgé depuis des décennies et qui occupe de plus en plus l’espace public et les médias en Tunisie comme ailleurs.
En parlant de la trace, Joël Candau a dit qu’elle « en signifie l’absence, elle est également la preuve que tout n’est pas perdu : à partir de la trace, on espère retrouver un peu de ce qui s’est enfui »[4]. Les 30 boutiques qui sont arrivées jusqu’à nous sont occupées par des hommes qu’on appelle chaouachia , des continuateurs d’un savoir-faire arrivé sur le sol tunisien à travers les vagues migratoires venues d’Espagne que la Tunisie a connues à partir du XIIIe siècle.
A notre époque, à l’heure du« culte moderne du patrimoine » pour reprendre la formule de Aloïs Riegl, à l’heure de cette patrimonialisation parfois frénétique et compulsive, à l’heure où on organise toutes sortes de festivals, aux thématiques les plus diverses liées au patrimoine matériel et immatériel, à l’heure où comme l’a dit Joël Candau, nos « sociétés [sont] travaillées |...] par un mnémotropisme massif et impérieux, [qui se manifeste par cette] "compulsion mémorielle [qui] s’exprime de multiples façons" [à l’heure où] la mémoire et ses enjeux sont devenus si envahissants dans le monde contemporain »[5], il devient urgent de réfléchir à une revalorisation de cette trace, de ce lieu qui se vide de plus en plus de ses anciennes boutiques et de sa substance sans courir le risque de tomber dans le piège de la saturation et du folklore. Il est d’autant plus urgent de réhabiliter ce Souk Chawachine que la mémoire de ce peuple qui l’a construit et édifié risque elle-même sa perte.
C’est dans l’espace du souk lui-même qu’il conviendrait de réhabiliter cette mémoire car comme l’a affirmé Maurice Halbwachs, « il n’y a pas de mémoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivant en société se servent pour fixer et retrouver leurs souvenirs »[6]. C’est dans cet espace qui pullule de signes de cet héritage andalou qu’il conviendrait de trouver les éléments et les symboles susceptibles de protéger ce lieu et ce patrimoine en réactivant collectivement sa mémoire. Pour comprendre en quoi ce patrimoine sur lequel nous nous sommes penchés, que nous appelons à considérer comme un lieu pouvant nourrir une mémoire collective relative à ces arabes venus d’Espagne, il est utile de rappeler comment Joël Candau fait la distinction entre la mémoire et le patrimoine :
« mémoire collective et patrimoine sont deux productions sociales essentiellement différentes, voire même opposées dans certaines de leurs dimensions sociales. Entre patrimoine et mémoire, il y a une différence de nature qu’il est important de connaître pour comprendre les enjeux de la culture en milieu urbain : le patrimoine est un objet (une pratique, une loi, un code…) dont les formes sont fixées par la réglementation, par l’usage, par la tradition, il est théoriquement inaliénable et on lui attribue un sens à partir de l’histoire; la mémoire est une pratique collective qui se nourrit des interactions entre les agents, des échanges verbaux et symboliques. Elle évolue, elle transforme les représentations du monde, ses expressions varient au gré de celui qui l’évoque, elle a vocation à disparaître aussitôt qu’elle perd son efficacité symbolique »[7].
Il serait temps de se mettre en quête d’une valorisation qui sauve ce lieu et ce qu’il abrite tout en respectant le principe de la « juste mémoire » défendu par Paul Ricoeur et que Joël Candau explique en ces termes : « idéalement soustraite à une emprise abusive du passé, conçu comme une sorte de deuil accompli qui maintiendrait la balance entre le devoir de mémoire et le besoin d’oubli »[8].
VALORISATION INSTITUTIONNELLE POUR UNE « JUSTE MÉMOIRE »
Il convient pour ce faire de se poser la question suivante : Vaut-il mieux chercher ce que Michel De Certeau appelle un rayonnement sourd de ce patrimoine à travers les actions des locaux ou faut-il plutôt chercher à construire cette mémoire collective de manière organisée et scientifique ? Faut-il opter pour une construction populaire, plutôt naturelle ou alors faut-il privilégier la méthode institutionnelle et construite ?
On constate aujourd’hui quelques actions menées par les locaux qui ne sont autres que ces artisans, ces passeurs de ce savoir-faire ancestral. Leurs activités, leurs pratiques artisanales participent largement à réactiver la mémoire collective et d’une manière totalement dépourvue d’artifices. Il s’agit d’une construction sociale d’une mémoire collective indépendante de l’action des institutions publiques ou scientifiques. En effet, si ce lieu de mémoire continue d’exister, c’est bien à la faveur de la transmission de ce savoir-faire et peut-être d’une volonté politique encourageant cette transmission mais qui reste faible. Même si les artisans déplorent une baisse notable des commandes, lesquelles viennent pour la plupart de l’étranger, notamment de la Libye et de l’Afrique subsaharienne (Niger, Nigeria, Tchad), cette production est le socle sur lequel est construite cette mémoire collective, le socle principal en tout cas en ce qui concerne la ville de Tunis car il faut rappeler que le tricotage des bonnets se fait à Kalaat Landlous dans la région de Bizerte et que le foulage de ces bonnets se fait au Battan face à Tebourba[9] et tout près de la vallée de la Medjerda. Il convient de rappeler également que ce rayonnement n’est pas si sourd, puisque les artisans utilisent une terminologie en langue espagnole. Ce legs andalou est perpétué par des hommes qui manient des outils et une langue espagnole un brin « indigénisée ». Pratiquement tout le lexique utilisé dans les échoppes et boutiques-ateliers vient de l’espagnol. Par cet usage de mots espagnols ou du moins à consonance espagnole, ces hommes sont dans l’affirmation consciente ou inconsciente de leur filiation avec ces groupes humains venus de la péninsule. En plus de ces signes matériels, ces décors et ce vert dominant spécifique, les chawachias andalous ont introduit cet élément immatériel qu’est un lexique étranger aux sujets qui fréquentent la vieille ville. Comme l’a indiqué Slimane Mostafa Zbiss : « La ville regorge maintenant de personnes qui parlent un idiome nouveau où l’arabe se mêle à l’espagnol : la fabrication de la sasia a introduit surtout une terminologie professionnelle nettement castillane. On n’entend plus parler que de “cabiça-banco” (cabeza-banco), que d’el Batan, et que d’ouvriers exécutant différents travaux comme “cardar” “croudar”, “afinar” et combien d’autres termes espagnols dont on n’emploie nullement les correspondants en arabe »[10].
On constate donc une transmission d’un héritage arabo-andalou qui s’est déroulée selon des modalités sociales formelles à travers la confection des chéchias mais aussi informelles à travers la répétition des mots qui ont circulé de génération en génération de l’Espagne vers ce lieu. Même si les enquêtés se révèlent être davantage sensibles à ce qui est visible qu’à ces mots à consonance espagnole, cette terminologie est efficiente dans la construction de la mémoire collective. On note cependant qu’elle gagnerait en acuité et en pertinence si elle était inscrite quelque part. On pourrait ici s’inspirer des inscriptions et des indications en langue arabe visibles aujourd’hui à Madinat Al Zahra dans le bus qui y mène en partant de Cordoue ou carrément sur les ruines de cette province. L'appropriation symbolique de signes hérités du passé a ce pouvoir d’insuffler, de laisser planer une certaine âme arabe en Espagne. On pourrait inscrire quelques mots en langue espagnole à l’intérieur du Souk Chawachine ce qui permettrait de présenter de manière un peu plus pédagogique l’identité liée à cet espace et sa mémoire.
Mais le problème est que cet espace se vide de plus en plus de ses boutiques. Il devient alors clair qu’il est difficile de voir cette mémoire collective habilitée encore longtemps par les locaux puisque ceux-là se font de plus en plus rares.
Il est donc à craindre que cette mémoire collective qui est aujourd’hui assez disloquée finisse par disparaître complètement. Il est de ce fait utile de lutter contre cette menace et de songer à des projets qui seraient susceptibles de la réactiver d’une manière plus organisée et durable. Quand on considère en effet cette diminution au niveau du nombre des chaouachias, il convient de réfléchir aux modalités adéquates qui pourraient avoir un rôle dans la remémorisation de ce passé et il devient dès lors utile d’examiner la question suivante : quelle place occupe ce souk et ses composantes dans la vie des gens aujourd’hui ? En enquêtant sur ce bien patrimonial, sur ce que les acteurs sociaux, connaisseurs et ignorants de l’histoire de cette Chéchia mais aussi des décors des ateliers (hanout), et en se penchant sur le regard qu’ils portent sur cet héritage, se dessinent alors quelques pistes qui permettent de mesurer les failles dans la représentation que la société locale se fait de ce legs. Quelles valeurs accorde-t-on à ce lieu ? Valeur historique, patrimoniale, esthétique ? Parmi les enquêtés, beaucoup font référence à une profondeur historique mais regrettent que le souk soit réduit aujourd’hui à quelques boutiques. Les locaux comme les passants ainsi que certains commerçants voisins s’attachent à l’ancienneté de cet objet patrimonial, à son authenticité et à son pouvoir de témoignage historique. Ce qui a été le plus retenu par les acteurs sociaux, ce qui les fascine et les enthousiasme encore, c’est le fait que les andalous et plus tard les morisques aient réussi à se recréer un univers, un paysage et même des décors, probablement les mêmes que ce qu’ils ont connu quand ils étaient en Péninsule. Il est en effet intéressant de considérer comment un peuple probablement en quête et/ou en crise d’identité aura réussi à marquer ce nouveau territoire d’objets et de signes qui lui appartiennent en propre, qui font partie de son histoire reconstituant ainsi un bout de leur ancienne patrie. Cet espace est unique comme aiment à le répéter non sans amertume les chaouachias car ils constatent qu’il n’est pas assez bien entretenu et que les boutiques abandonnées par les anciens sont délaissées ou investies par des cafés et restaurants dans le meilleur des cas. On peut aller jusqu’à dire que ce souk est une métonymie de cette identité sachant que « L’identité servirait donc à établir la singularité d’un sujet et à le rendre discernable d’avec d’autres. Elle permettrait d’identifier quelqu’un au sens de le “reconnaître” »[11] comme l’a expliqué Nathalie Heinich. Il n’est donc pas admissible que ce souk qui est considéré comme un symbole d’une couche de l’histoire de la Tunisie, qui est pour certains tunisiens plus importante que d’autres nappes de l’histoire probablement du fait du sort tragique que ce peuple a connu, subisse un tel abandon de la part des autorités. Aux valeurs historique et patrimoniale, s’ajoute donc cette valeur affective qui continue d’être portée par ces décors et ces motifs sans pareil dans tout le pays et qui continue de nourrir cette mémoire collective. André Chastel a eu raison de noter qu'« aucun élément patrimonial n’a de sens en dehors de l’attachement des sociétés intéressées »[12]. Il n’est pas question de tomber dans le piège de la métamnémotique qu’on a évoqué plus haut, teintée de cette mièvre nostalgie infructueuse, mais de donner plus de présence à cet héritage dans la vie des locaux et des visiteurs occasionnels ou assidus en allant jusqu’à les faire participer à recréer l’esprit du lieu.
LES VALEURS DU PATRIMOINE CULTUREL ANDALOU ET LEUR RÔLE DANS LA LOGIQUE DE SA TRANSMISSION
Nombreux sont ceux qui viennent goûter à cette atmosphère si particulière que seuls ces lieux de mémoire savent fournir et qui procure une certaine sécurité probablement pour leur caractère immuable malgré le passage du temps. Alain Bourdin traite de ce type d’espace « auquel [il] attribue une valeur, qui peut être subjective [...] mais qui représente une garantie pour l’avenir »[13]. Cela s’apparenterait à quelque chose comme une protection contre l’angoisse du lendemain, un sentiment qui s’exacerbe de jour en jour avec tout ce que la planète vit comme crises sanitaires, politiques, économiques et climatiques. On sera tenté de dire que la mémoire reste forte face à l’épreuve du temps et de ses métamorphoses et que ce Souk a valeur de sanctuaire dans le cœur des tunisiens. Il représente une réponse au besoin fondamental et viscéral de se situer, de s’ancrer quand tout semble bouger et se déraciner autour de soi. Mais la valeur principale et qui nous importe le plus reste son pouvoir de réactiver la mémoire collective.
Et c’est en considérant ces valeurs évoquées qu’il conviendrait de construire ou de reconstruire cette mémoire collective de manière scientifique et organisée et éviter par là sa perte. Il est toujours difficile de formuler en quoi il est salutaire d’entretenir la mémoire mais tout le monde est d’accord pour dire que cela est bénéfique.
« Le sentiment du patrimoine est le sentiment de ressources, mal définies mais profondes, auxquelles on a, en principe accès parce qu’on est de ce pays mais non d’un autre… Il s’y mêle donc le pressentiment d’énergies latentes auxquelles il ne serait peut-être pas impossible de recourir un jour, celui où l’on aurait besoin d’une confirmation d’identité »[14] a déclaré André Chastel.
Dès lors, il convient de réfléchir à un aménagement de cet espace où peut être mené des expériences sociales au sein de cette ambiance diffuse andalouse et qui soient en lien avec l’identité du lieu. Maurice Halbwachs avait admirablement expliqué le rôle joué par cette socialité au sein des lieux de mémoire :
« à côté d’une histoire écrite, il y a une histoire vivante qui se perpétue ou se renouvelle à travers le temps et où il est possible de retrouver un grand nombre de ces courants anciens qui n’avaient disparu qu’en apparence. S’il n’en était pas ainsi, aurions-nous le droit de parler de mémoire collective, et quel service pourraient nous rendre des cadres qui ne subsisteraient plus qu’à l’état de notions historiques, impersonnelles et dépouillées ? »[15].
Pour que l’esprit andalou continue d’« irradier », de se réinventer et de participer à irriguer cette nappe de l’histoire de la vieille ville de Tunis et à l’enrichir, il conviendrait de redonner de la fonctionnalité à ces espaces vides pour des actions qui touchent à l’artisanat, à la restauration et à la culture. L’on pourrait songer par exemple à la création de ces petits espaces de travail très tendance aujourd’hui qu’on appelle des coworking ou même à l’aménagement de quelques espaces annexes de quelques établissements institutionnels en lien avec ce patrimoine et surtout un musée qui présente l’histoire de l’arrivée de cet artisanat sur le sol tunisien, son processus de création et ses outils. Toutes ces actions permettraient d’exploiter d’une manière intelligente le potentiel et les ressources de ce lieu et d’offrir une déclinaison de façons de vivre et de bénéficier de ce droit de regard et de ce « droit de jouissance » comme l’a exprimé Nathalie Heinich dans « La fabrique du patrimoine : De la cathédrale à la petite cuillère ».
En effet, la vivification du Souk Chawachine passe obligatoirement par la réaffectation des espaces, de quelques ateliers-boutiques qui sont aujourd’hui clos. Et puis pour ceux qui sont exploités, ils devraient avoir d'autres usages que ceux de café et de restaurants. Encore qu’un restaurant qui propose des mets typiquement andalous serait l’occasion pour les visiteurs de ce Souk de goûter à une expérience gustative qui inscrit un patrimoine immatériel dans le cadre de cette visite, ce qui créera un petit « empire de signes » et de sens pour filer l’expression de Roland Barthes.
Toute la difficulté réside en effet dans le choix de la nature des interventions sur ce lieu. Voilà ce que dit Pierre-Louis Spadone à ce sujet :
« Ce qui se joue, lorsque l’urbaniste confère par son intervention (ou par son abstention) une destination nouvelle à un fragment passé de l’espace urbain, ce sont les modalités de sa réaffectation au présent, la logique de sa contemporanéité avec son contexte. Ainsi, la trace prend des significations différentes selon qu’elle est réaffectée à un autre usage, muséifiée, laissée en l’état ou bien totalement détruite. Réhabilités ou réaffectés, un bâtiment ou un quartier ancien sont remis, avec une nouvelle signification, dans le circuit du sens public de l’espace urbain »[16].
Tout en évitant la saturation, tout en cherchant cet équilibre, cette « juste mémoire » que nous avons évoqué, qui incarne cet équilibre et cette « ambivalence entre le souvenir et l'oubli » pour reprendre les mots de Joël Candau[17], il conviendrait de rendre plus présents ces éléments patrimoniaux qui ont composé le Souk Chawachine dans l’espace et de chercher à en inscrire quelques-uns, ne serait-ce que sous une forme suggestive, dans nos imaginaires. Car le patrimoine développe l’imaginaire et c’est aussi pour ça qu’il est important de le valoriser. L’ethnologue Véronique Dassié a déclaré à ce propos que :
« tout individu se construit dans sa relation à autrui, y compris dans le registre de l’intime [...] cette construction est également indissociable d’une relation à des objets. Chez l’homme, il semble bien qu’il ne puisse pas y avoir d’activité cognitive sans extension de son esprit-cerveau dans l’environnement, par le biais du langage en premier lieu mais aussi sous la forme d’artefacts. Pour la plupart sinon toutes, les intéractions humaines s’accomplissent à travers les réseaux d’objets qui saturent les espaces dans lesquels les individus évoluent »[18].
On peut enfin imaginer les espaces vides de ce souk réinvestis par d’autres artisans voire des artistes qui produisent des œuvres qui ont quelque lien avec cet héritage. En plus de la matérialité objective, de la valeur affective-subjective et de la valeur esthétique de ce qui est à l’intérieur de l’espace de ce souk, tout ce qui est contenu dans ce lieu a ce rôle de porter des informations sur la société qui les a produites et sur son goût.
En reprenant de manière directe ou indirecte les gestes hérités de ces artisans, la dimension sociale de ce lieu n’en est que vivifiée.
On pourrait alors songer à un musée qui met en scène ces « objets orphelins » pour reprendre les mots du philosophe Remo Bodei, ces anciens outils qui ont perdu leur valeur d’usage pour se transformer en choses, en objets patrimoniaux. Ces outils que plus personne n’utilise aujourd’hui, ces énormes ciseaux par exemple Makssa qui servaient à nettoyer le bonnet de la laine qui dépasse le contour de la tête, ces plantes appelées Kardoune qui se cultivaient jadis à El alia dans la région de Bizerte et qui trônent aujourd’hui sur les étagères de ces ateliers car elles ne sont plus utilisées du fait du coût onéreux de leur culture (Fig 5). Alors qu’ils ont été remplacés par Ezzouz, un outil fabriqué par des forgerons, ces Kardoune continuent d’exister, de témoigner d’un passé et de diffuser cette « mémoire sourde ».
Magnifiquement, ces objets abandonnés peuvent être perçus comme des objets de désir, désir d’une époque. Ils pourraient être thésaurisés à l’intérieur d’un musée qui soit ouvert à un public connaisseur, curieux ou ignorant de cette période de l’histoire, cela enclencherait des discussions qui, possiblement, réactiveront cette mémoire ? Fragilisés par leur manque de fonctionnalité mais forts de leur valeur affective, ces objets, ces échantillons, ces « spécimens de civilisation » comme disait Jean Jamin sont « muséifiables » parce que leur perception est traversée par le récit de leur origine.

Figure 5: Kardoune, plante jadis cultivée à El Alia dans la région de Bizerte et qui servait à panser le bonnet (Chéchia).
CONCLUSION
Le passé et sa réactualisation contemporaine pourrait donc être envisagé d’une manière qui consiste non pas tant à restituer mais plutôt à réinventer la mémoire de ce lieu du Souk Chaouachine car « la pensée de l’espace évolue avec la marche de la civilisation, comme ses formes de production avec celle de la société »[19]. Ces actions vitalistes ne viseront pas tant à réinventer de l’authenticité et du patrimoine qu’à une réinterprétation du passé par des modalités de réhabilitation sur lesquelles il serait intéressant de se pencher.
La vivification de ce quartier historique servira enfin le culte de la pérennité historique et répondra à un besoin chez certains contemporains, celui du retour au local qui vient en réaction à la globalisation dans laquelle nous sommes entraînés.
Ces lieux de mémoire sont nécessaires aujourd’hui plus que jamais puisqu’ils peuvent permettre, pour les plus jeunes, de répondre au risque de s’adonner complètement aux réseaux sociaux et d’oublier le lien avec le réel et les espaces réels. « À des mémoires fortes correspondent des identités solides, à des identités fragmentées des mémoires éclatées. Nombreux sont les exemples de cette intrication entre mémoire et identité, multiples sont les cas où la mémoire consolide ou défait le sentiment identitaire »[20]. Il convient de penser ces espaces du patrimoine comme une valeur urbaine centrale de la ville contemporaine. Leur rôle n’est pas seulement de maintenir la mémoire mais d'intégrer d’anciens souvenirs qui vont orienter la construction des nouveaux. Ils sont déterminants dans la constitution de l’individu et son épanouissement.
BIBLIOGRAPHIE :
BOURDIN A., Le patrimoine réinventé, Paris, Presses Universitaires de France, 1984.
CANDAU J., Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 1996.
HALBWACHS M., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925).
–, La mémoire collective, Paris, Albin Michel. 1997 (1950).
HEINICH N., Ce que n’est pas l’identité, Paris, Gallimard, 2018.
MÉTRAL J. (dir.), Mémoire collective et patrimoine dans les périphéries urbaines, entre construction mythique et territoire, La Documentation Française, Paris, 1997.
PASTOUREAU M., Vert : Histoire d’une couleur, Paris, Seuil, 2013.
SPADONE P-L., « Bâtir un espace de mémoire », in Halbwachs M., Le temps, la mémoire et l’émotion, Paris, L'Harmattan, 2007.
ZBISS S. M., « Présence espagnole à Tunis ». Repéré le 4 Mars 2024. http://www.smzbiss.org/default.asp?id=10&mnu=10&page=17
[1] Littéralement le pluriel de qallal (potier), un style tunisois développé entre le XVIIe et le XIXe siècles aux influences ottomanes et européennes.
[2] PASTOUREAU M., Vert : Histoire d’une couleur, Paris, Seuil, 2013, p. 49.
[3] CANDAU J., Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 1996, p.71.
[4] Idem., p. 38.
[5] Idem., p. 3.
[6] HALBWACHS M., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1925), p.79.
[7] MÉTRAL J. (dir.), Mémoire collective et patrimoine dans les périphéries urbaines, entre construction mythique et territoire, Paris, La Documentation Française, 1997, p.42.
[8] CANDAU J, Anthropologie de la mémoire, Op. Cit., p.3.
[9] Ville située au nord de la Tunisie, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Tunis.
[10] ZBISS S. M., « Présence espagnole à Tunis ». http://www.smzbiss.org/default.asp?id=10&mnu=10&page=17
[11] HEINICH N, Ce que n’est pas l’identité, Paris, Gallimard, 2018, p. 47.
[12] CANDAU J., Anthropologie de la mémoire, Op. Cit., p. 118.
[13] BOURDIN A., Le patrimoine réinventé, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, p. 18.
[14] Cité par BOURDIN A, Le patrimoine réinventé, Op. Cit., p. 39.
[15] HALBWACHS M, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, p. 113.
[16] SPADONE P-L, « Bâtir un espace de mémoire », in Halbwachs M., Le temps, la mémoire et l’émotion, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 149.
[17] CANDAU J., Anthropologie de la mémoire, Op. Cit, p. 118.
[18] DASSIE V., Objets d’affection Une ethnologie de l’intime, Aubervilliers, 2010, p. 10.
[19] BOURDIN A., Le patrimoine réinventé, Op. Cit., p. 23.
[20] CANDAU J., Anthropologie de la mémoire, Op. Cit, p.115.