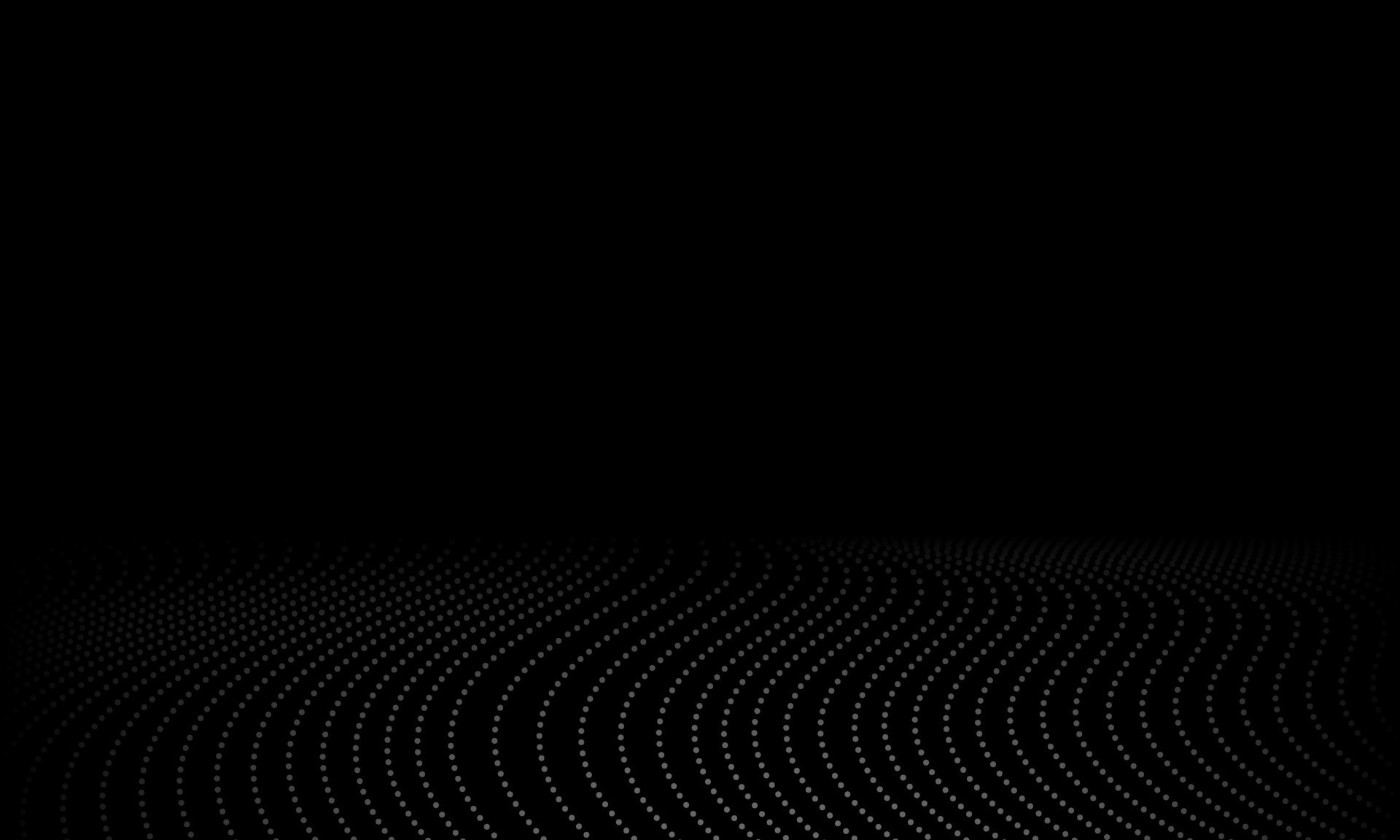Par Vincenzo Susca, MCF HDR au département de sociologie de l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Membre du LEIRIS.
REPRODUCTIBILITÉ DE L’ART ET VIE CONNECTIVE
La beauté de toute époque, lorsqu’elle implique et enveloppe une dimension collective de l’existence, est toujours un précieux indicateur de l’esprit du temps. En d’autres termes, l’esthétique présidant à l’être ensemble est la cause et l’effet d’une ambiance, d’une Stimmung, d’une manière d’être au monde, d’être avec l’autre. Dans le mystère qui recouvre notre rapport avec le beau[1], est toujours inscrite notre façon d’entendre le juste, le vrai et le bon. Ce cadre décèle également les institutions, la communauté et d’autres formes sociales dont nous sommes proches et que nous considérons comme crédibles. Voici la puissance du sentir[2] : partager avec l’autre un sentiment esthétique, une émotion ou une passion c’est esquisser les trames, les imaginaires et la sensibilité d’un corps social.
L’étincelle qui déclenche et sert de prodrome au changement de paradigme dont nous sommes en train de faire l’expérience peut remonter à la phase où s’amorce la reproductibilité technique de l’œuvre d’art. Cet événement apparemment anodin, qui résulte simplement de l’évolution d’exigences industrielles et de la manière de faire face aux problèmes qui y sont liés, représente en réalité, de manière souterraine, un passage aux conséquences sociales lourdes relatif, bien que même de manière imprévue et cachée, au déploiement des pratiques et des sensibilités enracinées dans la vie quotidienne. Walter Benjamin est celui qui a le mieux décrit, et en large partie anticipé, le sens social d’une telle mutation. De même que, dans l’ensemble de son œuvre, il a démontré l’instinct et la capacité extraordinaires d’entrevoir derrière les formes banales, éphémères et même commerciales de la vie moderne des spectres s’agitant dans l’imaginaire collectif, aptes à se matérialiser — à façonner la modernité. En ce sens, les fantasmagories évoquées par la marchandise, les vitrines, les panoramas et autres distractions de la culture de masse sont autant de signaux de formes sociétales qui commencent à investir des rêves et des émotions transcendant la pure matérialité de la production et de ses fins.
À bien des égards, le frisson que le flâneur des passages ressent sur sa peau, la fascination que l’individu éprouve dans les « mondes de rêve » parus entre le dix-huitième siècle et nos jours, l’attraction pour le « sex appeal de l’inorganique »[3] caractérisant la mode sont les matrices d’une fuite de la réalité économique, sociale et politique telle qu’elle avait été conçue par les sciences et les institutions sociales à partir des Lumières. En quelque sorte, l’univers de la technique et de ses artifices vit un processus de réadaptation radicale à partir du moment où il se déplace des usines – où il est pensé et mis en forme – aux contextes dans lesquels il se prête à être contemplé, consommé et consumé. Entre les deux espaces, l’objet-signe est absorbé, négocié et finalement recrée par le sujet social au moyen de son imagination créatrice[4], de son usage et des désirs qui l’animent.
Si nous voulons analyser dans toute leur portée les dynamiques transpolitiques de l’imaginaire contemporain, la manière dont la culture électronique bouleverse le paradigme de l’ordre institué, nous ne pouvons pas nous passer d’intercepter les modalités par lesquelles la communication médiatique a peu à peu fait siennes les formes du beau, les a intégrées dans ses constructions technosociétales, jusqu’à les faire correspondre aux corps disséminés dans la vie ordinaire. À cet égard, le processus d’esthétisation du quotidien attente directement à la sacralité du politique, car il en met en discussion la suprématie symbolique et le droit de représentation. La reproductibilité de l’œuvre d’art est ainsi l’origine cachée, le germe souterrain, de la reproductibilité numérique du politique[5], là où le public de jadis devient acteur, contenu primordial de la vie collective, de plus en plus connective.
LA RÉAPPROPRIATION DE L’ART
La pensée de Benjamin permet de mettre en lumière les aspects sur lesquels s’orientent au cours du dix-neuvième siècle les dynamiques de médiatisation de la politique d’abord et de politisation du spectacle ensuite. Par le premier mécanisme, on entend la disparition d’un rapport rigidement pyramidal, abstrait et à sens unique entre le pouvoir politique et la population, tandis que le second désigne le processus par lequel à un certain moment tout ce qui, jusqu’à la période précédente, se manifestait comme spectacle, amusement et pur divertissement, tend à se traduire en vie quotidienne et à revendiquer une volonté de puissance.
Selon Benjamin, « vers 1900, la reproduction technique avait atteint le niveau qui lui permettait […] de conquérir un rapport autonome entre les divers procédés artistiques »[6]. C’est pourquoi commençaient à s’insinuer entre les formes artistiques non plus la simple production d’objets ou de performances mais le fait même de traduire, de répliquer potentiellement à l’infini ce qui avait déjà été produit par d’autres. Il s’agit d’un levier central pour les temps à venir puisqu’il rendra possible, lorsque le processus acquerra une maturité complète, le revirement total tant de la dimension de ce qui est artistique que de la figure de son producteur. C’est ainsi qu’est créé un double flux – une dialogique – selon lequel la vie mondaine s’approprie progressivement, accueille en son sein, fait siennes les étincelles de l’art, de même qu’il incarne – dans le rôle de producteur d’outils de l’industrie culturelle naissante – le distributeur d’abord, puis le créateur de ces dernières, ensuite et enfin l’objet même, objet de consommation ou matière première du capitalisme de l’information sous forme de data utiles à nourrir les algorithmes réglant de plus en plus nos vies[7].
Il faut attendre la fin d’un long cycle avant que le présentateur des premières stations locales devienne le deejay assembleur de musiques des années 1970. Et c’est pourtant dans la phase initiale de ce parcours que sont établies les prémices technosociales pour un résultat de ce genre. L’objet artistique reproductible est ainsi englouti dans les enfers de la vie quotidienne, il perd sa fluorescence pour commencer à se compromettre et à se confondre avec les belles choses de mauvais goût présentes dans la vie quotidienne et dans ses riches magasins négligés. Ce n’est pas un hasard si on a défini l’esprit du numérique comme une culture du remix[8]. Si au départ le dj – tel le consommateur-producteur sur lequel ont écrit Karl Marx, Alvin Toffler ou encore Michel de Certeau – se limite à sélectionner les musiques d’autrui, le temps passant cet acte devient la source d’une véritable recréation, jusqu’à attribuer aux protagonistes des consoles le rôle de star[9]. À bien y regarder, ce sont eux qui rythment le temps musical de notre époque en tant que danse perpétuelle – joie tragique.
La reproductibilité technique de l’œuvre d’art permet à cette dernière « d’aller au-devant du bénéficiaire […]. La cathédrale abandonne son emplacement pour être accueillie dans le bureau d’un amateur d’art ; le chœur qui a été exécuté dans un auditorium ou en plein air peut être écouté dans une chambre »[10]. À première vue, pour les observateurs les moins attentifs, ce passage peut sembler n’être qu’un déplacement du même objet dans de nouveaux contextes, afin de lui permettre de s’étendre au-delà de son lieu d’origine. Toutefois, la « dévalorisation de son hic et nunc » conduit l’objet artistique à une corruption radicale de son « authenticité » et de sa mission sociale : il n’induit plus une contemplation révérencieuse, il ne répond plus à des principes pédagogiques, il n’a plus vraiment de lien avec le sacré.
L’intervention de la technique comme agent de reproduction, de multiplication et de traduction de l’objet original fait que la 9e Symphonie de Beethoven peut être écoutée comme intermède entre deux publicités des programmes radiophoniques, en modifiant la nature attentive, ritualisée et sérieuse de sa réception. Depuis les années 1880 – quand les souvenirs et les gadgets commencent à être produits en série –, après les expérimentations du pop art et dans le plein essor de la société de consommation, il apparaît de manière évidente que la reproductibilité constitue le début d’une mutation irréversible de l’objet esthétique, qui devient graduellement un dispositif de loisir apte à enchanter le quotidien, à lui conférer une aura jouissive, fun et spectaculaire. La vie ordinaire engloutit avidement toute forme précédemment inscrite et utile au paradigme du beau pour la prêter à la satisfaction de ses propres désirs les plus immédiats, fantasmatiques et charnels.
Nous assistons ainsi, au tournant du vingtième siècle, au commencement d’un long processus de réappropriation sociétale des formes artistiques, une vague de fond qui, en emportant les pièces artistiques vers le public, enivrera dans un premier temps ce dernier d’art et le revêtira d’une forme artistique, capillarisant dans l’existence ordinaire la mission que s’était donnée Oscar Wilde dans Le portrait de Dorian Gray de faire de la vie une œuvre d’art. Ainsi, la prophétie de Nietzsche se réalise : « L’homme n’est plus artiste, il est devenu œuvre d’art : ce qui se révèle ici dans le tressaillement de l’ivresse, c’est, en vue de la suprême volupté et de l’apaisement de l’Un originaire, la puissance artiste de la nature tout entière »[11].
La dimension du bios, de l’existence en tant que telle, est la dernière destination de ce flux, son accomplissement. Cela ne sera pleinement évident qu’à partir du moment où les langages numériques, les réseaux sociaux et tout ce qui concerne l’esthétisation du vécu envelopperont le corps de tout un chacun, entre le web et la rue, d’une lumière nouvelle. Leur principale vertu, en ce sens, demeure dans la possibilité livrée au corps social d’exprimer à la fois ses pulsions matérielles et corporelles, le bas à propos duquel écrit Bakhtine ses élans fantasmagoriques et sa poétique de l’être-là, d’habiter le monde[12].
Les synergies quotidiennes établies dans ce cadre, entre les merveilles et les ombres, le céleste et le terrestre, l’onirique et le sensible n’aboutissent pas simplement au devenir œuvre du public, mais promeuvent également le devenir public de l’art, ainsi qu’une réversibilité entre sujets et objets. Le « devenir public de l’art » signifie la dispersion du beau dans les ramifications de la vie ordinaire, là où la beauté de l’être-là et de l’être ensemble prévalent sur toute autre esthétique canonisée et muséifiée. En même temps, cela renvoie à une nouvelle et inédite réification du public, car en devenant œuvre il se prête à être contrôlé, manipulé et consommé selon les mêmes règles qui régissent le système des objets. C’est exactement ce qui se passe dans la vie numérique en réseau, sur Tinder, Instagram, Yourporn, Tik Tok ou Twitch, où en effet le sujet devient œuvre, contenu primordial de la communication, tout en étant impliqué dans des trames qui en font une information parmi les datas, une marchandise parmi les produits des vitrines numériques. D’une certaine manière, il arrive à tout un chacun ce qui se passait au début du star system, lorsque les premières célébrités étaient en même temps enivrées et consumées par leur popularité. À l’époque, James Dean et Marylin Monroe avaient payé de leur vie cette dynamique. Aujourd’hui, il en est de même pour ce qui concerne la crise de l’autonomie individuelle dans l’existence électronique, à savoir la « mort » du sujet en ligne, et parfois même la mort physique, par suicide, des personnes incapables de survivre à la visibilité de leurs histoires privées.
Il y a là, à bien des égards, un changement de paradigme par rapport à notre tradition sociologique et culturelle. Mario Perniola, dans la foulée de la pensée benjaminienne, aura raison de parler de l’homme comme objet sentant et de l’objet comme chose sentante[13], car en effet la compénétration contemporaine entre bìos et technè nuance les différences entre ces ordres, qui se retrouvent désormais intriqués dans une même mosaïque.
TECHNIQUES DE LA DISTRACTION
Au niveau de la personne, les nouvelles technologies électroniques, en particulier celles qui entrent le plus en contact avec notre corps, ouvrent une brèche dans le sujet en y injectant plusieurs doses d’altérité technosociétale. En effet, c’est une invitation — une initiation — à se perdre dans l’autre et à retrouver un nouvel équilibre avec tout ce qui l’entoure. Il s’agit d’un éclatement de l’être, de sa fuite vers l’ailleurs, de son invasion par l’ailleurs. Bref, en tant qu’humain, il n’est plus ni le centre du monde, ni au centre du monde ; « ce qui disparaît est en somme ce qui peut être résumé par la notion d’aura ; et l’on peut dire que ce qui disparaît à l’époque de la reproductibilité technique est l’aura de l’œuvre d’art. Le processus est symptomatique, sa signification renvoie au-delà du champ artistique »[14].
Dans ce passage est inscrite l’interprétation la plus efficace et prophétique de la signification sociale d’un fait, la reproductibilité de l’œuvre, apparemment seulement technique mais en réalité fondamental en ce qui concerne le devenir des formes esthétiques, de la société de masse et de ses systèmes de pouvoir-savoir. La disparition de l’aura de l’œuvre d’art indique que l’objet extérieur au corps social, provenant d’un au-delà en quelque sorte magique transcendant l’hic et nunc, subit une relativisation qui le vide de sa faculté de séduire et d’envoûter le public. En perdant son autorité morale, l’univers artistique prive son référent politique, le système qui le préside, de sa puissance symbolique. S’il est vrai que la démocratie moderne se fonde sur la correspondance entre la loi et les coutumes[15], que celle-ci est à son tour alimentée par l’adhésion symbolique du corps social aux élites, force est de constater qu’aujourd’hui ce lien a été rompu exactement dans la mesure où le quotidien, ce qui était en bas, ne se reflète plus dans les formes esthétiques du haut mais en soi-même et dans toutes ses extensions technosociétales, des réseaux numériques au street art, du rap au funk et à la techno en passant par le cosplay, les jeux de rôle et les street parties.
Les traditions légitimées et consolidées au cours de la modernité, autrement dit ses organisations, ses institutions et ses conseils, perdent ainsi d’un coup le dispositif esthétique qui leur a permis de cristalliser la différence entre elles et la rue, de se placer de l’autre côté de la barrière, cette frontière qui s’illustre par exemple à travers la distance qui, dans tout musée, sépare l’œuvre du public. L’espace sacré du musée, là où les nouveaux pèlerins de la société doivent se rendre pour racheter leur ignorance et pour contempler la beauté, est la zone à haute densité symbolique dans laquelle sont abrités le secret et le monopole du pouvoir de l’État et de ses avatars. Le bon goût et le savoir, élevés à des valeurs suprêmes, défendus et distribués scientifiquement, sont les leviers à l’aide desquels le corps social est organisé dans une finalité dialectique entre production du savoir et engendrement du pouvoir. Le musée est le lieu sacré, une sacralité laïque, l’archétype du rapport de pouvoir léger et totalisant qui régule la relation entre élite et masse à l’époque de la démocratie. En son intérieur, la ligne d’ombre entre l’œuvre et la barrière que le public ne peut jamais franchir acquiert une valeur particulière. C’est la métaphore de l’imposition de la loi et des règles selon lesquelles public et gouvernants, représentés et représentants, sont tenus d’en rester à leur rôle respectif : le premier de contempler avec révérence, le second de gouverner en diffusant splendeur et haute destinée sur les masses. De la même façon, dans tout musée, il est interdit de danser, crier, manger… bref, de faire entendre la voix du corps, qui doit au contraire rester à l’ordre de la raison.
L’objet artistique doit ici être contemplé en silence, avec admiration ou au moins discrétion, sans pouvoir être touché ni, au fond, discuté, puisque tout dans un musée est organisé de manière que le visiteur se déplace dans un cadre déterminé et fermé de sens possible. Ce modèle est, à bien y regarder, le contraire de celui qui s’expérimente dans les jeux linguistiques des plateformes communicatives horizontales et interactives en réseau, où l’espace du plaisir, du jeu et de la fête en tant que beauté, est le résultat de la socialité électronique et des affinités connectives qui la composent. L’effondrement de la frontière entre œuvre et public amène lentement, mais inéluctablement, à la confusion des deux domaines. Voilà pourquoi ce dont il s’agit « renvoie au-delà du champ artistique ».
La technique de la reproduction, comme la chose pourrait être formulée, soustrait le reproduit au domaine de la tradition. En multipliant la reproduction, elle met à la place d’un événement unique une série quantitative d’événements. Et en permettant à la production de venir à la rencontre de celui qui en jouit dans sa situation particulière, elle actualise le produit. Les deux processus mènent à un violent bouleversement qui investit ce qui est transmis – à un bouleversement de la tradition, qui est l’autre face de la crise actuelle et de l’actuel renouvellement de l’humanité. Ils sont étroitement liés aux mouvements de masse de nos jours[16].
Les masses, le grand résidu de la modernité – sujet à la fois créé et craint par l’ordre institué –, sont imprudemment dotées d’un instrument qui leur donne la possibilité d’implémenter leurs propres « quantités » disproportionnées de nouvelles « qualités », au désavantage des gardiens du pouvoir. Ce qui est « reproduit » se sépare du producteur et de son cercle d’interprètes fidèles, mais est aussi déplacé de la scène – le musée et ses corollaires – qui l’avaient doté de sa magie et de sa suprématie. L’actualisation de tout produit en question devient ainsi l’antichambre d’une sensibilité inconciliable avec les stratégies des producteurs. Elle s’instaure en toute discrétion sur fond d’une distraction généralisée, de loisirs ou de fantaisies. En l’occurrence, l’œuvre est adaptée au quotidien et appropriée par lui afin de l’esthétiser, de le rendre agréable et « joli ». Elle finit par être définitivement détournée lorsque l’habiter poétique – la poétique du quotidien – prévaut sur les instances de l’art et sur les formes artistiques. En ce sens, le pop art, les esthétiques urbaines et l’industrie culturelle ne sont que des prémices du devenir œuvre du public et de sa vie ordinaire déclenché par les stories d’Instagram, les selfies, les reels et les snaps. Selon Marx, l’acte de la consommation constitue la phase finale de la production, le finish du consommateur étant la manière dont la marchandise prend vie dans le cadre du quotidien. C’est, en quelque sorte, sa suite, sa recréation, l’œuvre dont le corps social est le véritable artiste – pour le dire en d’autres mots. Nous sommes ainsi face au finish final et décisif du consommateur – mieux, nous sommes immergés en lui –, là où il devient œuvre. Ce final décèle aussi une fatalité. Renvoyant à l’accomplissement d’un processus, il n’annonce pas seulement la mort de l’art évoqué par Hegel[17], mais aussi celle du public…
Ce genre de performance, avant son achèvement ultime, revêt un ton violent quand les « masses » la mettent en œuvre contre le sens dans lequel l’œuvre originale a été pensée. La violence destructrice est ainsi le visage obscur de la consommation et Benjamin en distingue dès le début les qualités potentiellement subversives, précisément là où l’œuvre est accueillie au sein tumultueux d’une vie quotidienne irréductible à tout ordre qui ne soit pas le sien, selon la loi des frères. Le bouleversement de la tradition est alors le corollaire de l’émergence de pratiques enracinées dans un passé archaïque et en même temps effleurées par des visions futuristes. Voilà que, pour Benjamin, le retour en quelque sorte trivial de la culture a immédiatement à voir avec une destruction générale de ce qui est donné et de ce que les savoirs, les pouvoirs et les institutions ont laissé se sédimenter. La qualité fondamentale des moyens de communication de masse, celle qui a souvent échappé à ceux qui les ont mises en forme et élaborées à des fins politiques ou commerciales, réside ainsi dans sa capacité à entrer en synergie avec le corps social et de devenir son ambiance, son territoire, son paysage, mediascape intégrant le bodyscape et le bodyscape devenant medium. Le corps social se prolonge dans un scénario qui lui permet de satisfaire une série de désirs immédiatement associés à un renouvellement général de son existence, en remettant en discussion les traditions et les canons sédimentés depuis longtemps dans nos sociétés. Les médias interprètent ici le rôle de puissants espaces de communion : ils actualisent l’être ensemble, corroborent la communauté et sacrifient tout ce dont elle n’a plus ni besoin ni envie pour être là. De manière particulière, le défi le plus prégnant revient, à toute époque, au médium le plus nouveau, à celui qui est capable de garantir l’équilibre entre la continuation et le renouvellement des formes sociales. À l’époque où Benjamin écrit, il y a un vecteur extraordinaire des intentions conscientes et inconscientes des masses : « Leur agent le plus puissant est le cinéma. Sa signification sociale, même dans sa forme la plus positive, voire précisément dans celle-ci, n’est pas pensable sans sa forme destructrice, cathartique : la liquidation de la valeur traditionnelle de l’héritage culturel »[18].
Pour notre part, nous considérons ce point comme fondamental bien que négligé par presque tous les interprètes de la pensée de Benjamin et, en général, par la plupart des médiologues et des sociologues de la communication. Gilbert Durand est à ce propos une heureuse exception, puisqu’il réussit à identifier combien l’invasion des marchés et des esprits par des panoplies techniques et des images médiatiques agit subrepticement en faveur d’une production souterraine d’ « effets pervers », dirigés contre les producteurs mêmes des communications et des objets manipulés par le corps social[19]. L’auteur y parvient surtout en prenant en considération la dimension de l’imaginaire, avant et bien plus encore que le discours sur les instruments ou sur les fonctions des médias. En effet, dans ce royaume invisible mais sensible, derrière chaque consommation de masse, se produit aussi une destruction, « la liquidation de la valeur traditionnelle de l’héritage culturel », au nom d’une tradition plus ancienne et d’un présent sans autre finalité, pour celles et ceux qui l’habitent, que l’être-là, ici et maintenant.
L’AURA DU QUOTIDIEN
À partir du moment où commence à se manifester une friction entre les masses et l’univers esthétique, quand le second cesse d’être un objet à contempler à distance et avec révérence, et que l’œuvre d’art se rapproche de la personne, les masses inaugurent un processus d’appropriation du monde des objets et des images qui les amène à devenir toujours plus avides, en quelque sorte à grossir, selon un paradigme proche de l’obésité et de l’obscénité chez Baudrillard[20]. Il y a là une espèce de volonté de puissance du corps social de par la proximité établie entre la vie quotidienne, les images et le système des objets. Pour bien saisir cette dynamique, il faut explorer dans ses racines et dans ses surfaces le « conditionnement social de l’actuelle décadence de l’aura. Elle se fonde sur deux circonstances, toutes les deux reliées à l’importance toujours plus grande des masses dans la vie actuelle. Et c’est-à-dire : rendre les choses, spatialement et humainement, plus proches est pour les masses actuelles une exigence très vive, autant que la tendance au dépassement de l’unité de tout élément quel qu’il soit par la réception de sa reproduction »[21].
La modernité, en effet, a joué sur une distanciation générale des choses et des autres, selon une logique de la séparation. En misant sur l’abstraction et sur l’universel, elle a orienté ses projets vers des objectifs lointains, valables pour tout en chacun et n’importe où, qui requièrent le sacrifice de la jouissance, du présent.
À l’inverse, la culture contemporaine que nous sommes en train d’explorer investit sur ce qui est proche et en contact étroit avec à la fois le sensible et l’imaginaire. À bien y regarder, la reproductibilité technique de l’œuvre d’art est un processus fondamental ayant soutenu ce changement de paradigme actualisé depuis la seconde moitié du dix-neuvième siècle.
L’authenticité de l’œuvre est l’équivalent de l’unité et de la séparation de l’individu, de sa distance par rapport aux autres et au monde. À partir du moment où ces principes s’effritent, toutes les cages identitaires, économiques et politiques du monde moderne semblent en crise. Rendre les choses plus proches signifie, pour le sujet, les tirer à soi, les faire siennes et, en même temps, traduire ce qui est authentique et unique en quelque chose de reproductible et de commun. Le sujet bourgeois est au produit esthétique authentique et lointain ce que les masses sont à l’esthétisation de l’existence et à l’absorption de ce qui les entoure. « L’unité de l’œuvre d’art s’identifie à son intégration dans le contexte de la tradition »[22], tandis que sa reproductibilité et sa trahison sont la mesure de l’écart existant entre la vie quotidienne et la tradition elle-même.
Cette redéfinition mine la condition de l’homme moderne, son équilibre sensoriel, son rapport avec ce qui lui est intérieur et extérieur, et même son point de vue. Ce qui appartient à l’ordre du visuel et qui est apte à établir une différence-distanciation entre l’individu et son altérité, cède le pas à la réémergence du caractère tactile de l’expérience[23], quand le toucher — toucher et être touché — devient l’axe porteur de la vie quotidienne, la marque de la socialité au-delà et en deçà du sexe. Les caresses caractérisant notre rapport aux tablettes et aux smartphones, les swipes de Tinder, les share et les emojis, en ce sens, ne sont que les métaphores d’un rapprochement généralisé, d’ordre emphatique à l’autre, par une interaction fondée sur le sentir et sur l’émotion plus que sur le voir et sur l’abstraction. Benjamin, grâce à sa capacité de comprendre les médias, les surfaces et les fantasmagories de son époque, a été le premier à entrevoir ce passage cru- cial : « Chaque jour, l’exigence de prendre possession de l’objet à une distance le plus proche possible dans l’image, ou mieux dans l’effigie, dans la reproduction, se fait valoir de manière toujours plus incontestable »[24].
L’image est ainsi investie de la délicate mission de reconnecter le corps social à ce dont il a été précédemment séparé, de permettre fondamentalement une appropriation du monde qui est aussi le début de sa recréation. Icônes, objets, informations et symboles sont ainsi engloutis dans le ventre de la vie ordinaire et réadaptés à ce qui est actuel et quotidien. Au contraire de ce qui est communément écrit sur la mondialisation et le rôle joué à l’intérieur de ce processus par les médias, l’imaginaire est un régime à travers lequel on tire à soi les choses du monde, on active un processus de participation dans lequel ce qui est proche entre en liaison avec ce qui est éloigné.
Dans ce cadre, l’image médiatique est bien un mésocosme, un dispositif au travers duquel on se conjugue à l’étranger et au mystérieux : la nature, la technique, le ciel. La rigide séparation entre le soi et l’autre, fille de la culture alphabétique qui a façonné la modernité occidentale est alors graduellement abandonnée en faveur d’une confusion généralisée, d’une compénétration rappelant le holisme, d’une participation qui évoque la technomagie plus que la technologie[25]. Ce n’est pas un hasard si les mots clés des cultures numériques sont « interaction », « immersion », « connexion », autant d’indices témoignant la communion, la confusion, l’ordre matriciel[26]. Par conséquent, on comprend mieux pourquoi tout en étant de plus en plus dépendant du milieu technique, nous nous approchons également de la nature. Le retour du bio, la deep ecology (Drengson, Inoue), l’ordre végan (Celka), le tri sélectif, les vacances vertes, la sustainable economy (Combes) et l’éthique de la décroissance (Latouche) apparaissent alors comme des symptômes d’une nouvelle conjonction entre les êtres humains et l’environnement qu’ils ont considéré pendant longtemps comme un objet à conquérir, à occuper et à manipuler à leur guise. Au contraire, la trame qui nous relie à l’univers technique est la même que nous associons désormais à la Terre Mère. Dans un cas comme dans l’autre, le sujet fait un pas en arrière par rapport à ce qui l’entoure, mais c’est un pas de danse. Il finit par y dépendre de la même manière qu’on dépend de la personne qui mène le bal. C’est cela un des axes du post humanisme signalant la crise de l’anthropocentrisme. Il y a là également un sacrifice de l’humain, car la confusion en question implique des pertes pour l’individu : le renoncement à soi et au soi.
La fonction de l’art, et en particulier du moment rituel de sa jouissance, a été, au moins à partir de la Renaissance, celle de traduire et disloquer les sentiments et les sensations induits par la contemplation de l’œuvre vers les systèmes symboliques de pouvoir et de savoir la présidant : que ce soit le seigneur, le prêtre ou le mécène, il s’agissait toujours d’adhérer à un ordre supérieur au quotidien, au nom de la beauté, et dont la supériorité se faisait vectrice, source et garantie. Par conséquent, cette correspondance esthétique servait à légitimer la suprématie morale et politique du pouvoir institué sur la vie ordinaire. L’image est ainsi le trait d’union entre le public, la masse – ou encore avant, la « populace » –, et le corps du souverain qui, de la lumière de la première, tire la lymphe vitale pour corroborer son statut. L’extase individuellement éprouvée face à l’objet unique et authentique, exposé de manière austère et pompeuse dans le musée, fait donc un avec l’approbation d’un ordre institué et avec l’inscription dans le cadre d’une communauté sociale imaginée, celle qui sert de prétexte identitaire au Léviathan[27].
Le rite de l’admiration d’une œuvre est le levier qui confirme et renforce le mythe sur lequel se fonde et se renouvelle lentement l’ordre établi. La distinction entre le sacré et le profane est la matrice archétypique sur laquelle s’oriente aussi, pendant la modernité, la séparation entre pouvoir institué et puissance instituante, entre les formes belles de celui qui gouverne et celles plus basses et banales expérimentées dans le cadre de la vie quotidienne. Si les premières maintiennent une sacralité les rendant transcendantes, fondatrices et emblématiques, l’espace du quotidien devient naturellement la marge de ceux qui gouvernent, une ramification du pouvoir – le miroir du politique. Le rituel de la contemplation s’inscrit alors dans la tradition, en satisfaisant la permanence de ses gardiens et en dissipant dans leur corps les énergies agitées dans l’émotion esthétique.
Le mode originaire d’articulation de l’œuvre d’art dans le contexte de la tradition trouvait son expression dans le culte. Les œuvres d’art les plus anciennes sont nées […] au service d’un rituel, d’abord magique, puis religieux. […] La valeur unique de l’œuvre d’art authentique trouve sa fondation dans le rituel, dans le cadre où elle a eu sa première valeur d’usage originaire […] la reproductibilité technique de l’œuvre d’art, pour la première fois dans l’histoire du monde, émancipe cette dernière de son existence parasitaire dans le cadre du rituel. L’œuvre d’art reproduite devient dans une mesure toujours plus grande la reproduction d’une œuvre d’art prédisposée à la reproductibilité[28].
Le rituel dont l’œuvre d’art tire son origine comme expression et moyen est en réalité reconfiguré, et non éteint, par le processus de reproductibilité. Benjamin, quand il écrit, pense à une image glorieuse, traditionnelle et transcendante du rite : il pense aux formes anciennes de la religion[29], dans lesquelles le plaisir esthétique et l’implication émotionnelle sont des prétextes permettant au public d’adhérer à un système éthique et symbolique, en interprétant le rôle de spectateur aux allures de fidèle. La reproductibilité technique de l’œuvre d’art, en revanche, inaugure le déplacement lent mais progressif de la faculté d’orienter le sens, les communications et les imaginaires du haut vers le bas, du centre vers la périphérie de la vie collective, dans ses trames horizontales, selon des gouts, des styles de vie et des affinités électives, puis connectives. Elle traduit graduellement le public en artiste et en même temps en œuvre, sujet de la recréation et objet de contemplation, manipulation et consommation.
Dans ce contexte, les rituels changent de forme. Le « pèlerinage » dans les cathédrales classiques de la culture, selon le mot cher à Benjamin, n’a pas disparu mais est transfiguré sous l’impulsion d’architectures émotionnelles et sensuelles misant sur le spectacle, la marchandise et le loisir. En ce sens, les musées sont reconfigurés en dispositifs stupéfiants et divertissants à l’aide de bars, cafés, espaces multimédias et magasins de souvenir, qui deviennent de plus en plus leurs véritables hauts lieux. D’une certaine manière, le touriste ou le visiteur ne s’y rend plus vraiment pour contempler l’œuvre unique et authentique, mais pour vivre un moment de socialité ou de convivialité. Si jadis, d’ailleurs, le gadget et le souvenir muséaux étaient des traces servant à rappeler au spectateur l’expérience artistique vécue, aujourd’hui ils sont des véritables fétiches. Exit Through The Gift Shop, le mockumentary de Banksy (2010) portant sur le street art et sur les misères de l’art contemporain, visait justement à mettre en avant la dimension marchande et éphémère du secteur. En effet, en visitant les musées et notamment ceux de nouvelle génération, force est de constater non seulement l’hyperprésence des gift shops à la sortie, mais leur centralité, souvent même à l’entrée de ces lieux.
Le souvenir n’est plus à proprement parler un simple souvenir mais l’œuvre même que le touriste, fan et spectateur, désire le plus, celle qui l’accompagnera chez soi et qui lui permettra d’esthétiser son quotidien, en lui conférant une aura. L’aura du quotidien. C’est l’avant-dernière étape du processus décrit par Benjamin en tant qu’absorption de l’art dans le ventre du public, la dernière étant le devenir œuvre du public et même son devenir souvenir, chose et gadget, comme cela arrive avec les profils des réseaux sociaux, les photos d’Instagram, les memoji, les stickers, les mèmes, les Gifs et toute autre réification électronique des individus en ligne. Cela a lieu dans le cadre de nouveaux rituels qui certes n’ont rien à voir avec les files d’attente pour accéder au Louvre ou au musée du Vatican et qui ne répondent pas aux canons des manuels artistiques. Cependant, dans la manie des selfies et dans le déploiement de <3 en ligne, dans l’élaboration de stories et de reels, dans le montage de mèmes, jusqu’à la mise en scène d’une intimité esthétisée sur Tik Tok et Instagram en passant par le choix soigneux des photos de profil Tinder ou Grindr, force est de constater l’avènement et la prolifération de pratiques sociétales symboliquement denses, causes et effets d’émotions, cérémonies et communions. Elles ne sont plus adressées à des autels surplombants, au nom de vérités universelles et abstraites — les grands récits — mais se concentrent plutôt sur l’effervescence de ce qui est proche et quotidien, de ce qui a à voir avec l’ordre des pairs : les affinités connectives, l’être ensemble sans finalité. Le quotidien devient ainsi, pour le meilleur et pour le pire, selon un esprit qui évoque la sacralité sauvage chère à Bastide, un musée à ciel ouvert dont « la révolte est le plaisir même, et c’est aussi ce qui se joue de toute pensée »[30].
BIBLIOGRAPHIE
ABRUZZESE A., La puissance de la beauté, Paris, L’Harmattan, 2007 (1998).
ANDERSON B., L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996 (1983).
ATTIMONELLI C., Techno. Ritmi afrofuturisti (2008), Rome, Meltemi, 2018.
BAKHTINE M., L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Gallimard, Paris, 1998 (1965).
BATAILLE G., Le souverain, Montpellier, Fata Morgana, 2010.
BAUDRILLARD J., Mots de passe, Paris, Fayard, 2000.
BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000 (1936).
CARDON D., À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data, Paris, Seuil, 2015.
DURAND G., Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, 1996.
_, L’imagination symbolique, Paris, PUF, 1964.
DURKHEIM É., Sociologie et philosophie, Paris, PUF, 2002 (1924).
HEGEL W. F., Esthétique, Paris, Aubier, 1944 (1835).
Les cahiers européens de l’imaginaire, n°3, « Technomagie », Paris, CNRS Éditions, 2011.
LESSIG L., Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, New York, Penguin Books, 2008.
MCLUHAN M., D’œil à oreille, Paris, Denoël, 1977.
NIETZCHE F., La naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, 1997 (1872).
OBADIA L., L’anthropologie des religions, Paris, La Découverte, 2012 (2007).
PERNIOLA M., Del sentire, Turin, Einaudi, 2002.
_, Le sex-appeal de l’inorganique, Paris, Léo Scheer, 2003 (1994).
SUSCA V., Les affinités connectives. Sociologie de la culture numérique, Paris, Cerf, 2016.
[1] ABRUZZESE A., La puissance de la beauté, Paris, L’Harmattan, 2007 (1998).
[2] PERNIOLA M., Del sentire, Turin, Einaudi, 2002.
[3] ID., Le sex-appeal de l’inorganique, Paris, Léo Scheer, 2003 (1994).
[4] DURAND G., L’imagination symbolique, Paris, PUF, 1964.
[5] SUSCA V., Les affinités connectives. Sociologie de la culture numérique, Paris, Cerf, 2016.
[6] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000 (1936).
[7] CARDON D., À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data, Paris, Seuil, 2015.
[8] LESSIG L., Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, New York, Penguin Books, 2008.
[9] ATTIMONELLI C., Techno. Ritmi afrofuturisti (2008), Rome, Meltemi, 2018.
[10] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit.
[11] NIETZCHE F., La naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, 1997 (1872).
[12] BAKHTINE M., L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Gallimard, Paris, 1998 (1965).
[13] PERNIOLA M., Le sex-appeal de l’inorganique, Paris, Léo Scheer, 2003 (1994).
[14] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit., p. 23.
[15] DURKHEIM É., Sociologie et philosophie, Paris, PUF, 2002.
[16] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit.
[17] HEGEL W. F., Esthétique, Paris, Aubier, 1944 (1835).
[18] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit.
[19] DURAND G., Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, 1996.
[20] BAUDRILLARD J., Mots de passe, Paris, Fayard, 2000.
[21] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit., p. 24.
[22] Idem., p. 25.
[23] MCLUHAN M., D’œil à oreille, Paris, Denoël, 1977.
[24] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cit.
[25] Voir Les Cahiers européens de l’imaginaire, n°3, « Technomagie », Paris, CNRS Éditions, 2011.
[26] SUSCA V., Les affinités connectives, Op. Cit.
[27] ANDERSON B., L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996 (1983).
[28] BENJAMIN W., « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Op. Cti., p 26.
[29] OBADIA L., L’anthropologie des religions, Paris, La Découverte, 2012 (2007).
[30] BATAILLE G., Le souverain, Montpellier, Fata Morgana, 2010.