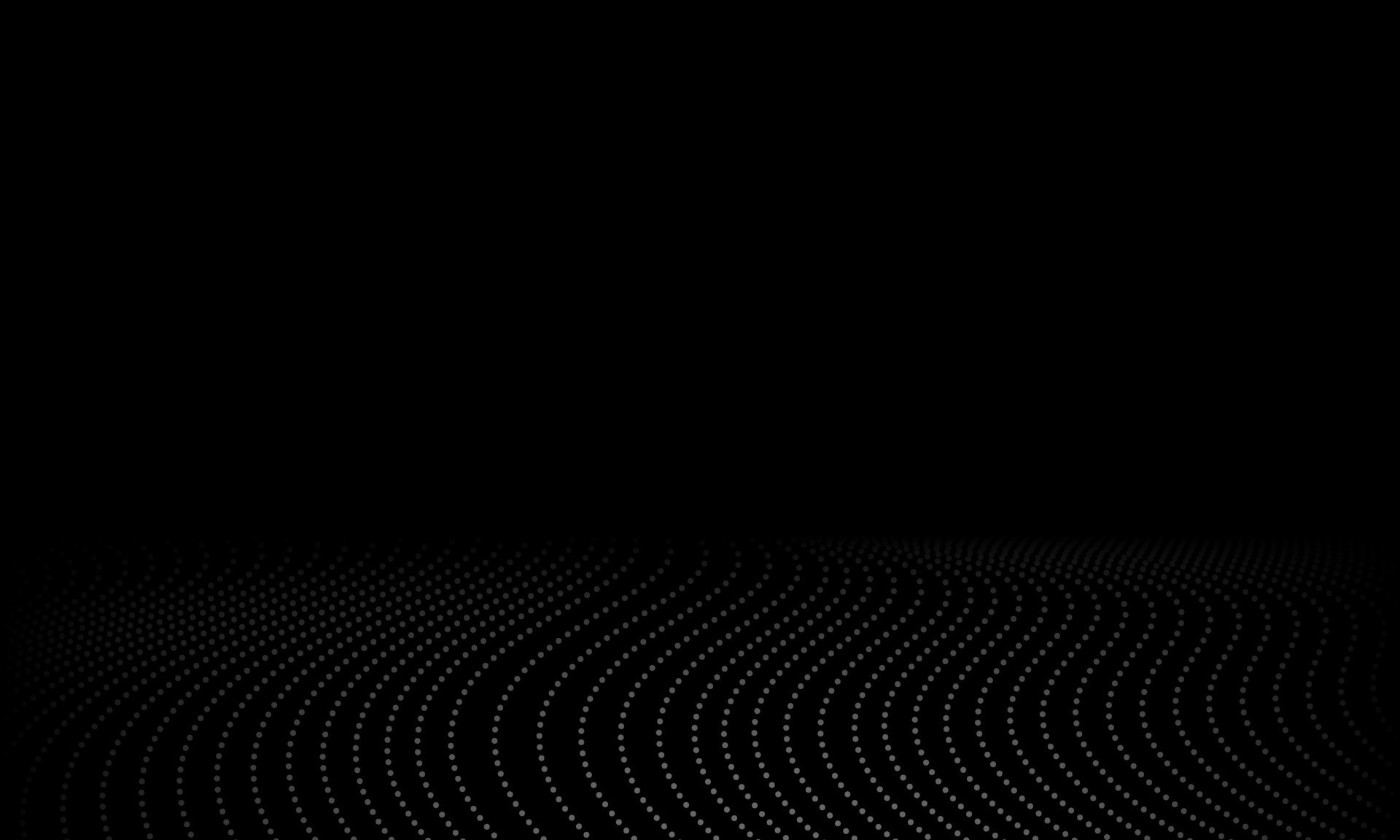Par Vincenzo Susca, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et chercheur au LERSEM-IRSA.
Toutes les grandes époques de culture sont des époques de décadence politique : ce qui a été grand au sens de la culture a été non-politique, et même anti-politique, Friedrich W. Nietzsche, Le crépuscule des idoles.
Barbares et civilisation
Insensibles, dans la plupart des cas, aux impulsions politiques et aux désirs de pouvoir, animés par des instincts hédonistes et passionnels, les nouveaux barbares[1] se disjoignent de la perspective linéaire, émancipatrice et abstraite qui a caractérisé les élites modernes et les classes sociales qui en suivaient le sillon.
Une fois établi que les nouveaux barbares sont plus « natifs » qu’étrangers, habitants de tout l’ailleurs qui réside dans les lieux où la civilisation ne peut entrer si ce n’est de façon stérile et contre-productive pour elle-même, nous sommes appelés à revoir la phénoménologie de l’étranger, de l’altérité, dont la modernité s’est servie pour établir ses frontières et projeter sa production. Les stéréotypes par lesquels ont généralement été confrontés les thèmes de la démocratie, de la postmodernité et des sociétés en réseau, se basent précisément sur le recours à l’idée selon laquelle les facteurs de la barbarisation, les agents destructeurs viennent du dehors, de l’extérieur : qu’ils soient incarnés dans les technologies considérées comme violentes et dépourvues de mémoire, culturellement inexpertes et pauvres en tradition et civilisation ; qu’ils soient également incarnés dans les désirs et les expériences d’une sensibilité instinctive et inculte, hédoniste et passionnelle, violente comme les consommations, les imaginaires et les technologies vers lesquels ils manifestent le plus de vocation ; ou qu’ils soient, enfin, les dérives humaines des territoires historiques de la citoyenneté et de la civilisation.
L’espace incompris, que chaque civilisation laisse à la dérive comme un détritus, en s’auto-constituant précisément à l’intérieur de ses frontières statutaires, est le lieu expiatoire, ségrégué, mystérieux, au-delà et en deçà duquel s’établit la différence entre le barbare et le civilisé, entre celui auquel on ne reconnaît aucune capacité expressive et celui que cette capacité expressive – devenue règle et loi, éthique et esthétique – avantage. Cela signifie que, face à un sujet vivant, et au-delà de sa vie nue, se constituent des morales et des esthétiques capables de l’encadrer dans un discours et dans une forme d’expérience sans trop porter attention aux vides, aux déchets et aux ombres que ces stratégies négligent ou veulent gouverner. Ainsi, même la « citoyenneté » – celle qui mûrit et reste à l’intérieur de ses murs d’enceinte – en intégrant et incluant une tranche déterminée d’humains, les rendant ainsi des citoyens de cette inclusion, en exclut d’autres « en les laissant dehors »[2].
La civilisation constitue le terrain de culture de la barbarie en tant que principe discriminant entre ce qui est évolué et ce qui est primitif[3]. Le barbare est l’autre face de tout processus de civilisation, sa motivation pour continuer. Le point de crise de la démocratie italienne, par exemple, a été identifié dans sa résistance insuffisante face aux hordes barbares télévisées du peuple de Berlusconi (celui-ci ayant anticipé de vingt-cinq ans la catastrophe de la démocratie américaine incarnée par D. Trump). Mais son vrai point de crise est constitué par la propension à ne pas savoir et ne pas vouloir lire la nature de cette soudaine invasion et dévastation, précisément comme cela se produit aujourd’hui au niveau global avec l’émergence des cybercultures et des cultures urbaines[4], mais aussi, bien entendu, en ce qui concerne le cas des États-Unis.
Les barbares sont ceux qui sont exclus et qui, pour cela même, sont secrètement invités à transgresser et à passer par-dessus les murs de la forteresse. Ce que nous voulons exprimer, c’est qu’après avoir tenu le rôle de marginaux, autrefois regroupés en nœuds sociétaux, capables de partager et d’élaborer un monde et son imaginaire, prêts à manipuler langages, relations et symboles, ils se découvrent encore plus « autres » par rapport à ce dont ils ont été exclus, et poussent pour que leur monde transforme le reste en ruine. En réalité, on donne au barbare, tout comme à l’étranger, des possibilités de transgression dont le natif peut jouir plus difficilement ; mais en même temps s’expérimentent sur lui – qui ne sait pas parler – les formes de surveillance et de marginalisation de l’ordre civil. Des lois punitives, des stratégies d’inclusion, des bombardements médiatiques[5]. Mais jusqu’à quel point fonctionnent-ils effectivement ? Et dans quelle mesure, au contraire, deviennent-ils autant d’effets boomerang pour renforcer la résistance ? Combien, en réalité, les discours des pouvoirs établis peuvent-ils ébranler le désordre harmonieux des divers Telegram, Instagram et WhatsApp qui prolifèrent dans les réseaux et dans les espaces urbains ?
Si nous nous référons à l’Empire romain, et plus encore, si nous analysons l’archéologie de la barbarie dans le parcours de l’histoire des civilisations, nous ne pouvons nous empêcher de relever que le barbare est l’élément régénérant de toute civilisation en crise : il constitue le dispositif symbolique qui refonde tout en détruisant. Toute tentative de l’attaquer finit ainsi par se retourner contre elle-même, rappelant constamment à la civilisation son impuissance et la fascination secrète qu’elle ressent pour l’altérité qui la traverse, et dont, au fond, elle a besoin. Il y a eu quelque chose de barbare dans la réforme protestante par rapport au catholicisme, dans l’Illuminisme et dans la bourgeoisie par rapport à l’aristocratie, dans l’émigration européenne en territoire américain. Et aujourd’hui dans le cybernaute face aux audiences télévisuelles.
Le barbare mène à la dissolution des codes et des habitudes en cours de désagrégation et apporte en même temps des substances et des formes nouvelles. Celles-ci apparaissent dans un premier temps – et elles le sont – comme violentes, de mauvais goût, infondées, kitsch, embarrassantes, mais se traduisent ensuite en normes, habitudes, coutumes, règles. Telle a été la spirale de chaque processus de civilisation. Il en a été ainsi pour la spirale télévisuelle. Et maintenant nous assistons à un passage qui ajoute à cette dynamique habituelle une qualité et une quantité différentes, inédites. L’anomie, la diversité ou l’insubordination ne sont plus des phénomènes engendrés par les déchets de la structure sociale, mais deviennent des facteurs culturels en eux, des éléments partagés d’où se lèvent, s’élaborent et se joignent de manière horizontale autant d’imaginaires, de mondes de vie et de sens, de formes de vie tendanciellement autonomes et auto-organisées qui ne sont plus caractérisées par le sens de culpabilité ou intimidées par rapport au Léviathan.
Le point crucial réside précisément dans la capacité des nouvelles formes interactionnelles et sociétales à traverser les matrices culturelles qui les précèdent et qui leurs sont extérieures, en évitant d’entretenir avec elles un rapport dialectique[6], tendu vers la synthèse ou le compromis. Un tel fourmillement désordonné est au contraire orienté, de manière spontanée et non réfléchie, vers l’élaboration (qui est en même temps contemplation) de sensibilités purement transpolitiques, capables de traduire la plénitude du quotidien, avec toute l’ombre qu’il porte en lui, dans un imaginaire dense d’efficacité matérielle (non plus simple rêverie mais expérience vécue). Il s’avère ainsi nécessaire de revenir et de se concentrer sur la figure de l’« étranger », si chère à G. Simmel[7] et à W. Benjamin[8], qui, non fortuitement, ont été les théoriciens et les analystes d’un autre tabou des savoirs institutionnels et des paradigmes de l’éducation civique : la mode. Cherchons à le faire avant de stigmatiser trop superficiellement les dernières incarnations de l’étranger qui est en nous – bien au-delà de la grande découverte de l’expérience métropolitaine de l’autre – et donc d’une barbarie qui nous appartient, qui est l’un de nos mondes vitaux, et que nous réprimons au nom de pouvoirs extérieurs à notre personne.
Ce n’est qu’à partir de cette considération qu’il est raisonnable de souligner que la condition contemporaine est au seuil d’un désordre dangereux, que le monde de l’expérience vécue est riche et profond, mais qu’il représente aussi un amas de risques où prolifèrent des actions, passions et formes expressives qui sont non-rationnelles, c’est-à-dire appartenant à un autre régime de sens sans pour autant se situer aux limites de ce dernier. Ce n’est qu’en comprenant la nature si complexe et multiple de la subjectivité d’aujourd’hui que nous pouvons saisir pleinement la valeur de ses extensions technologiques d’abord, et son action sur le monde ensuite.
Partant de ce niveau d’analyse, il est incontestable que les cultures en gestation, dans leur mobilité frénétique, imprévisible et surtout incessante, signalent, à travers leurs connexions et leurs liens charnels, une telle déconnexion vis-à-vis du corps du Léviathan, évoquant alors l’image de l’exode, ou de la diaspora ancestrale. Plus les nébuleuses affectives ou les réseaux sociétaux s’intensifient, au-delà du sens du lieu et des identités cristallisées, plus la rupture du pacte de représentation et, plus généralement, la dissolution du contrat social, s’amplifient. Le fourmillement de la vie ordinaire dévoile ainsi toujours plus le décalage entre les sensibilités appartenant aux subjectivités sociétales et les systèmes de savoir-pouvoir qui tentent de les gouverner. George Orwell confie qu’il fut :
frappé par le fait que ce qui caractérisait vraiment la vie moderne n’était pas tant sa cruauté, ni le sentiment d’insécurité générale que l’on percevait, mais plutôt ce vide, cette apathie incolore. Si l’on regardait autour, on se rendait compte que la vie n’avait rien en commun, ni avec ce torrent de mensonges qui coulait des écrans de télévision, ni avec le programme idéal du Parti. […] L’idéal diffusé par le Parti était quelque chose d’immense, de terrible, d’éclatant : un monde d’acier et de béton armé, de machines monstrueuses et d’armes terrifiantes, un peuple de guerriers fanatiques qui marchaient en parfaite harmonie d’intentions, tous pensaient de la même manière et tous hurlaient les mêmes slogans, occupés, de l’aube au coucher du soleil, à travailler, lutter, triompher, réprimer...[9]
De l’art au politique
En 1936, dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique[10], Benjamin a expliqué de manière éclairante la façon dont l’œuvre d’art perd son aura – sa sacralité – dès lors qu’elle peut être reproduite indéfiniment par les nouveaux dispositifs technologiques et, donc, dès que change l’acte de sa contemplation : alors qu’on était auparavant contraint de passer – comme dans un pèlerinage – par le long rituel du musée, grâce à la reproductibilité technique l’œuvre d’art peut être observée, en quelque sorte manipulée, directement dans son contexte de réception. Il s’agit du passage de la dimension publique, esthétique et au fond pédagogique de la jouissance artistique à la dimension personnelle, quotidienne et tendanciellement dépourvue de fortes connotations de vulgarisation de la consommation, ainsi que du glissement d’une configuration territoriale du rapport entre sujet et objet à une autre condition, privilégiant, entre autre, l’esthétique relationnelle[11] et la réversibilité entre art et public. Est-il possible de se servir de cette intuition pour déplacer le discours sur un autre objet d’attention : le politique ? Qu’arrive-t-il au politique à l’époque de sa reproductibilité numérique ?
La plupart des raisonnements actuels qui accompagnent les processus sociotechniques que nous décrivons tentent de les concevoir comme un ensemble de modalités d’expression et de communication nouvelles vis-à-vis de la vieille politique, et tentent par là de les maintenir liés à elle ; comme s’il n’y avait pas d’autres issues, comme si les nouveaux médias n’étaient rien d’autre que de nouveaux moyens pour embellir et réhabiliter le vieux souverain. Une telle posture intellectuelle caractérise également ceux qui, libres de préjugés et de convictions techno-sceptiques, réussissent à saisir une partie du tournant paradigmatique que les langages numériques impriment aux statuts de la démocratie. C’est le cas, par exemple, de Grossman et de Rodotà. Les deux spécialistes du politique, dans l’élaboration des formules de la « république électronique »[12] et de la « techno-politique »[13], préfigurent un cadre politico-institutionnel capable de se rénover grâce à l’utilisation des nouveaux médias et à la valorisation de leur potentiel démocratique intrinsèque. Ils permettraient à l’opinion publique de contribuer de façon qualitativement et quantitativement majeure à la gestion de la république, de stimuler le dialogue et l’interaction entre représentés et représentants et entreprendre des processus de contrôle plus intenses de la part des premiers sur les seconds. Ces perspectives, sans doute intéressantes et non dépourvues d’éléments innovants, restent tout de même fondées sur la dimension systémique et politique existante, ne permettant pas de voir au-delà du politique et du Léviathan[14]. Fondamentalement, les discours sur la démocratie électronique ne prennent pas suffisamment en compte le fait que la mutation anthropologique et culturelle liée au développement des langages et des territoires numériques mène à la transfiguration de la politique et du politique dans son acception moderne[15], et non à leur simple renouvellement.
La politique a été la forme dans laquelle a été contenue et soutenue la modernité occidentale – sa limite et sa stratégie de pouvoir, notre monde de vie et de sens, notre maison – mais dans la poursuite des discours et des études, nombreux sont ceux qui ont oublié ou ont omis, afin de maintenir leurs privilèges et perpétuer la conservation du statu quo, que précisément, en raison même du fait qu’il s’agit d’une forme possible, nullement ontologique, celle-ci peut être dépassée (d’autant plus si l’on considère que, comme nous l’a enseigné le formisme simmelien[16], les formes sont les dispositifs culturels qui correspondent à nos micro-comportements et aux rapports de réciprocité que tissent les individus). Le politique, en effet, n’est qu’une forme transitoire à travers laquelle s’exprime une certaine sensibilité, se cristallisent les paradigmes relationnels et les rapports de pouvoir d’une époque, se façonne une architecture dans laquelle nous sommes provisoirement contenus – un cadre valide tant que ses frontières expressives sont en mesure de contenir les sujets et les subjectivités qui l’habitent, la reproduisent et se reconnaissent en elle, un miroir légitime tant que ses frontières expressives peuvent accueillir dans sa narration et dans son langage les fragments qui le composent.
Nous sommes par ailleurs au cœur de la crise du politique, dès lors que le schisme entre le corps politique et le corps social, sujet cher à Hannah Arendt[17], se ressent de manière plus sensible (abstention électorale, défiance vis-à-vis du pouvoir, montée sur la scène de populismes de diverses gradations comme Boris Johnson, Donald Trump, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro…) ; dès lors que les langages, les actions, les manières d’être de la société qui pense et gouverne et de celle qui vit ingouvernée sont toujours plus éloignés et asynchrones, dans un contexte où les conflits et les oppositions entre les institutions et les sujets sont de plus en plus mis en lumière.
La blessure est ouverte, les lacérations difficilement cicatrisables avec de timides ajustements d’inspiration réformiste. Il ne s’agit pas d’une déchirure de la dernière heure, mais bien d’un malaise qui s’est progressivement avivé, trouvant dans les écrans des médias de masse une puissante caisse de résonance et un facteur de prolifération. Déjà en 1977, R. Schwartzenberg écrivait :
Quand tout se dégrade et se pervertit, quand tout s’avilit et se corrompt, la vertu décisive, c’est parfois de dire non. C’est ce que le public commence à faire. En France et ailleurs. Écoutez la rumeur profonde, la rumeur souterraine qui s’enfle et le soulève. Écoutez l’indignation qui oppresse ces spectateurs malgré eux. Floués, joués, leurrés. Écoutez le réveil et le sursaut de ceux qu’abuse, de ceux que dupe l’État spectacle. Écoutez leur cri. Il tient en un mot : assez[18] !
Dans ce champ entre en jeu la technique, et plus particulièrement les technologies de la communication, non tant pour exhumer et réhabiliter le corps politique, mais plutôt pour rétablir un nouvel équilibre à partir des ruines du moderne : ces technologies de l’imaginaire[19] rendent concrète la force invisible de ce que Simmel appelle le « roi clandestin »[20] d’une époque, son imaginaire collectif puissant et toujours fondateur. Nous pouvons, en effet, interpréter l’intervention de la technique comme le fruit d’une négociation sociale continue[21], comme la manifestation tangible d’une sensibilité qui provient du territoire immatériel, de l’être le plus profond d’une société. Les médias ne naissent jamais de l’extérieur d’un corps social mais toujours de son intérieur, de son cœur. Ce sont les moyens à travers lesquels nous donnons une forme à notre être-là et ils sont toujours plus le monde que nous habitons.
« Le monde invisible n’est plus une réalité, et le monde invisible n’est plus un rêve »
S’il est vrai que nous sommes de plus en plus producteurs du système communicationnel, force est de constater qu’en même temps les dispositifs de communication à leur tour nous transforment et nous reproduisent, que nous sommes à leur disposition[22] ; plus encore, ils recèlent la forme paradigmatique dans laquelle est cristallisé l’esprit du temps et l’imaginaire collectif – d’hier et d’aujourd’hui. Voici l’espace où habitent les simulacres et les fantasmes fondateurs de toute société, la peau de notre culture[23].
La caractéristique particulière de la modernité tardive – et à son plus haut degré d’affinement culturel, une des articulations qui préfigurent le contexte contemporain – est le lien étroit qui s’est instauré entre la communication-monde[24], le langage, le territoire et les formes de l’habiter. Le réseau et les mondes numériques, à bien y voir, opèrent une synthèse dans laquelle le langage, le territoire et les sujets sociaux se fondent et se confondent dans la même plateforme de communication, dans la même chair électronique. Ceci, au-delà et en deçà de sa matérialité, étant donné que les nouveaux médias électroniques soutiennent une double métamorphose de l’utilisateur : d’un côté, ils habillent et reconfigurent son corps, de l’autre, ils le projettent hors de lui. En cela, l’identité, la réalité et tout autre élément dont on célèbre l’augmentation sont augmentés justement dans la mesure où, en eux, le sujet se perd dans l’autre et renonce à soi, à son autonomie. Il se retrouve ainsi entrelacé dans une espèce de dance macabre et érotique avec tout ce qui constitue son altérité : les objets, la nature, le divin…
Nous sommes face aux conséquences du passage de la lourdeur et de l’extranéité par rapport à l’humain, de l’éloignement physique de l’industrie culturelle à l’absorption dans notre peau personnelle, collective et connective des nouvelles technologies culturelles qui redéfinissent notre être-là et nos formes de relation en calibrant l’attention sur la figure emblématique de la personne numérique et non de l’individu-masse, d’une subjectivité sociétale caractérisée par la pulsion à refonder ses tactiques de survie et ses pratiques culturelles en fonction de la dimension du vécu[25], du ludique et de l’imaginaire, et non plus en fonction du travail, du progrès et de la raison abstraite. À bien des égards, il ne s’agit plus simplement d’être-là, mais d’être-là-avec. Les pratiques et les idéologies verticales de la politique, toujours fondées sur ce que Weber appelle la logique du « devoir être »[26], sur la tentative d’inscrire les masses dans un projet à long terme – fondé sur le sacrifice de l’ici et maintenant et sur la projection vers un futur idéal choisi comme juste fin au-delà des désirs immanents au vécu collectif – sont alors mises en crise, in nuce, par des formes de socialité centrées sur la logique du carpe diem, sur le présentéisme le plus aigu, sur l’hédonisme, sur l’attention exacerbée au corps, aux plaisirs même les plus éphémères et fugaces, à la consommation dans le sens originaire du terme : gaspillage[27], don de rien[28], dépense improductive[29]. Dans cette consumation, bien entendu, l’ombre, le malaise et la mort – en accord avec le culte dionysiaque[30] – jouent un rôle primordial.
Peut-être l’heure est-elle venue de traduire en termes politiques, ou plutôt transpolitiques, les théories souvent trop abstraites sur le postmoderne. C’est un passage audacieux, peut-être risqué, mais indispensable pour saisir la nature des formes vers lesquelles nous sommes en train de transmuter. En réalité, c’est changement anthropologique qui accompagne et qui est soutenu par les bouleversements technologiques liés aux réseaux et au numérique. Il est nécessaire de bien comprendre la mesure dans laquelle chaque forme de pouvoir donnée est intimement liée au médium qui constitue le cœur du système médiatique et de l’industrie culturelle. Nous devons ainsi pousser jusqu’à ses conséquences extrêmes la formule de McLuhan « le médium est le message », mais sans jamais oublier qu’au fond, nous sommes le message.
Il est utile de rappeler, en outre, la nature jamais neutre de chaque langage, qui nous exprime avant même de nous donner la parole[31]. Le langage est le pouvoir : il est le dispositif qui permet depuis toujours de combler le vide entre le sujet et l’objet, entre la culture et la nature : il constitue la matrice dans laquelle nous sommes inscrits, une matrice qui oriente, façonne et ordonne nos modèles relationnels, notre action sur le monde[32]. Tout système linguistique porte en lui une matrice relationnelle et de pouvoir, chacun de ces mondes est construit (de) et reconstruit (par) l’humanité qui s’en sert, qui l’habite. Mais encore faut-il saisir à quel point la langue que nous parlons nous parle en retour – à quel point elle nous façonne. Comme nous l’a suggéré Heidegger, le langage « cesse d’être une chose avec laquelle nous, hommes parlants, avons un rapport », devenant au contraire « le rapport de tous les rapports »[33]. Que se passe-t-il dès lors au moment où le territoire et le langage social se déplacent de la télévision au réseau ?
Pour analyser en profondeur les modalités vers lesquelles la transfiguration du politique[34] est en train de se diriger, il est indispensable de saisir les signifiants et les signifiés qui sont derrière – souvent cachés dans les simulacres, dans les fantasmes ou dans le banal – ce changement de scène au cœur du système de communication. La traduction de notre peau culturelle dans les mondes électroniques témoigne bien d’un passage culturel lourd de conséquences, jusqu’à nous suggérer que les réseaux et les langages numériques sont les formes au moyen desquelles le passage postmoderne est en train de devenir concret[35] ; plus que tous les autres, ce sont ces dispositifs qui menacent l’ordre, le paradigme et les codes culturels de la modernité.
La dématérialisation du monde réalisée par les média – de la photographie à la réalité virtuelle en passant par la communication sans fil – accomplit non seulement « l’affaiblissement de la réalité qui caractérise la société de la modernité tardive »[36], mais réalise une re-conjonction fondatrice entre le visible et l’invisible. Il s’agit de l’une des marques distinctives de la condition contemporaine[37], dont la meilleure description réside dans la citation poétique de W. B. Yeats : « Le monde visible n’est plus une réalité, et le monde invisible n’est plus un rêve ». Un syncrétisme qui affaiblit toujours davantage les gardiens de l’ordre constitué, au profit des cultures du spectacle et de la recréation-récréation[38], désormais prêtes à envahir l’écran[39], à être-l’écran. Nous ne pouvons par ailleurs oublier que même la technique est fable, récit, langage. En tant que telle elle ne peut donc constituer l’élément générateur d’une nouvelle réalité forte, cependant elle est en mesure de poser les bases pour une condition qui, en intégrant l’instabilité de l’être ou en laissant perdre l’être comme fondement[40], nous invite à une expérience de la réalité en tant que fable, qui implique une vision inexplorée depuis longtemps en Occident, mais fort ancienne, du concept de liberté.
À travers les réseaux dont il est question – à partir de MySpace en arrivant à Minecraft, Snapchat et Instagram et en passant par Second Life et Orkut – nous dépassons le modèle communicationnel moderne, bien incarné par le medium télévisuel, fondé sur une communication généraliste, unidirectionnelle, verticale et tendanciellement passive, pour passer à un autre modèle qui privilégie les dimensions personnelles ou micro-communautaires, tendanciellement horizontales et actives de l’interaction, ou bien « inter-passives »[41]. Il serait naïf d’examiner la portée du changement du paradigme communicationnel sans mettre en évidence les conséquences qu’il implique du point de vue anthropologique et donc sans intercepter les contenus des nouvelles subjectivités émergentes au cœur des mutations technologiques contemporaines. Nous devons alors nous demander ce qu’il peut arriver aux formes de pouvoir dès lors que l’on glisse vers un système axé sur ce genre d’architecture psychoculturelle. Si nous renonçons aux présomptions des certitudes, nous sommes appelés à nous interroger sur la mesure dans laquelle la nouvelle dimension anthropologique correspond et est conciliable avec les fondements de la modernité : l’État-nation, l’individu, l’institution et la pratique de la représentation, les identités collectives ; bref, tout l’univers du politique et la démocratie même. Les vibrations frénétiques et convulses rythmant notre temps tendent en effet à dépasser et à transgresser sans cesse ces frontières, à les révéler comme artificielles et obsolètes.
L’action des formes techno-culturelles numériques trace une architecture socio-politique avec une certaine transparence[42][, dans laquelle ce ne sont pas seulement et pas tant la communauté et les décideurs qui sont réciproquement visibles et nus les uns et les autres, difficilement occultables par des filtres et des barrières physiques, fondus dans les flux immatériels de la communication ; la phénoménologie de la société transparente[43], de manière encore plus radicale, permet de faire découvrir à tout un chacun sa nature irréductiblement transpolitique, car ici, plus que jamais, l’être-là a tout de suite à voir avec la vie en commun, et a par conséquent une valeur publique et des conséquences publiques bien plus importantes qu’auparavant. Il y a là une sensibilité qui jaillit, paradoxalement, de terrains apparemment apolitiques, comme par exemple ceux de la consommation improductive et du ludique stimulés par les jeux vidéo qui entraînent le spectateur, comme dans le cas des jeux SimCity ou Minecraft, à se transformer en acteur, en l’amusant et en l’habituant à donner une forme à ce qui l’entoure. Les anthropologues, les philosophes et les sociologues savent bien, d’ailleurs, à quel point le jeu constitue le laboratoire primordial pour l’entrainement dans l’art d’être au monde, d’être avec l’autre, de vivre ensemble[44].
Le jeu vidéo peut être justement interprété comme le prodrome, l’épiphénomène et au fond la figure emblématique de la communication contemporaine[45], qui façonne le glissement transpolitique de la société du spectacle sur la trace, justement, de la synergie entre le « faire ludique » et le « faire le monde », entre la sensibilité évasive et la pulsion recréatrice du corps social. Cette forme culturelle semble intégrer dans sa propre grammaire deux énoncés nietzschéens fondamentaux : « L’homme s’est trop peu égayé : tel est, frères, notre péché originel ! » ; « Vous devez penser jusqu’au bout à vos sens ! […] Et ce que vous appelez monde doit être créé par vous : votre raison, votre image, votre volonté, votre amour doit devenir monde ! »[46]. Tel est l’esprit qui anime et informe les communicraties naissantes et leur imaginaire fondateur : ce sont l’ironie dissipative, le divertissement infini, la densité symbolique des fantasmagories qui préfigurent les traits structurants de la culture à venir.
Verwindung, effets pervers et médias : le devenir œuvre du public
Inspirés par la métaphore de l’aura employée jadis par Walter Benjamin[47], nous pouvons suggérer que les réseaux numériques, ainsi que tous les mondes du jeu caractérisant la socialité contemporaine, mènent à l’accomplissement du processus fatal de séparation de l’aura du corps du leader politique au corps sociétal, du pouvoir institué à la puissance instituante[48], en concrétisant sensiblement le processus d’accession du public, jusqu’alors tenu à l’écart, au premier plan de la vie collective. Devenir art du public.
Dans ce cas aussi, l’histoire sociale des médias[49] nous permet de saisir de manière évidente les prodromes des tendances que la socialité électronique confirme désormais dans leur plénitude. Seuls ceux qui n’ont pas étudié les médias – understanding media, selon le souhait de McLuhan[50] – ceux qui n’ont pas compris que ces plateformes expressives sont la scène à travers laquelle l’arrière-scène du vécu quotidien renouvelle son être-là, ont du mal à réaliser aujourd’hui à quel point la société en réseau[51] pourrait être un élément de désagrégation des politiques et des cultures modernes, et non un élément fonctionnel et régénérateur de celles-ci. Les médias, depuis les représentations du peuple dans la peinture de la Renaissance jusqu’à l’exhibition nue et crue des bonnes choses de mauvais goût dans les reality shows contemporains, pour arriver à Periscope, Vine ou Chatroulette, ont consenti au public, ou mieux ont été utilisés et adaptés par lui pour entrer dans l’écran central de la culture.
À la lumière des innovations encore potentielles, mais également dans certains de leurs aspects déjà évidents, apportés par les cultures numériques, le moment est venu de redécouvrir dans un sens affirmatif ce que les célèbres recherches d’Adorno, Horkheimer[52], Debord[53] et Baudrillard[54] ont souligné de manière critique, négative et essentiellement « apocalyptique »[55] (selon la définition d’Eco). Nous devons pour ce faire détourner leur pensée précisément comme nous l’ont enseigné les situationnistes[56], à savoir, se servir de leurs intuitions pour les pousser contre l’esprit même qui les a causées, pour en dévoiler sa nature idéologique. C’est d’ailleurs l’esprit qui a mu les masses à partir de leur avènement dans le cadre des métropoles modernes au XVIIIe siècle : trouver la manière de tirer du plaisir, de la liberté et du bien-être là où il n’y en avait pas, au milieu d’une condition aliénée et rythmé sur le travail et sur la reproduction sociale.
Ce que la plupart des élites culturelles et intellectuelles n’a pas compris (ou n’a pas encore daigné comprendre ?), c’est la trajectoire qu’a accomplie l’aura à partir du moment où, à travers le processus de reproductibilité technique, elle s’est détachée de l’œuvre d’art[57]. De nombreux théoriciens ont cru qu’une opération de ce genre déclencherait irréversiblement une dynamique de progrès liée non plus tant à la force et à la puissance du mythe qu’à celle de la raison universelle (d’une certaine manière, donc, la technique produite par la raison aurait permis de se libérer du poids symbolique et affectif de l’imaginaire, du mythe et du sacré). Cette même illusion a paradoxalement produit ce qu’Adorno et Horkheimer ont parfaitement décrit : la tentative de supprimer le mythe et le sacré a directement causé un processus tout aussi dangereux de mythification et de sacralisation de la raison comme instrument idéologique de conservation de la société bourgeoise basée sur le rythme productif[58].
Cependant, tandis que ces élites élaboraient leurs propres théories, organisaient le social et déployaient leurs stratégies de domination selon le manifeste culturel basé sur le progrès, la raison, le travail et le livre, entre-temps les masses, en réinvestissant le ludique, l’onirique et l’imaginaire, en fréquentant les territoires plaisants et charnels des écrans audiovisuels, en consommant et en revêtant des signes-marchandises[59], en se reflétant dans les fantasmagories de l’industrie culturelle, ont élaboré des tactiques et donné forme à des mondes idiosyncratiques par rapport aux langages, aux corps, aux savoirs et aux frontières du moderne. La culture contemporaine naît du schisme entre la société qui pense et celle qui vit, elle jaillit du court-circuit entre le global et le local, entre les langages alphabétiques et ceux du corps, entre la nature abstraite des lois et celle concrète et sensible des plaisirs, entre l’État et la personne, entre la production et la consommation, entre les avant-gardes et les masses. La postmodernité ne représente pas, en effet, l’énième manifestation d’un développement linéaire, ni un novum comme valeur ultime, elle n’est pas le dépassement critique de la modernité mais son franchissement, sa distorsion, ou plutôt le résultat de la Verwindung heideggérienne[60].
Le processus de reproductibilité technique n’a en réalité pas fait disparaître l’aura, il ne l’a pas dissoute dans la raison abstraite, mais il l’a plutôt disloquée et amenée dans le vécu collectif à travers une dynamique de réappropriation sociale – d’où le réenchantement du monde auquel rend attentif Maffesoli[61]. Il a habillé la masse en accompagnant son devenir art, son devenir œuvre d’art, œuvre sans œuvre. Les médias et les marchandises sont ainsi devenus les soubassements des systèmes totémiques, ceux d’un habitus à travers lequel on revêt le corps social, on le cimente par rapport à un patrimoine affectif, émotif et symbolique partagé, au-delà des impératifs catégoriques, des stratégies de pouvoir et des abstractions idéologiques. Nous pouvons alors saisir un lien indissoluble et structurant, dans sa nature destructrice et régénératrice, entre la communication et la communion ayant lieu dans ces paysages, ainsi qu’entre la société des consommations et la société de consumation[62].
Ainsi, comme le montre bien le film de Michel Gondry Be Kind Rewind[63], si l’industrie culturelle et le système de consommation sont pensés, mis en œuvre et produits, en amont, pour légitimer et perpétuer de manière subtile, inconsciente, et en cela même profonde et radicale, le statu quo de la société bourgeoise et moderne, en aval ils sont, de manière inattendue, vécus, manipulés et consumés de manière à corroder et à mettre irréversiblement en crise le statut et le paradigme même qui les a produit : c’est la révolte de la marchandise contre son partisan imprudent, le cadavre ramené à la vie par le Docteur Frankenstein qui se venge de son créateur cynique et inconscient. Le père de la sociologie de l’imaginaire, Gilbert Durand, se concentrant sur le passage de la galaxie Gutenberg à la civilisation de l’image, fournit une précieuse description du processus que nous essayons ici de mettre en lumière, en se servant de la formule efficace de l’effet pervers :
cet "effet pervers" ne fut jamais prévu ni même envisagé. La recherche issue du positivisme et de son triomphe s’est passionnée pour les moyens techniques (optiques, physico-chimiques, électromagnétiques, etc.) de la production, de la reproduction et de la transmission des images ; mais elle a continué à mépriser et à ignorer le produit de ses découvertes. Il en va souvent ainsi dans nos pédagogies technoscientifiques […]. Il n’en va pas de même pour l’explosion de l’imaginaire. L’image, ayant toujours été dévaluée, n’inquiète pas encore la conscience morale d’un Occident qui se croit vacciné par son iconoclasme endémique. L’énorme production obsessionnelle des images est limitée au domaine du "distraire"[64].
Tout ce qui a été jusqu’ici marginalisé et étiqueté superficiellement comme une simple « distraction » est en train, parfois bruyamment, à d’autres moments de manière souterraine, de se traduire en « distorsion » et en « destruction ». Voilà l’aspect ironique et dionysiaque de la donnée sociétale actuelle. L’imaginaire contemporain, avec toutes ses affinités connectives, peut être ainsi justement interprété comme un effet pervers de l’iconoclasme, de la rationalisation générale de l’existence et du désenchantement du monde mis en œuvre par la modernité. Celui-ci est le point de fracture qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on essaye de préfigurer les formes de la postmodernité et de déchiffrer les résultats de la transfiguration du politique. Encore une fois, on apporte la preuve que, au-delà des rêves de gloire et de domination du positivisme, du scientisme et aujourd’hui du néo-libéralisme, la société reste structurellement un « sujet » imprévisible dont on ne peut programmer a priori les résultats. Il est fallacieux, en paraphrasant Heidegger[65], de continuer à considérer l’être-là comme un « sujet de l’objet » (la science). En ce qui concerne notre discours, le déplacement de l’aura de l’œuvre d’art aux marchandises, au monde des médias et maintenant au public, non seulement nous livre un signe ultérieur de la mort de l’art[66], mais met encore plus en lumière des passages qui en sont l’inévitable corollaire : la décadence de l’intellectuel et du politique, le retour à l’ordre de la socialité immédiate. Devenir œuvre du public.
Bibliographie
ABRUZZESE A., Il crepuscolo dei barbari, Milan, Bevivino, 2002.
ADORNO T. W., HORKHEIMER M., La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1947.
AGAMBEN G., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Turin, Bollati Boringhieri, 1996.
ARENDT A., La crise de la culture, Gallimard, Paris, 2002 (1954).
BARDAINNE C., SUSCA V., Récréations. Galaxies de l’imaginaire postmoderne, Paris, CNRS Éditions, 2009 (2008).
BATAILLE G., La part maudite. Précédé par la notion de dépense, Paris, Éditions de Minuit, 2003 (1949).
BAUDRILLARD J., La société de consommation, Paris, Denoël, 1970.
–, Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1981.
–, Le crime parfait, Galilée, Paris, 1995.
–, À l’ombre des majorites silencieuses ou la fin du social, Paris, Sens & Tonka, 1997 (1977).
BENJAMIN W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Turin, Einaudi, 2000 (1936) [éd. fr., L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000].
BOURRIAUD N., 1998, L’esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel.
BRIGGS A., BURKE P., Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet, Londres, Polity, 2000.
CAILLOIS R., Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1967 (1958).
CASTELLS M., L’Ère de l’information, vol. 1, La Société en réseaux, Paris, Fayard, 1996.
–, La galaxie Internet, Paris, Fayard, 2001
DE CERTEAU M., L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1999 (1980).
DE KERCKHOVE D. The skin of culture, Toronto, Somerville, 1995 [éd. ca., Les nerfs de la culture : être humain à l'heure des machines à penser, Laval, Presses Université Laval, 1998].
DEBORD G., La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 (1967) ;
–, Commentaires sur la société du spectacle, Paris, Éditions Gérard Lebovici, 1988.
DURAND G., L’imaginaire, Paris, PUF, 1994.
DUVIGNAUD J., Le don du rien, Paris, Téraèdre, 2007.
ECO U., Apocalittici e integrati, Milan, Bompiani, 1999 (1964).
FERRARIS M., Mobilisation totale, Paris, PUF, 2016 (2015).
FIDLER R., Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media, Milan, Guerini e associati, 2000 (1997).
FLICHY P., Une histoire de la communication moderne, Paris, La Découverte, 1992.
FORD S., The situationist international, Londres, Black Dog Publishing, 2005.
FOUILLET A., L’empire ludique, Paris, Éditions François Bourin, 2012.
GROSSMAN L. K., La repubblica elettronica, Rome, Editori Riuniti, 1997 (1995).
HEGEL W. F., Esthétique, Paris, Aubier, 1944 (1835).
HEIDEGGER M., Identität und Differenz, Pfullingen, Neske, 1957.
–, In cammino verso il linguaggio, Milan, Mursia, 1973 (1959) [éd. fr., Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1976].
–, Tempo ed essere, Napoli, Guida, 1980 (1962) [éd. fr. Être et Temps, Gallimard, Paris, 1964].
HUIZINGA J., Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1988 (1939).
LEVINAS E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, 2010 (1971).
LÉVY P., Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002.
MACHADO DA SILVA J., Les technologies de l’imaginaire. Médias et culture à l’ère de la communication totale, Paris, La Table Ronde, 2008.
MAFFESOLI M., L’ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l’orgie, Paris, Librairie des Méridiens, 1985
–, La transfiguration du politique. La tribalisation du monde, Paris, Grasset & Fasquelle, coll. Le Livre de poche, 1992.
MARRAMAO G., Dopo il Leviatano. Individuo e comunità, Turin, Bollati Boringhieri, 2000.
MATTELART A., La communication-monde, Paris, La Découverte, 1991.
MCLUHAN M. H., Gli strumenti del comunicare, Milan, Il Saggiatore, 1997 (1964) [éd. fr., Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 2004].
MOSCONI P., dirigé par, Internationale Situationiste, Paris, Fayard, 1997.
NIETZSCHE F., Così parlò Zarathustra, Rome, Newton Compton, 1993 (1883) [éd. fr., Ainsi parlait Zarathustra, Paris, Rivage, 2002].
–, La gaia scienza, Milan, Mondadori, 2000 (1882) [éd. fr., Le gai savoir, Paris, Flammarion, 1998].
ORWELL G., 1984, Paris, Gallimard, 2013 (1949).
OTTO W. F., Dionysos. Le mythe et le culte, Paris, Gallimard, 1969.
RAFELE A., La Métropole. Benjamin et Simmel, Paris, CNRS Éditions, 2010.
RODOTÀ S., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Bari-Rome, Laterza, 1997.
SCHWARTZENBERG R. G., L’État spectacle. Essai sur et contre le Star System en politique, Paris, Flammarion, 1977.
SIMMEL G., Sociologie et épistémologie, Paris, PUF, 1981.
–, Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1990 (1908).
SUSCA V., À l’ombre de Berlusconi. Les médias, l’imaginaire et les catastrophes de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2006.
–, Joie Tragique. Les formes élémentaires de la vie électronique, Paris, CNRS Éditions, 2011.
TACKELS B., L’œuvre d’art à l’époque de W. Benjamin. Histoire d’aura, Paris, L’Harmattan, 1999.
TRICLOT M., Philosophie des jeux vidéo, Paris, Zones, 2011.
TURKLE S., La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milan, Apogeo, 1997 (1995) [éd. or., Life on the Screen : Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster].
VATTIMO G., La società trasparente, Milan, Garzanti, 1989.
–, La fine della modernità, Milan, Garzanti, 1998 (1991).
VIAL S., L’être et l’écran, Paris, PUF, 2013.
WATIER P., Georg Simmel sociologue, Belval, Circé, 2000.
WEBER M., Le savant et le politique, Paris, PUF, 1987 (1919).
ZIZEK S., Enjoyment as a political factor, Londres, Routledge, 2000.
Filmographie
GONDRY M., Soyez sympas, rembobinez [Be Kind Rewind], États-Unis, 2008.
[1] SUSCA V., Joie Tragique. Les formes élémentaires de la vie électronique, Paris, CNRS Éditions, 2011 (2010).
[2] AGAMBEN G., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Turin, Bollati Boringhieri, 1996.
[3] ABRUZZESE A., Il crepuscolo dei barbari, Milan, Bevivino, 2002.
[4] SUSCA V., À l’ombre de Berlusconi. Les médias, l’imaginaire et les catastrophes de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2006.
[5] Nous renvoyons au numéro 1, La Barbarie, de la revue Les Cahiers européens de l’imaginaire, Paris, CNRS Éditions.
[6] BAUDRILLARD J., À l’ombre des majorites silencieuses ou la fin du social, Paris, Sens & Tonka, 1997 (1977).
[7] SIMMEL G., Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1990 (1908).
[8] RAFELE A., La Métropole. Benjamin et Simmel, Paris, CNRS Éditions, 2010.
[9] ORWELL G., 1984, Paris, Gallimard, 2013 (1949), pp. 78-79.
[10] BENJAMIN W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Turin, Einaudi, 2000 (1936) [éd. fr., L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, in, Œuvres, III, Paris, Gallimard, 2000].
[11] BOURRIAUD N., 1998, L’esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel.
[12] GROSSMAN L. K., La repubblica elettronica, Rome, Editori Riuniti, 1997 (1995).
[13] RODOTÀ S., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Bari-Rome, Laterza, 1997.
[14] MARRAMAO G., Dopo il Leviatano. Individuo e comunità, Turin, Bollati Boringhieri, 2000.
[15] MAFFESOLI M., La transfiguration du politique. La tribalisation du monde, Paris, Grasset & Fasquelle, coll. Le Livre de poche, 1992.
[16] SIMMEL G., Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation, Op. Cit.; WATIER P., Georg Simmel sociologue, Belval, Circé, 2000.
[17] ARENDT H., La crise de la culture, Gallimard, Paris, 2002 (1954).
[18] SCHWARTZENBERG R. G., L’État spectacle. Essai sur et contre le Star System en politique, Paris, Flammarion, 1977, p. 318.
[19] MACHADO DA SILVA J., Les technologies de l’imaginaire. Médias et culture à l’ère de la communication totale, Paris, La Table Ronde, 2008.
[20] SIMMEL G., Sociologie et épistémologie, Paris, PUF, 1981.
[21] FLICHY P., Une histoire de la communication moderne, Paris, La Découverte, 1992; FIDLER R., Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media, Milan, Guerini e associati, 2000 (1997).
[22] FERRARIS M., Mobilisation totale, Paris, PUF, 2016 (2015).
[23] DE KERCKHOVE D. The skin of culture, Toronto, Somerville, 1995 [éd. ca., Les nerfs de la culture : être humain à l'heure des machines à penser, Laval, Presses Université Laval, 1998].
[24] MATTELART A., La communication-monde, Paris, La Découverte, 1991.
[25] DE CERTEAU M., L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1999 (1980).
[26] WEBER M., Le savant et le politique, Paris, PUF, 1987 (1919).
[27] BAUDRILLARD J., La société de consommation, Paris, Denoël, 1970.
[28] DUVIGNAUD J., Le don du rien, Paris, Téraèdre, 2007.
[29] BATAILLE G., La part maudite. Précédé par la notion de dépense, Paris, Éditions de Minuit, 2003 (1949).
[30] MAFFESOLI M., L’ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l’orgie, Paris, Librairie des Méridiens, 1985; OTTO W. F., Dionysos. Le mythe et le culte, Paris, Gallimard, 1969.
[31] LEVINAS E., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, 2010 (1971).
[32] HEIDEGGER M., In cammino verso il linguaggio, Milan, Mursia, 1973 (1959) [éd. fr., Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1976].
[33] HEIDEGGER M., Acheminement vers la parole, op. cit., p. 169.
[34] MAFFESOLI M., La transfiguration du politique. La tribalisation du monde, op. cit.
[35] CASTELLS M., La galaxie Internet, Paris, Fayard, 2001; TURKLE S., La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milan, Apogeo, 1997 (1995).
[36] VATTIMO G., La fine della modernità, Milan, Garzanti, 1998 (1991), p. 36.
[37] BAUDRILLARD J., Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1981.
[38] BARDAINNE C., SUSCA V., Récréations. Galaxies de l’imaginaire postmoderne, Paris, CNRS Éditions, 2009 (2008).
[39] VIAL S., L’être et l’écran, Paris, PUF, 2013.
[40] HEIDEGGER M., Tempo ed essere, Napoli, Guida, 1980 (1962) [éd. fr. Être et Temps, Gallimard, Paris, 1964].
[41] ZIZEK S., Enjoyment as a political factor, Londres, Routledge, 2000.
[42] LÉVY P., Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002.
[43] VATTIMO G., La società trasparente, Milan, Garzanti, 1989.
[44] CAILLOIS R., Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1967 (1958); DUVIGNAUD J., Le don du rien, Op. Cit. ; FOUILLET A., L’empire ludique, Paris, Éditions François Bourin, 2012 ; HUIZINGA J., Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1988 (1939); NIETZSCHE F., La gaia scienza, Milan, Mondadori, 2000 (1882).
[45] TRICLOT M., Philosophie des jeux vidéo, Paris, Zones, 2011.
[46] NIETZSCHE F., Così parlò Zarathustra, Rome, Newton Compton, 1993 (1883), pp. 73-75.
[47] BENJAMIN W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit.
[48] MAFFESOLI M., La transfiguration du politique. La tribalisation du monde, op. cit.
[49] BRIGGS A., BURKE P., Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet, Londres, Polity, 2000.
[50] MCLUHAN M. H., Gli strumenti del comunicare, Milan, Il Saggiatore, 1997 (1964).
[51] CASTELLS M., L’Ère de l’information. Vol. 1, La Société en réseaux, Paris, Fayard, 1996.
[52] ADORNO T. W., HORKHEIMER M., La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1947.
[53] DEBORD G., La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 (1967) ; ID., Commentaires sur la société du spectacle, Paris, Éditions Gérard Lebovici, 1988.
[54] BAUDRILLARD J., Simulacres et simulations, Op. Cit. ; ID., Le crime parfait, Galilée, Paris, 1995.
[55] ECO U., Apocalittici e integrati, Milan, Bompiani, 1999 (1964).
[56] FORD S., The situationist international, Londres, Black Dog Publishing, 2005 ; MOSCONI P., dirigé par, Internationale Situationiste, Paris, Fayard, 1997.
[57] BENJAMIN W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, op. cit. ; TACKELS B., L’œuvre d’art à l’époque de W. Benjamin. Histoire d’aura, Paris, L’Harmattan, 1999 ; SUSCA V., Joie Tragique. Les formes élémentaires de la vie électronique, op. cit.
[58] ADORNO T. W., HORKHEIMER M., La dialectique de la raison, op. cit.
[59] BAUDRILLARD J., La société de consommation, op. cit.
[60] HEIDEGGER M., Identität und Differenz, Pfullingen, Neske, 1957 ; VATTIMO G., La fine della modernità, op. cit.
[61] MAFFESOLI M., Le réenchantement du monde, Paris, CNRS Éditions, 2007.
[62] BAUDRILLARD J., La société de consommation, op. cit.
[63] GONDRY M., Soyez sympas, rembobinez [Be Kind Rewind], États-Unis, 2008.
[64] DURAND G., L’imaginaire, Paris, PUF, 1994, pp. 21-22.
[65] HEIDEGGER M., Tempo ed essere, op. cit.
[66] HEGEL W. F., Esthétique, Paris, Aubier, 1944 (1835).