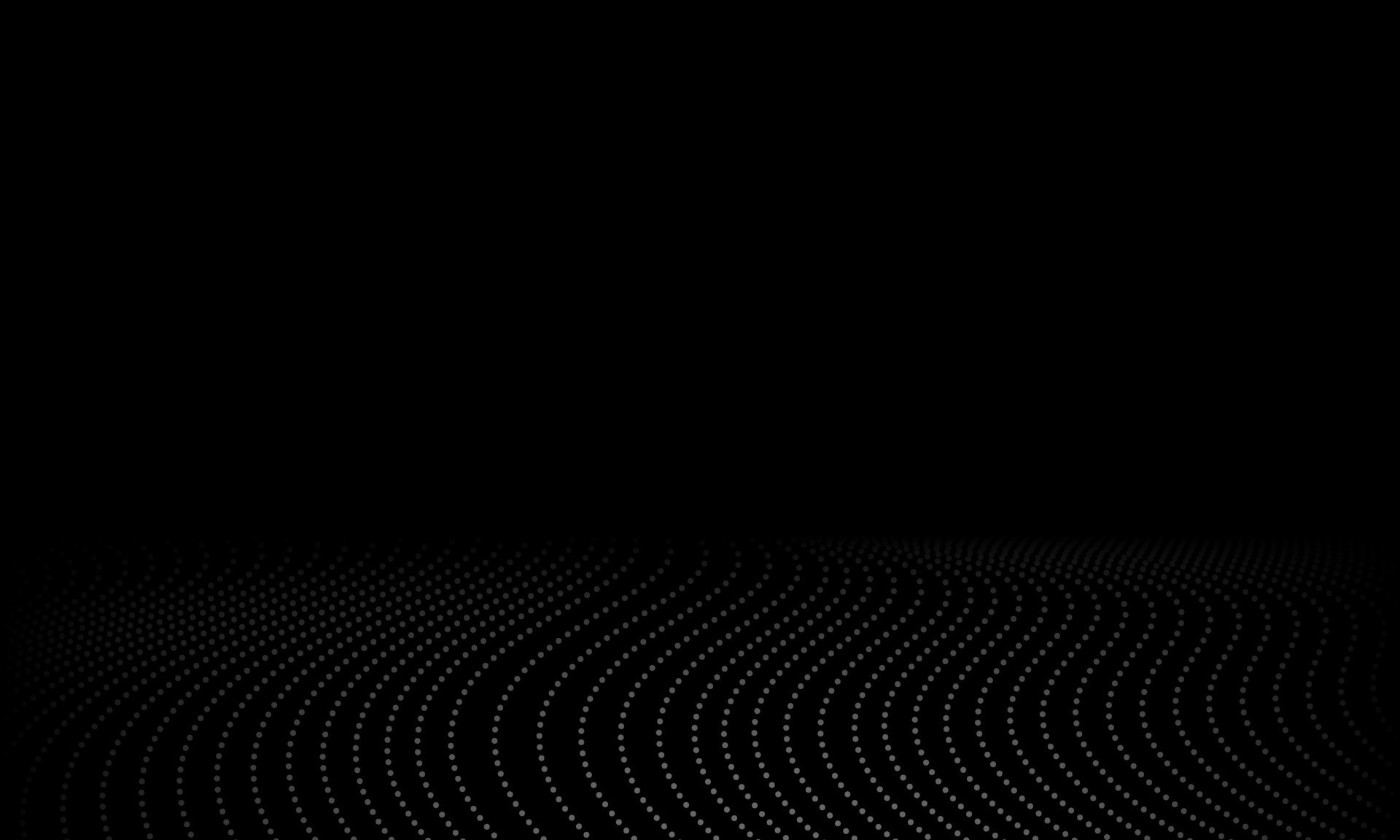Par Bertrand VIDAL, LEIRIS, Université Paul-Valéry – Montpellier 3
S'il voulait effacer des photographies de sa vie, ce n'était pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il l'avait aimée. Il l'avait gommée, elle et son amour pour elle, il avait gratté son image jusqu'à la faire disparaître comme la section de propagande du parti avait fait disparaître Clementis du balcon où Gottwald avait prononcé son discours historique. Mirek récrit l'Histoire exactement comme le parti communiste, comme tous les partis politiques, comme tous les peuples, comme l'homme. On crie qu'on veut façonner un avenir meilleur, mais ce n'est pas vrai. L'avenir n'est qu'un vide indifférent qui n'intéresse personne, mais le passé est plein de vie et son visage irrite, révolte, blesse, au point que nous voulons le détruire ou le repeindre. On ne veut être maître de l'avenir que pour pouvoir changer le passé. On se bat pour avoir accès aux laboratoires où on peut retoucher les photos et récrire les biographies et l'Histoire.
Kundera M., Le Livre du rire et de l’oubli.
Le pétrole et ses dérivés sont omniprésents dans l’ensemble de notre vie quotidienne. Modulable à souhait, relativement bon marché et doté de caractéristiques physico-chimiques hors du commun, rien n’échappe à la pétro-industrie : nos chaudières et réservoirs, mais aussi nos routes (et leur bitume), nos voitures (et leur habitacle), notre frigo (et ses emballages), les jouets de nos enfants (et leur plastique), et notre peau (du nylon, au polyester et au polyuréthanne que nous portons au paraben que nous trouvons dans nos champoings et même nos dentifrices…). Nous vivons dans un environnement presqu’entièrement pétrochimique.
Cependant, la « pétromodernité »[1] vacille aujourd’hui. De moteur du progrès et du confort moderne, le pétrole et ses imaginaires sont actuellement au cœur d’une métamorphose sans égale. En effet, si, jusqu’alors nous étions bercés par rengaines faisant rimer bonheur, confort, avenir et exploitation des énergies fossiles (autrement dit : « Nous » – maîtres et possesseurs de la nature – trouverons le bonheur, le confort et un meilleur avenir dans « l’arraisonnement » de la Nature), cette idée ne semble plus être en phase avec notre époque : « l’Or Noir » est à l’époque actuelle l’une des principales causes de l’effondrement civilisationnel qui s’annonce.
L’Or Noir, la drogue de l’homo petroleum ?
La fable populaire raconte que l’industrie pétrolière débuta le 27 août 1859 près de Titus Ville, en Pennsylvanie. S’inspirant des techniques d’extraction du sel en cours à son époque, un retraité des chemins de fer du Connecticut flanqué d’un pseudo-grade militaire afin d’asseoir son autorité sur les autochtones et leur terre, le « colonel » Edwin Laurentine Drake, à l’aide d’un lourd trépan suspendu au bout d’un câble qui transmettait depuis la surface un mouvement alternatif produit par un balancier, fit jaillir du sol le précieux liquide quelques mois plus tard. Le pétrole était certes connu depuis l’Antiquité, mais c’est le dispositif du « colonel » Drake qui provoqua une ruée qui allait peu à peu changer la face du monde. L’exploitation industrielle à grande échelle de ce que l’on nomma l’« Or noir » pouvait commencer. De très nombreuses villes de l’État connurent une expansion sans précédent. Le pétrole supplanta dès lors l’huile de baleine comme combustible pour l’éclairage public et, si une nouvelle industrie vit le jour, une nouvelle modernité lui emboîta le pas : par exemple, quarante ans après la découverte du « colonel » Drake, en 1900, dans le bassin des Appalaches (où se situe la Pennsylvanie) 183 champs pétroliers avaient pompé un total de 1,33 milliard de barils – Au rythme actuel (à savoir 97,4 mbj), ceux-ci représentent à peine moins de deux semaines de consommation mondiale !
C’est un fait, désormais, le pétrole est devenu un élément au cœur de notre contemporanéité. Il est un produit stratégique dont l’utilisation touche bon nombre de secteurs, de près ou de loin : les transports et le carburant, auquel l’on pense en premier lieu, mais aussi l’habillement, le domaine pharmaceutique, les produits d’hygiène et ménagers, la construction, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’industrie des matières synthétiques... sans parler de la précaire stabilité de l’équilibre économique et géopolitique mondial. Au bout du compte, il est l’assise sur laquelle notre société, qualifiée de société de consommation, s’est épanouie et peut encore se déployer : lorsque son prix fluctue à la hausse comme à la baisse, son impact se fait sentir dans nos portefeuilles, nos déplacements, notre nourriture, notre confort et même… notre sécurité. Bienvenue dans la pétromodernité !
Finalement, n’est-il pas légitime d’envisager que le métarécit occidental n’est que l’histoire d’une grande divagation teintée d’enthousiasme et de d’exaltation dévergondés poussant irrémédiablement à la démesure et cela depuis le XIXe siècle ? Dans cette perspective, n’est-on pas invité à considérer que derrière notre relation au pétrole – des campagnes d’exploration géologique à son imaginaire social en passant par son extraction, son raffinage, sa distribution, ses taxes et enfin sa consommation quotidienne – se cache plus qu’une simple industrie ou un moteur de l’économie occidentale, mais une véritable religion de la modernité ? L’opium du mode de vie moderne, sans aucun doute, substitue dans un grand maelstrom mythico-idéologique la dépendance que nous connaissons vis-à-vis du pétrole aux jouissances superfétatoires du bonheur consumériste et de la profusion matérielle. C’est ce que corrobore le mathématicien et homme politique Yves Cochet en annonçant dans Pétrole apocalypse que « la faiblesse des sociétés industrielles, c’est d’être droguées au pétrole. Ce qui fut appelé développement dans la seconde moitié du XXe siècle se résume à l’accès facile et bon marché au pétrole pour produire du travail mécanique »[2] – complétons en soulignant que, toujours dans cette même période et soutenu par le mythe de la croissance infinie, l’accès au pétrole bon marché demeure également synonyme de lendemains qui chantent. Cette vision optimiste, relayée par les agences prévisionnistes internationales à l’instar de l’IEA (International Energy Agency), est aux fondements mythico-idéologiques de nos sociétés de consommation.
En effet, pendant plus d’un siècle, grâce à l’abondance du pétrole et aux extraordinaires propriétés physico-chimiques de ce combustible, l’imaginaire social a intégré la présence d’énergie abondante et bon marché de nos sociétés[3] et a fait de cette énergie très rentable la cheville ouvrière du mode de vie occidental et la voie privilégiée vers un avenir censé être toujours plus radieux. Autrement dit, les soubassements du modèle occidental se trouvent être étroitement liés à la croyance en l’abondance et en la pérennité des ressources énergétiques fossiles. Au cœur de cette conception se trouve le mythe de la croissance et de la consommation tous azimuts faisant s’accointer bien-être, accès au bonheur et développement économique et industriel, avec pour principal point de suture l’indicateur permettant de mesurer le taux de croissance économique d’un pays, le sacro-saint PIB. Or, cet indicateur, purement idéologique et indexé sur des principes strictement matériels, considère à partir de critères incomplets voire obsolètes le bien-être d’une population essentiellement à l’aune de sa consommation énergétique et, donc dans une large mesure, du prix du pétrole.
Pris dans cet engrenage et convaincu que toujours plus de croissance économique doit forcément préparer à toujours plus de confort, de bonheur matériel ainsi qu’une meilleure espérance de vie pour ses membres, le bon fonctionnement de nos sociétés ainsi que la perpétuation de ses imaginaires et ses matrices socio-culturelles réclament une quantité d’énergie toujours plus grande et, de facto, la dépendance au pétrole ne cesse de s’intensifier jour après jour, tout comme l’arraisonnement de la nature. Ainsi quand le pétrole infiltre l’imaginaire du bien-vivre, l’implacable logique de la dévastation du monde en vient à être étayée par l’apparition d’un nouveau sujet de l’histoire contemporaine n’ayant assimilé de l’incommensurable histoire culturelle des idées en Occident qu’un seul et unique prédicat, la maxime cartésienne – c’est-à-dire se constituer « comme maître et possesseur de la nature » – et n’étant subjugué que par un seul et unique impératif catégorique, l’injonction à la jouissance ici-bas et à la consommation ostentatoire : autrement dit, l’homo petroleum et sa philosophie licencieuse.
Pour cette nouvelle créature – éduquée aux sommations publicitaires de la société de consommation et disciplinée aux comminations de ses pairs – la conquête du bonheur est à portée de main. Elle est, certainement pour la première fois de l’histoire de l’humanité, terrestre et se fait avant tout matériellement… Pour se déplacer un simple véhicule de plus d’une tonne lui suffit pour atteindre (comme le précise une publicité Nissan) « le Nirvana en 5,9 secondes » ; pour « savourer l’instant » (Coca-Cola), il lui suffit d’une bouteille plastique remplie de cola ; en revanche s’il ne peut pas attendre, alors un bouquet de fleurs produites à l’autre bout du monde lui suffira (« le Bonheur immédiat ! » annonce Florajet) ; un shampoing au paraben et c’est « l’extase à l’état pur » (Herbal Essence), alors il ne lui reste plus qu’à « choisir son paradis » (Tahiti Douche) et s’habiller – comble de la pétrophilie – en Diesel « For successful living »… « Le confort a de l’avenir » (surenchérit Daikin) et pour tout le reste – les frustrations et les insatisfactions, authentique colonne vertébrale de la société de consommation –, il y a le système des objets dérivés du pétrole, l’obsolescence programmée et bien-sûr l’achat-plaisir. En d’autres termes, pour l’homme de la pétromodernité, la réussite, le mieux-vivre ou plus généralement l’amélioration des conditions et du niveau de vie s’échafaudent sur l’exploitation sans fin de l’énergie fossile, à savoir sur l’arraisonnement de la nature : le réel ne prend du sens que comme ressource disponible et la nature est comme « sommée » de fournir ce dont le pétro-consommateur a besoin.
En définitive, pour l’homo petroleum l’arraisonnement est associé à l’idée de plaisir et par conséquent devient synonyme de bonheur. Ce discours, qui se base donc sur une logique socio-économique dont les paradigmes fondés au XIXe siècle n’ont pas intégré la possibilité d’une déplétion de la matière fossile, n’est possible que dans un contexte d’abondance énergétique. C’est aussi pourquoi il sera relayé dans nombre de secteurs (de l’éducation des plus jeunes aux discours politiques et même scientifiques, en passant bien entendu par l’industrie culturelle, ses fictions et même ses documentaires) et contaminera l’ensemble de notre imaginaire social, jusque dans les années 1970.
Post-petroleum : sacrifier le mode de vie occidental, le nouveau métarécit
La nature dans laquelle vit l’homo petroleum n’est qu’une réserve dans laquelle il puise pour en dépouiller ce qui lui servira à maintenir son niveau de vie et sa quête du bonheur marchand. Voici le rapport au monde dans lequel la pétromodernité nous plonge : un rapport impérieux où l’environnement naturel est en permanence mis en demeure, c’est-à-dire « sommé » de livrer ses ressources. C’est ici ce que se déroule la mythologie du Progrès, celle du fétichisme du pétrole. Extraire, raffiner, distribuer puis consommer des énergies fossiles non renouvelables ou, autrement dit, vivre-pétrole participe non simplement de la géopolitique moderne, mais par-dessus tout d’un imaginaire culturel : celui de la conquête sans équivoque du bonheur ici-bas… quitte à participer à la dévastation du monde.
Désormais, les circonstances sont en grande partie différentes. À l’évidence, ce fut dans l’après-midi du 28 janvier 1969 que notre imaginaire collectif s’est comme métamorphosé, lorsque commença un véritable cauchemar environnemental sur les côtes de Santa Barbara, en Californie. Suite à l’explosion sur la plate-forme A de l’Union Oil dans le gisement pétrolifère de la mer de Dos Cuadras, plusieurs millions de litres de brut se sont déversés (entre 80 000 et 100 000 barils) dans l’océan puis sur les plages du comté de Santa Barbara. Le déversement (une nappe de 800 km²) a eu un impact significatif sur la vie marine, provoquant la mort de plus de 3500 oiseaux de mer (sachant qu’il s’agit de ceux qui ont été comptés), ainsi que d’animaux marins tels que les dauphins, les éléphants et les lions de mer (leur nombre reste inconnu). L’indignation publique suscitée par ce déversement, ayant fait l’objet d’une couverture médiatique sans précédent, a entraîné de nombreuses lois environnementales au cours de la décennie.
Si, comme l’affirme Darryl Malek-Wiley, porte-parole de Sierra Club (une association de défense de l’environnement fondée en 1892), l’on peut dire que fut créé en réaction à cette catastrophe la plus importante célébration en faveur de la protection environnementale par la société civile – « le Jour de la Terre » –, il est à n’en pas douté à peu près certain que les quatre auteurs du rapport The Limits to Growth (commandé en 1970 par le Club de Rome et publié en 1972), quand ils proposèrent de limiter drastiquement la croissance économique, avaient eux aussi en tête les images des plages de Santa Barbara souillées par la pollution et des plusieurs milliers de ses animaux mazoutés et comme offerts en sacrifice à la gloire du culte de la croissance sans limite et de ce que l’on peut nommer avec l’un des théoricien de la déplétion énergétique, Richard Heinberg, la « bulle industrielle »[4].
La situation ne pouvait honnêtement plus durer. Le mode de vie occidental n’est absolument pas soutenable. Game Over ! Non seulement la survie de l’homme est de la partie, mais, plus que tout autre chose, c’est l’avenir même de la planète qui est mis en jeu. Dans sa conquête impérieuse du confort matériel et de la jouissance consumériste, l’homo petroleum a outrepassé les limites du raisonnable. Nous sommes tous un peu responsables.
Effectivement, en dépit des nombreuses alertes, nous – que l’on soit décideurs politiques, industriels, boursicoteurs ou simples consommateurs – nous entêtons à foncer tête baissée droit dans le mur. Notre enthousiasme excessif vis-à-vis de la conquête du bonheur matériel et de la jouissance immédiate nous a complètement aveuglés aux réalités du monde. Notre époque, que l’on qualifie d’« Anthropocène »[5] – c’est-à-dire la période géologique succédant à l’Holocène et durant laquelle l’influence des activités humaines sur la biosphère a un impact significatif sur l’équilibre de l’écosystème terrestre comparable au « forces géologiques » –, est frappée par la destruction toujours plus accélérée des écosystèmes et est accompagnée d’un épuisement des ressources disponibles. Ces impasses ont été magistralement exposées dans Pétrole : La fête est finie ! de Richard Heinberg. Pour l’auteur, nous n’avons plus le choix, c’est notre avenir qui est en jeu : contrôler la « chute », faute de pouvoir l’éviter !
La civilisation industrielle s’appuie sur la consommation de ressources énergétiques qui sont intrinsèquement limitées en quantité et sur le point de devenir rares. […] Devons-nous continuer à nous complaire jusqu'à la triste fin, et entraîner l'essentiel du reste du monde dans la chute ? Ou alors faut-il reconnaître que la fête est finie ? s’interroge Richard Heinberg […]. Nous en sommes arrivés à dépendre d'un système économique reposant sur la croyance selon laquelle la croissance est normale, nécessaire et qu'elle peut durer indéfiniment.[6]
C’est un fait dont on ne peut plus faire l’économie : la perpétuation de notre mode de vie dépend intégralement de sa croissance perpétuelle. Et aujourd’hui, en tout lieu où l’on pense et où l’on vit, un petit vent de fin du monde se fait ressentir. La culture de la croissance est mise en doute de toute part : effondristes, collapsologues, minimalistes, décroissants, survivalistes, preppers… Pour une frange tous les jours plus grandissante de la population, l’abondance matérielle et le bonheur immédiat ne sont plus les valeurs dominantes, et ne restent que de lointains souvenirs d’une période surtout temporaire et transitoire… une période définitivement révolue. En conséquent, le futur n’est plus que l’ombre de lui-même. Plus aucun espoir de retrouver de la croissance. Plus d’espoir en l’avenir.
Pour revenir aux années 1970, quand le spectre de la déplétion tourmentait nos visions d’avenir et que, par conséquent, comme obsédé, l’on ne pouvait cesser de se demander dans la plus grande solennité « À quoi pourrait bien ressembler un monde sans pétrole ? » ou mieux encore « Quel impact aura la déplétion sur nos modes de vie à l’avenir ? », autrement dit « Comment vivrons-nous dans un univers privé de cette ressource énergétique, pourtant si indispensable aujourd’hui ? », mais que ces questionnements restaient sans réponse, une œuvre punk d’un réalisateur australien surgit et, tout en creusant le sillon de l’imaginaire du post-pétrole, permit de visualiser pour la première fois nos angoisses existentielles. Ce ne fut ni le premier choc pétrolier (1973), ni le second (1979), mais en tout état de cause la sortie en salle du premier épisode de la saga cinématographique Mad Max (George Miller), œuvre porte-étendard des impasses de l’homo petroleum, du sacrifice du mode de vie occidental et surtout annonciatrice d’un nouvel imaginaire : le No-future.
Le No-Future symptôme d’une pétro-mélancolie ?
Avant tout, le futur apocalyptique de Mad Max, c’est l’esthétisation d’un monde réduit au chaos et à la déliquescence. Sorti en 1979, le film traite métaphoriquement des conséquences de la récession économique et, sur le très long terme, de la déplétion énergétique. Le postulat est simple : privé de sa puissance industrielle et économique, l’Occident sombre dans l’anarchie et la barbarie. Le réalisateur décrit un monde où le désengagement de l’État, dans une logique purement libérale, ne permet même plus à celui-ci d’exercer la protection des libertés fondamentales qu’il avait lui-même arbitrairement définies, à savoir le droit à la sécurité et la propriété privée. Livrés à eux-mêmes, dans une société où transparaissent plus que jamais les inégalités, les hommes, consumés par la folie, régressent au rang d’animaux sanguinaires, de charognards sans foi ni loi.
Dans la démence d’un monde où il ne s’agit plus que de survivre et le cynisme d’un univers où plus aucun espoir de renouveau ne s’offre à nous, seules la violence et la fureur existent. Telle est la morale, paradoxalement amorale, de la saga Mad Max : l’arraisonnement du monde n’a pour seul corollaire l’arraisonnement de l’humanité, la dévastation de la civilisation, la fin du Progrès quel qu’il soit, c’est-à-dire la fin de tous lendemains qui chantent. Dit d’une autre manière, les Mad Max et la foule de dystopies post-pétrole qui va les accompagner (en littérature, au cinéma mais aussi dans les comics et les jeux-vidéo) mettent en images le potentiel autodestructeur de l’humanité, ainsi que la nature bestiale de l’homme une fois privé d’une structure sociale et économique stable.
L’avenir certes n’est plus au pétrole, mais comme le dit narrateur du second épisode, Mad Max 2 (George Miller, 1981) : « Sans carburant, l’homme n’était rien. Son empire était de paille. […] Rien ne pouvait endiguer le désastre ». En définitive, quand il n’y a plus de pétrole, il n’y a plus d’avenir, et c’est le retour fracassant de la barbarie, comme le suggère Paul Ariès dans Décroissance ou barbarie[7] : c’est-à-dire que nous avons peut-être encore un avenir mais celui-ci ne peut se décliner que de deux manières, soit sacrifier notre mode de vie débridé (sobriété et décroissance), soit s’engager vers le défoulement de la sauvagerie inhérente à l’homme (effondrement et retour de la barbarie). En ce sens, sur bien des aspects, l’on comprend dès lors que comme l’a démontré le sociologue Norbert Elias, la civilisation et ses multiples avatars (Progrès, pacification des interactions, morale, refoulement des bas-instincts…) n’est pas un acquis de l’histoire de l’Occident, mais un simple et frêle idéal vers lequel l’on tend[8].
L’exploitation du pétrole au milieu du XIXe siècle a créé l’illusion d’un futur qui désormais s’avère insoutenable. Aujourd’hui, sa raréfaction nous laisse coi. Elle tarit, en même temps que tous les biomes, notre imaginaire même. Car, il faut malheureusement se l’avouer, que l’on soit réalisateur, scientifique, industriel ou simple « homme de la rue », il nous est à présent impossible d’imaginer un monde meilleur sans pétrole. Toutes nos prévisions, tous les récits d’avenir qui font nos idéaux-directeurs, tous nos imaginaires du futur divulguent à peu près le même message : sans pétrole, le monde n’est pas meilleur… bien au contraire. Ici réside le vice ultime de la pétro-modernité et de l’homo petroleum, la « pétro-mélancolie »[9] : notre addiction au pétrole n’est pas simplement tangible, elle comporte une grande part d’intangible, de sensible.
Manifestement, c’est ce que nous enseignent toutes les prospectives et fictions post-pétrole, sans cette énergie fossile, l’avenir est au négatif. Nous ne sommes pas capables de penser autrement que pétrole : sa disparition, sa déplétion, est aussi une disparition, une déplétion de nos espérances de survie (notre survie, passe par une réduction de la population mondiale, par le sacrifice de notre confort matériel, de notre mode et de notre niveau de vie, de notre bonheur matériel…). Et, là réside le plus grand problème, l’emprise absolue du pétrole. Notre soumission radicale. Effectivement, si nous savons pertinemment que nous sommes dépendant matériellement du pétrole, nous ne pouvons plus nous voiler la face, nous le sommes aussi intellectuellement. L’obsession-pétrole a comme infiltré l’infrastructure et la superstructure sociale. Si dans un premier temps, nous sommes aujourd’hui incapables de vivre matériellement notre quotidien sans le pétrole et ses dérivés, nous sommes aussi dans un second temps incapables d’imaginer la possibilité d’un avenir sans pétrole. Nous ne sommes plus en capacité de penser sans pétrole : après avoir infiltré le système des objets et la société de consommation, il a poursuivi la guerre en conquérant notre imaginaire de l’avenir. Et aujourd’hui, l’industrie culturelle (film, littérature, bande-dessinée, comics, jeu-vidéo…) – qui a toujours su être le réceptacle et l’amplificateur de nos rêves et espérances d’avenir – engendre, quand elle figure le monde post-pétrole, un large sentiment de fatalité, et de facto, conduit à la démobilisation, à la faillite de l’avenir.
En définitive, comme le souligne Richard Heinberg, si « sur le papier, nos problèmes peuvent être résolus, […] pour l’instant nos sociétés ne sont pas prêtes à une remise en cause en profondeur de leur mode de fonctionnement »[10]. Une crise systémique d’une ampleur inouïe nous attend, car nous sommes dans l’impossibilité de contester vraiment le consumérisme et le culte de la croissance matérielle perpétuelle. C’est pourquoi, il nous faut réinjecter de l’avenir et de l’espérance dans nos mythologies contemporaines, pallier ce qu’il convient de nommer la panne des imaginaires de demain, car, comme le précise le philosophe et historien Michel de Certeau, « les récits "marchent" devant les pratiques sociales pour leur ouvrir le champ »[11]. Ainsi mettre en échec non seulement la pétro-dépendance, mais surtout cette pétro-mélancolie qui noyaute et phagocyte notre imaginaire, reste sans aucun doute notre dernier défi pour un avenir désirable et en commun.
En effet, en s’étant accaparé les attributs du bonheur et les imaginaires de la réussite, le pétrole nous a aussi rendu complètement dépendant. Et il nous est désormais quasiment impossible d’imaginer un avenir désirable privée de cette ressource.
Bibliographie
Ariès P., Décroissance ou Barbarie, Villeurbanne, Golias, 2005.
de Certeau M., L’invention du quotidien, tome I, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.
COCHET Y., Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005.
Crutzen P., Grinevald J., McNeill J. & Steffen W., « The Anthropocene: conceptual and historical perspectives », Philosophical transactions of the royal society, no 349, 2011, pp. 862-867.
ELIAS N., La dynamique de l’Occident, Paris, Pocket, 2003 (1975).
HEINBERG R., Pétrole : La fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, Paris, Éditions Demi-Lune, 2008 (2003).
–, La fin de la croissance. S’adapter à notre nouvelle réalité économique, Paris, Éditions Demi-Lune, 2012 (2011).
LEMENAGER S., Living Oil: Petroleum Culture in the American Century, New York, Oxford University Press, 2013.
WINGERT J.-L., La Vie après le pétrole. De la pénurie aux énergies nouvelles, Paris, Autrement, 2005.
[1] L’expression est de Stéphanie LeMenager. Cf. LEMENAGER S., Living Oil: Petroleum Culture in the American Century, New York, Oxford University Press, 2013.
[2] COCHET Y., Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005, p. 172.
[3] Cf. WINGERT J.-L., La Vie après le pétrole. De la pénurie aux énergies nouvelles, Paris, Autrement, 2005.
[4] HEINBERG R., Pétrole : La fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, Paris, Éditions Demi-Lune, 2008 (2003), p. 66.
[5] Cf. Crutzen P., Grinevald J., McNeill J. & Steffen W., « The Anthropocene: conceptual and historical perspectives », Philosophical transactions of the royal society, no 349, 2011, pp. 862-867.
[6] Cf. HEINBERG R., Pétrole : La fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, op. cit., p. 13 et p. 240.
[7] Cf. Ariès P., Décroissance ou Barbarie, Villeurbanne, Golias, 2005.
[8] Cf. ELIAS N., La dynamique de l’Occident, Paris, Pocket, 2003 (1975).
[9] Cf. LEMENAGER S., Living Oil: Petroleum Culture in the American Century, op. cit.
[10] HEINBERG R., La fin de la croissance. S’adapter à notre nouvelle réalité économique, Paris, Éditions Demi-Lune, 2012 (2011), p. 299.
[11] de Certeau M., L’invention du quotidien, tome I, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 185.