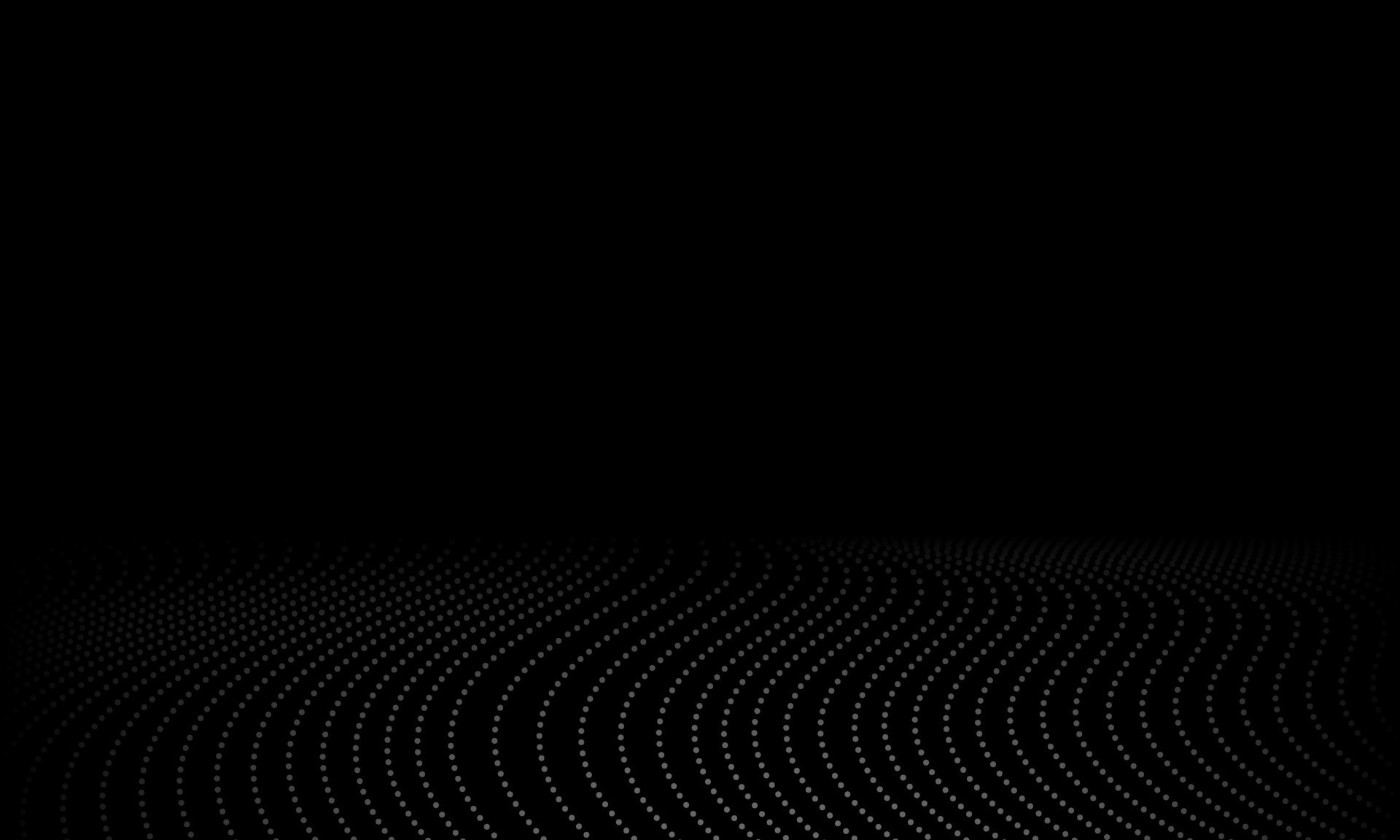Par Larissa Fontes, Docteure en anthropologie, ATER à l’UFR ASSP de l’Université Lumière Lyon 2, attachée à l’UMR 5600 Environnement, Ville et Société - EVS.
Introduction
À la fin de 2010, je travaillais comme photojournaliste dans un journal quand j’ai eu mon premier contact avec le candomblé lors de la production d’un reportage. À cette occasion, grâce au bon échange avec le chef de culte de l’Ilê Axé Legionirê[1], j’ai décidé de prendre le candomblé comme sujet de recherche pour mon mémoire de conclusion du cours de Communication Sociale – Journalisme, soutenu en 2012[2]. Sans savoir encore ce que je prendrais comme sujet spécifique sur cette recherche j’ai passé un an en présence constante dans la maison de culte : j’observais, je participais aux cérémonies, je photographiais, je réalisais des entretiens informels, enfin, je vivais parmi eux, en faisant connaissance de leur monde.
Lorsque je me suis intéressée au rituel d’initiation, dénommé Feitura de Santo[3], une confiance réciproque s’était déjà construite entre les intégrants de cette communauté religieuse et moi. J’ai donc présenté le projet à Pai Manoel, le chef de culte : la proposition consistait à photographier le rituel d’initiation.
La Feitura de Santo est un rituel secret, inaccessible aux non-adeptes et parfois, seulement permis aux individus situés dans des échelles les plus hautes de la hiérarchie religieuse. C’est le rite le plus important de la vie candombleciste et il lui est consacré le plus haut degré de secret. J’avoue qu’il existait une totale exaltation d’une jeune photojournaliste enthousiaste à l’opportunité d’enregistrer le secret. Le scoop et l’inédit m'excitaient.
À ma grande surprise, Pai Manoel m’a tout de suite donné une première autorisation. Une « première » autorisation, a-t-il bien précisé, car elle ne serait confirmée qu’après la consultation des cauris, le jeu oraculaire au travers duquel les divinités se communiquent. C’est par cette voie que les adeptes peuvent avoir un contact direct avec eux. Cauris consultés, j’ai obtenu l’autorisation de la part de l’orixá principal de la maison, Ogum Xoroquê.
J’ai dû attendre encore quelques mois pour que l’entrée d’un nouveau membre en camarinha[4] se réalise. Pendant les 21 jours de la durée du rituel, j’ai accompagné chacune des cérémonies privées et normalement interdites aux non-initiés comme moi. Le résultat de ce travail a suscité des problématiques approfondies dans ma recherche de mestrado, cette fois avec des outils anthropologiques qui étaient absents ou pas très matures lors du premier travail.
L’une de ces problématiques est venue m’interpeller après quelques-unes de mes propres conférences, où j’ai commencé à m’apercevoir que l’autorisation reçue de l’orixá était un élément d’extrême importance pour le débat. Or, j’ai observé que cette autorisation divine fonctionnait comme une légitimation de certaines démarches. Le rituel d’initiation est tellement protégé, que son ouverture à une non-initiée dérangeait quelques membres d’autres maisons. Toutefois, ce dérangement finissait devant l’autorisation de l’orixá. C’est-à-dire que si l’orixá l’avait autorisée, personne ne pouvait oser contester son autorité.
Ainsi, en ayant comme point de départ ma propre expérience de terrain, j’ai enquêté sur les relations entre le secret du rituel et les techniques d’enregistrement ethnographique, en privilégiant les négociations établies entre chercheurs et interlocuteurs dans les recherches. La question déontologique a été également analysée en prenant en compte l’intérêt anthropologique par la documentation de rituels considérés comme secrets.
Les significations de cette autorisation divine constituent la préoccupation centrale de ce texte, dans une réflexion qui s’élargit vers une notion d’agence de non-humains. Est également présent dans ce texte, l’intérêt pour des événements surnaturels (que j’ai préféré désigner de surréels) et la manière de les évoquer dans le texte scientifique. Finalement, mon expérience et mon rôle en tant que chercheuse sont toujours au sein de l’analyse dans la mesure où je cherche à les appréhender à travers la cosmologie et le système de pensée du candomblé.
L’ethnographie face à l’expérience surréelle
Lors de mon passage devant le jury de qualification, étape obligatoire avant la soutenance de mestrado au Brésil, le professeur Renato da Silveira m’a interpellée avec une suggestion qu’il avait apprise de l’anthropologue Marc Augé. Selon ce dernier, le terme surnaturel fut introduit en Afrique par les missionnaires chrétiens, protestants et catholiques. Au Brésil, le terme a été également introduit par la pensée religieuse catholique. Néanmoins, en ce qui concerne le sacré afro-brésilien, africain et païen de manière générale, rien n’existe de surnaturel : le sacré est partout. C’est-à-dire, qu’il n’existe pas la verticalité observée habituellement dans d’autres segments religieux. Dans le contexte des religions traditionnelles africaines et celles qui sont issues de ces origines, cette frontière n’est pas présente, car la manifestation de ce sacré est parfaitement naturelle, dans la mesure où le sacré est la nature elle-même. Augé aurait donc suggéré de remplacer le terme surnaturel par surréel. Je m’accorde avec cette perspective et j’accepte la suggestion pour poursuivre mon analyse.
L’anthropologue brésilien Marcio Goldman[5] a relaté une expérience surréelle vécue lorsqu’il accompagnait un rituel de despacho au bord d’un fleuve, dans son terrain à Ilhéus, ville de l’État de Bahia. Ce rituel consiste, suite au décès d’un initié, à déposer les objets rituels personnels du défunt dans le courant d’un fleuve, mer ou encore dans la forêt. La pratique fait partie des « obligations » cérémoniales funèbres, mais il se peut qu’elle ne soit pas réalisée dans certains cas exceptionnels dont les cauris manifestent le désir de l’orixá de continuer « sur terre », en restant sous les soins des membres de la maison de culte. Goldman relate qu’il s’agissait d’une communauté de candomblé avec laquelle il avait déjà travaillé auparavant, et donc qu’une relation de familiarité entre lui et le groupe était déjà établie. Ainsi, plus qu’un simple observateur, le chercheur occupait un rôle actif dans le rituel, en aidant le groupe à charger et à décharger la voiture, par exemple.
Ensuite, Goldman narre avoir écouté des sons de tambours lointains pendant le rituel, chose qui ne l’a pas intrigué car, même s’ils se trouvaient loin du terreiro, il savait que d’autres maisons de culte pouvaient exister dans les alentours du lieu choisi pour le despacho. De retour au terreiro, en discutant sur le sujet du rituel auquel il venait de participer, Goldman relate une découverte assez particulière : il a appris que les tambours entendus pendant le rituel « n’étaient pas de ce monde »[6].
Par la même occasion, Goldman a vécu encore deux autres expériences « mystiques ». La première se passe lors de ses retrouvailles avec le chef de culte du terreiro en question, après deux ans sans l’avoir vu. Il sentait des vertiges à chaque fois qu’il s’approchait du terreiro. Lorsqu’il s’y éloignait, les vertiges disparaissaient. Cela, selon lui, s’est répété trois fois dans la même soirée. La deuxième expérience est un rêve qui l’a aidé à réaliser une articulation scientifique entre l’épisode des « tambours d’autre monde » et une recherche sur la démocratie qu’il développait en parallèle auprès de cette communauté religieuse. À partir de ces expériences, Goldman propose que nous laissions de côté les enjeux normatifs pour penser à des questions qui sont à son avis cruciales pour l’anthropologie contemporaine.
À cet égard, il est possible de tracer un chemin qui contribue à mon argumentation. Goldman[7] suggère de penser autrement la mise en réseau entre « non-humains » et « humains » par ailleurs analysée par Bruno Latour[8] et propose que dans les études des religions afro-brésiliennes, ces « non-humains » soient remplacés par des animaux, des végétaux, des minéraux et des esprits. Dans cette perspective, nos concepts et pensées doivent se transformer symétriquement, non pas dans une pratique symétrique qui n’annule pas les différences, mais les emphatise. Par contre, il y a une différence : Latour a travaillé avec des scientifiques, des gens qui ont le pouvoir d’imposer leurs points de vue, alors que le même traitement n’est pas donné aux adeptes du candomblé. Son discours, au contraire de celui du scientifique, tend à être considéré comme faux ou tout simplement comme annonciateur d’une vérité qui n’est pas la nôtre. Ce discours est donc porteur d’un potentiel déstabilisateur de nos manières de penser et de définir le réel[9].
Une partie de notre tâche consiste à découvrir la raison pour laquelle ce que font et disent nos interlocuteurs, leur semble, je ne dirais pas évident, mais cohérent, convenable, raisonnable. Mais l’autre partie consiste à s’interroger sans cesse jusqu’où nous sommes capables de suivre ce qu’ils disent et font, jusqu’où nous sommes capables de soutenir la parole native, les pratiques et les savoirs de ceux avec qui nous avons choisi de vivre pendant une période. Et, par conséquent, jusqu’où nous sommes capables d’encourager notre propre transformation à partir de ces expériences[10].
Encore une autre articulation proposée par cet auteur vient aider à la répercussion de mon travail auprès de la communauté religieuse afro-brésilienne à Alagoas. En apportant la notion de « réversion » développée par Roy Wagner[11], Goldman propose qu’au lieu de poursuivre exclusivement l’idée que les « natifs » peuvent faire de l’anthropologie de nous, nous devons nous laisser séduire par l’idée que cette inversion a le pouvoir de nous rendre capables de démonter et remonter les mécanismes essentiels de notre anthropologie à travers ce que les « natifs » disent de nous[12].
Le problème d’une anthropologie qui se refuse à accepter l’universalité de la médiation en réduisant des significations à des croyances et des dogmes est considéré par Wagner comme une réduction qui pourrait nous amener au piège d’avoir besoin de choisir entre croire aux significations natives ou aux nôtres. La première alternative serait considérée superstitieuse et la deuxième serait la science[13].
Or, sous l’optique de la plupart de mes interlocuteurs, le chercheur (comme tout le monde) devrait expérimenter la religion s’il cherche à la comprendre dans sa totalité. Aristote, sur les mystères, a souligné : il s’agit du ressentir. Goldman[14] boit à la même source de réflexion : il ne s’agit pas tout simplement de croyances, mais d’expériences, de concepts et de théories. C’est là que se trouve la particularité de l’anthropologue selon Favret-Saada,[15] la disposition et capacité d’être affecté par d’autres expériences.
En travaillant sur la sorcellerie au Bocage, Favret-Saada explique comment elle a dû reconsidérer la notion d’affect pour appréhender cette modalité « d’être affecté », pour faire « une anthropologie des thérapies », à la fois « sauvages »/exotiques et « scientifiques »/occidentaux. Il s’agit d’une invitation à repenser l’anthropologie, en mettant en question le traitement scientifique de l’affect face au déni d’auteurs qui, en général ignorent leurs places dans l’expérience humaine. Selon elle, la réhabilitation de la sensibilité dans le travail ethnographique est urgente :
Je n'ai pu faire autrement que d'accepter de m'y laisser affecter par la sorcellerie, et j'ai mis en place un dispositif méthodologique tel qu'il me permette d'en élaborer après coup un certain savoir. Je vais montrer en quoi ce n'était ni de l'observation participante, ni surtout de l'empathie[16].
Or, l’auteure souligne un aspect commun de la littérature antérieure concernant son sujet de travail : la disqualification de la parole « native » et la promotion de celle de l’ethnographe. Elle observe donc une « curieuse obsession » présente dans les préfaces : les auteurs souvent niaient la possibilité d’une sorcellerie rurale en Europe. La sorcellerie serait une chose du passé, la société moderne se serait « émancipée » de ce type de croyance. Il s’agissait d’une tentative de perpétuer le Grand Partage entre eux et nous (« nous aussi avons cru aux sorciers, mais c’était il y a trois cents ans, quand nous étions eux »), pour préserver l’ethnologue (« cet être a-culturel dont le cerveau ne contiendrait que des propositions vraies ») de toute contamination par son objet.[17] Ce que l’auteure a découvert c’est que parler de sorcellerie dans son terrain n’était pas seulement une question de savoir, mais de pouvoir : « plus on sait, plus on est menaçant et plus on est menacé magiquement » [18]. Ce qui s’est passé c’est que ses interlocuteurs se sont refusés à jouer le jeu de la Grand Division. Certaines questions posées par l’ethnographe ne trouvaient dès lors plus de réponse et se mettait en place des justifications du type : « ceux qui n’ont pas été pris, ils ne peuvent pas en parler » ou « il faut être prise pour y croire ». C’est ainsi qu’ils ont commencé à lui raconter leurs histoires, lorsqu’ils ont trouvé qu’elle était « prise », c’est-à-dire, quand des réactions échappant à son contrôle leur ont montré qu’elle était affectée par les effets réels de telles paroles et de tels actes rituels[19].
Personne n’a jamais eu l’idée de m’en parler parce que je serais ethnographe. Moi-même, je ne savais pas trop si je l’étais encore. […] En fait, ils exigeaient de moi que j’expérimente pour mon compte personnel – pas celui de la science – les effets réels de ce réseau particulier de communication humaine en quoi consiste la sorcellerie. Autrement dit, ils voulaient que j’accepte d’y entrer comme partenaire, et que j’y engage les enjeux de mon existence d’alors[20].
Dans les rencontres avec les ensorcelés et désorceleurs, elle se laissait affecter, sans chercher vraiment à enquêter, à comprendre ou à retenir. Et elle explique que l’acceptation de « participer » et d’être affecté n’avait rien à voir avec une opération de connaissance par empathie. Par définition, emphatiser suppose la distance : « c’est bien parce qu’on n’est pas à la place de l’autre qu’on tente de se représenter ou d’imaginer ce que ce serait d’y être, quels sentiments, perceptions et pensées on aurait alors »[21]. Or, la chercheuse était à la place de son « natif », bouleversée justement par les sentiments, les perceptions et les pensées de quelqu’un qui occupe une place dans le système sorcellaire.
Dans la perspective proposée par cette auteure, occuper une place dans un système sorcellaire ne me renseigne en rien sur les affects de l’autre. Occuper telle place n’affecte que moi-même. C’est-à-dire, cela mobilise ou modifie mon propre répertoire, sans pour autant m’instruire sur celui de mes partenaires. En revanche, le seul fait d’accepter occuper cette place et d’en être affectée, ouvre une communication spécifique avec les « natifs », une communication involontaire et dépourvue d’intentionnalité, soit-elle verbale ou pas.
Entre des gens affectés par les mêmes phénomènes, suggère l’auteure, il se passe des choses auxquelles il n’est jamais donné à un ethnographe d’assister. On parle de choses dont les ethnographes ne sont pas censés parler, ou bien l’on se tait, mais même garder le silence, il s’agit toujours de communication. C’est alors cela qui permet à nos interlocuteurs de communiquer avec nous et même d’ouvrir des concessions devant des informations considérées comme secrètes. C’est ce qui s’est passé avec moi dans le cadre de ma recherche. Les interlocuteurs se sentent en sécurité dans la mesure où ils commencent à faire confiance aux chercheurs, et à s’ouvrir à la construction de relations fraternelles. Là, le secret devient une invitation.
Les expériences surréelles dans le texte ethnographique
Sur le terrain religieux afro-brésilien, le chercheur s’aperçoit très vite que les interlocuteurs font usage presque exclusivement d’un discours lié au surréel et à leur code culturel-religieux. À partir de cette constatation, deux questions se posent : comment traiter ces données dans le texte ethnographique ? Quelle place doivent-elles avoir dans l’analyse anthropologique ?
Or, comme Goldman[22] l’a observé, lorsqu’on écoute un adepte des religions afro-brésiliennes, on a tendance à considérer son discours comme faux ou comme une vérité éloignée de la nôtre. J’ai très tôt refusé cette logique. Je ne souhaitais pas non plus donner cette couleur à mon ethnographie. Lors de mes recherches dans les maisons de culte j’ai également pu vivre des expériences surréelles. Cependant, comment les évoquer dans le texte scientifique ?
L’anthropologue Marilyn Strathern[23] évoque le caractère fictionnel de l’écriture anthropologique comme quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Ce caractère ne représenterait pas une distorsion de ce qui est narré, au contraire il fait partie des stratégies rhétoriques et des artifices de la narration ethnographique. En partant du fait que la construction du texte ethnographique constitue un outil au travers duquel les catégories tendent à être négociées, le fait d’« inventer » la culture de l’Autre renforcerait l’attribution des significations menées par les anthropologues, activées à partir de leur propre culture et inscrites de façon ethnocentrique. En revanche, comment peut-on développer la conscience d’être en présence de divers mondes sociaux quand nos thermes sont limités à notre propre monde ?
L’anthropologue se confronte à la tâche de décrire ces mondes et de créer son texte en faisant le pont entre les expériences du lecteur et celles de ses interlocuteurs. Selon l’auteure, une bonne description est capable d’élargir l’expérience du lecteur (et ici, j’ajoute : celle de l’écrivain aussi). Cela sans aucune garantie que le travail n’ira pas fomenter des préjugés et enfermer encore plus des perspectives déjà étroites.
Strathern aborde également la question du moment ethnographique[24]. Selon elle, il s’agit d’un moment d’immersion, à la fois totale et partielle, une activité totalisante mais pas univoque, dans laquelle le chercheur est impliqué. Ainsi, l’un des éléments qui apportent un défi au travail de terrain c’est que le chercheur doit le réaliser en gardant à l’esprit une autre activité bien différente : l’écriture. À cela, Strathern ajoute que l’écriture seulement fonctionne en étant une récréation imaginative des effets du travail de terrain. C’est-à-dire, une fois que les idées et les narrations qui conféraient du sens à l’expérience de terrain nécessitent d’être réarrangées pour avoir du sens pour un autre public, l’écriture ethnographique crée un deuxième terrain, La relation entre ces deux terrains est complexe, car chacun constitue un ordre d’engagement qui habite ou touche partiellement, mais n’englobe pas vraiment l’autre. Comprendre qu’aucun des deux ne sera jamais en conformité avec l’autre est pour cette auteure une expérience anthropologique commune. Le chercheur doit ainsi habiter les deux terrains en même temps. Elle suggère aussi que le chercheur doive valoriser et s’engager dans des relations sociales que les interlocuteurs puissent souhaiter établir avec lui, car de cette manière, il peut devenir partie de ces relations.
J’ajoute à la disposition et à la capacité d’être affecté dont parle Favret-Saada l’expérience de l’inattendu, l’expectative de la surprise dont parle Strathern pour penser ma trajectoire de travail.
Quand la vie imite le mythe : « il fallait être une fille d’Oxum »
Lors de mes visites aux terreiros et de mes conversations avec les adeptes religieux, il n’était pas rare d’écouter la phrase « ah, mais il fallait être une fille d’Oxum », comme réaction au sujet de ma recherche et par rapport à ce qui l’a motivé (c’est-à-dire, les concessions qui m’ont été faites pour accéder à certains secrets rituels). J’ai donc compris qu’être fille d’Oxum expliquait beaucoup des choses.
Dès qu’on commence à vivre entre les groupes religieux afro-brésiliens, on est « présenté » à leur système de compréhension qui constitue en soi un autre monde. On se trouve aussi exposé à ce système et analysé à partir de ces éléments. Cela veut dire que les traces de notre personnalité sont interprétées à l’intérieur d’un répertoire d’archétypiques des orixás. La théologie afro-brésilienne indique que tout le monde, au moment de sa naissance (ou même avant, dans certains cas), a sa tête adoptée par un orixá. Le jogo de búzios (jeu oraculaire de cauris) c’est ce que montre chaque orixá à la personne à qui il appartient. Néanmoins, il est commun dans le quotidien des terreiros que les gens s’aventurent à des intuitions sans prétention (« regarde qu’est-ce qu’elle est jalouse, elle doit être fille d’Oxum ! », « il est tellement stressé, ça ne m’étonnerait pas qu’il soit d’Ogum ! », etc.). Il n’a pas fallu longtemps pour que je sois insérée dans ce système de compréhension en tant que fille d’Oxum, ce qui s’est confirmé postérieurement par le jeu oraculaire.
L’orixá de Pai Manoel, le chef de culte qui m’a permis de réaliser le rituel d’initiation, est Ogum Xoroquê. Xoroquê un Ogum-Exu. Ma relation avec lui pouvait donc être expliquée par la relation mythique entre nos orixás respectifs, Exu et Oxum.
Dans le panthéon afro-brésilien, l’orixá Exu est le messager. Selon Serra[25] c’est lui qui livre aux ará-orum (les dieux et les ancêtres) les prières de la part des gens qui les invoquent. Il est le messager de toutes les offrandes et des rétributions qu’elles impliquent. Grâce à ce poste qu’il a conquis, il a la priorité lors des libations, des prières et des sacrifices d’animaux : c’est toujours lui qui mange en premier. Il est le seigneur des carrefours, des chemins et de la communication.
Dans un essai sur l’Hymne Homérique IV[26], Serra souligne qu’Exu s’inscrit dans le « type trickster ». Ce type a pour caractéristique la perturbation, la transgression et la subversion, au point de défier les puissances supérieures avec lesquelles ils se rapportent dans sa qualité d’intermédiaire entre les dieux et les hommes. Néanmoins, le trickster est aussi promoteur du progrès : c’est au trickster que revient le rôle d’introduire le désordre dans l’ordre pour l’empêcher de s’étrangler.
Oxum, pour sa part, est la reine des eaux douces (rivières, fontaines, lacs, cascades). Selon Serra, Oxum a une indéniable importance dans le panthéon yoruba, où elle figure en tant qu’une des divinités les plus élevées[27]. Dans le candomblé son poste élevé est souvent souligné, son éminence est reconnue parmi les divinités et sa valeur évoquée par les hommes. Cet auteur narre un mythe qui démontre bien la prééminence d’Oxum, tant en Afrique qu’en Afro-Amérique[28].
Selon le mythe, seize orixás ont été envoyés par Olodumaré en tant que demiurges de notre monde, instruits sur les procédures nécessaires pour la garantie du bien-être de l’humanité. Ils se sont engagés à veiller sur l’efficacité des consignes de l’oracle sacré. Toutefois, ils avaient exclu Oxum, la chargeant tout simplement de la préparation des animaux abattus et en lui recommandant de ne surtout pas les goûter. Pourtant ils échouaient : tout ce qu’ils déterminaient résultait dans l’exact opposé, causant des effets terriblement néfastes pour le monde. Orumilá s’est dirigé une autre fois vers l’orun afin de consulter Olodumaré, qui a révélé la cause de l’insuccès : l’absence de la 17e personne divine de par l’exclusion d’Oxum. Les Irunmalé ont vite demandé à la déesse de les rejoindre et les accompagner aux lieux de sacrifice. Oxum a pourtant refusé. Malgré les supplications elle s’est obstinée et a même humilié les suppliants. Finalement, elle décide de répondre aux appels répétés, mais de façon conditionnelle : elle était enceinte et son enfant pourrait la remplacer au poste pour lequel on la convoquait, mais seulement si c’était un garçon. Tous les Irunmalé se sont engagés en ce sens, en faisant des offrandes à cette intention. L’enfant est donc né. Neuf jours après l’accouchement, la mère l’a présenté : il s’agissait effectivement d’un garçon. Ils lui ont donné le nom d’Axetuá (changé ensuite pour Oxetuá par le dieu devin) et ils lui ont fait prendre sa place dans le groupe des odus avec eux, également en assistant aux sacrifices. À son tour, Oxum a donné à son fils le nom magique d’Akin Oxó. On a déterminé, alors, qu’il devrait toujours participer aux réunions des divinités majeures[29].
À partir de ce mythe, Serra nous narre deux crises. La première, l’exclusion d’Oxum qui bouleverse le monde. La naissance d’Oxetuá vient tout réparer, mais il arrive ensuite une terrible sécheresse, raison pour laquelle la terre faillit périr. La raison de la calamité ne s’explique pas. Serra conjecture la rupture d’un accord, peut-être une nouvelle exclusion d’Oxetuá ou une omission qui aurait déplu à Oxum. « Finalement, la sécheresse est la privation de l’eau, élément régit par la déesse. C’est-à-dire, la sécheresse est l’absence d’Oxum »[30].
Reprenons la continuation du mythe :
Orumilá, le dieu devin, a révélé aux autres qu’il serait nécessaire d’amener les supplications des divins à Olodumaré avec un grand sacrifice. Un par un, tous les Odu se sont engagés à cette entreprise, mais ils ont tous trouvé la porte de l’orun fermée. Quand le tour d’Oxetuá est arrivé, il a fait des consultations préalables avec des mystérieux babalaôs. Instruit par eux et en veillant de prévenir Exu avant de partir en voyage à l’orun – voyage dans lequel le seigneur des chemins les a accompagné – Oxetuá a obtenu d’Olorun des « faisceaux de pluie » pour fertiliser la terre et des bénédictions pour les humains. Les Irunmalé lui ont offert plein de régals et l’ont couvert de richesses, qu’il a repassées à Exu Odara. En rétribution, Exu Odara lui a conféré un privilège : dès lors, Odara seulement accepterait de transporter des offrandes transmises par Oxetuá[31].
Exu s’étonne du fait d’Oxetuá l’ait cherché pour l’informer de son voyage. Exu s’étonne encore une fois quand Oxetuá lui a offert les cadeaux reçus des Irunmalé. Selon Serra, l’indication qu’Odara n’avait pas été proprement honoré est réitéré : c’est évident qu’Exu et qu’Oxum avaient été ignorés par les grands dieux, que les deux ont eu leurs droits méprisés ; tout cela a engendré de néfastes conséquences pour le monde entier. L’auteur indique alors une proximité significative de ces deux orixás à partir de ce mythe, ce qui selon lui, correspond à ce que l’on entend parmi les maisons de candomblé : il existe une liaison étroite entre Exu et les mères ancêtres, une véritable passion d’Exu chez les orixás des eaux et qu’il ne nie rien à Oxum.
Un chef de culte m’a déclaré qu’Oxetuá est le propre Exu, tel qu’il se présente dans le jeu oraculaire, à l’intérieur duquel il a un rôle décisif. Il affirme qu’Exu a été un adjudant d’Ifá, avec qui il a appris la science et l’a prise pour lui, mais il n’a pas conservé le privilège : Oxum, avec un charme, lui a pris les coquilles [32].
Pour Serra ce mythe représente la divinité féminine, le genre féminin tout court, comme si Oxum concentrait tout le pouvoir distribué aux femmes du monde. Son exclusion a rendu le conseil masculin impuissant. Son absence a causé les plus grands troubles dans l’univers, l’échec de la création. Les hommes finissent par comprendre que sans Oxum le monde ne résiste pas. Lorsqu’elle exprime l’ultime condition pour le succès de l’entreprise divine (avoir un garçon), elle a voulu s’assurer du pouvoir de reproduire les mâles, le masculin. Les Irumalés, dans le but de définir le genre du bébé, ont déposé leur axé[33] sur la tête d’Oxum, qui a ainsi reçu l’énergie créatrice des dieux masculins.
Selon Serra, dans les candomblés de Bahia, l’on parle secrètement de cette proximité d’Oxum et Exu et de ses conséquences : l’enfant mystérieux, le salvateur fils d’Oxum : Oxetuá, c’est-à-dire que le père d’Oxetuá serait Exu.
Le jogo de búzios a seize coquilles. Si tu demandes à n’importe quel prêtre ou prêtresse, ils vont dire : seize. Mais elles ne sont pas que seize ! Il y a encore une autre qu’on ne mentionne pas. Devinez qui c’est ! Oxetuá[34].
Oxum est tenue pour la séductrice ensorceleuse qui arrive à tout obtenir d’Exu. C’était pour cette raison, à partir du code de compréhension religieux, que ce fait était (et est encore) remémoré comme la motivation ou l’explication de ma trajectoire : « Il fallait être une fille d’Oxum » pour avoir eu l’autorisation d’Exu, l’orixá trickster, considéré le plus « difficile ». Moi, comme une bonne fille d’Oxum, j’aurais des attributs capables de transmettre de la confiance aux gens et cela aurait encore plus d’effet avec les fils d’Exu, en raison de cette liaison spirituelle mythologique. À plusieurs reprises, j’ai écouté Pai Manoel plaisanter en disant que « je lui donnais envie de tout raconter » et que « ces gens d’Oxum sont comme ça, ils sont attirés par les secrets ». Les relations mythiques d’affection et de désaffection sont déterminantes dans la vie des individus religieux. Les archétypes sont des modèles qui les aident à comprendre le monde et les relations humaines et évidemment, nous chercheurs, n’y échappons pas, nous sommes introduits et analysés selon ces modèles de compréhension.
À l’occasion d’un rituel de préparation de la jurema, boisson rituelle sacrée, dans une maison de culte d’umbanda, la cheffe du culte m’avait accordé le droit de photographier la fête dans le salon principal, mais je devais arrêter dès que le rituel passait vers le cercado do Boiadeiro, lieu où la jurema serait enterrée[35] et où le rituel arriverait à son terme. Elle a justifié l’interdiction en disant que le Boiadeiro (entité qu’elle incorpore) était un peu austère et pourrait ne pas aimer mon intervention. J’ai donc photographié le début de la fête dans le salon et une fois que les adeptes se sont dirigés vers le cercado, situé au fond de la maison, bien que je pouvais assister au rituel, je devais arrêter de photographier. J’ai commenté avec un ogan que j’arrêtais et il m’a proposé d’aller demander l’autorisation directement à l’entité, qui était déjà « en terre » (incorporée à la cheffe de culte), chose que j’ai décliné, intimidée. Soudain, j’entends des gens qui étaient à l’intérieur du cercado qui m’appelaient. J’ai vite répondu à leur appel pour découvrir que l’ogan avait lui-même demandé à ma place. Le Boiadeiro, malgré ma surprise, l’avait permis. Je suis ainsi rentrée au cercado, lui ai demandé une bénédiction en faisant une révérence rituelle à laquelle il a répondu en me tenant dans ses bras dans une embrassade. J’ai donc continué à photographier le rituel, cette fois-ci à l’intérieur du cercado, en ayant l’accès à l’assentamento et à tous les fondements. La cheffe de culte, à la fin du rituel, le Boiadeiro ayant déjà quitté son corps, était vraiment surprise d’apprendre que la permission m’avait été accordée par l’entité.
Attraper la bougie, c’est à moi de la faire, pour une autre chose c’est à l’orixá le faire. Le secret ne se révèle pas à travers une image car l’image ne montre pas l’énergie du moment, la transe. Il existe le bon moment et la bonne personne. Si l’orixá l’a permis, le rituel va être photographié. Ce n’est pas à nous d’en décider. Il faut comprendre que nous sommes juste des instruments[36].
Quelques années après, je photographiais un rituel dans la même maison, lorsque la cheffe de culte a reçu son Oxum. Elle était déjà « en terre » depuis un moment, je photographiais toujours et lorsqu’elle était devant moi, j’ai pointé vers elle la caméra et juste après avoir fait la photo, je me suis aperçue qu’avec le bras tendu dans ma direction, elle m’appelait. Le moment décisif, dirait Cartier-Bresson.[37] J’ai placé l’appareil sur mon dos et je suis allée à sa rencontre. Elle m’a enlevé les lunettes et a touché longuement mes yeux. Ensuite, elle m’a pris dans ses bras. Une fois la fête finie, les adeptes faisaient des commentaires par rapport à ce moment. Pour eux, le geste était une bénédiction symbolique par rapport à mon activité photographique. Depuis, ils m’appellent affectueusement « la fille des yeux d’Oxum ».

Quelques adeptes religieux et quelques chercheurs ont relatés les conséquences vécues par ceux qui se sont moqués des règles et ont photographié des moments considérés comme secrets sans permission. L’anthropologue Roberto Motta, dans un entretien avec Silva[38] raconte que :
Dans une obligation de Balé auquel Manuel [chef de culte] ne m’a pas laissé assister, j’ai ouvert la porte et j’ai pris un cliché. Quatre mois après j’ai reçu un diagnostic d’un problème de vue tellement sérieux que j’ai trouvé qu’il s’agissait d’une punition[39].
L’anthropologue Janecléia Rodrigues, chercheure des religions afro-brésilienne à Alagoas, m’a raconté en entretien qui lui est arrivé de photographier une fête d’Oxum sans permission. Selon elle, la cheffe de culte avait préalablement exprimé que ladite divinité n’était pas trop sympathique vis-à-vis de la photographie.
Les photos sont sorties complétement noires. J’avais un appareil digital et un autre argentique. Les photos des deux appareils sont sorties noires. Il n’y a pas d’explication. La cheffe du culte m’avait dit de ne pas photographier et je l’ai fait quand même[40].
Une histoire similaire m’a été racontée par Mãe Neide, cheffe de culte. Son erê, entité enfantine, n’aime pas être photographié. À l’occasion d’une fête, un fils de la maison le prenait en photo et l’entité lui a demandé de cesser. Il insistait en le photographiant en cachette. Inexplicablement, il a fini par perdre toutes les photos, conséquence que Mãe Neide attribue à l’influence de l’entité.
L’importance donné aux chercheurs qui s’intéressent à leur religion et à « raconter leur histoire » est un élément récurant dans le discours de mes interlocuteurs. Cependant, Silva[41] a trouvé deux opinions opposées chez ses interlocuteurs : l’un disant que les chercheurs sont des « envoyés des orixás » tandis qu’un autre exprime son mécontentement par rapport à certaines attitudes de quelques chercheurs qui portent préjudice à la religion et rappelle que la religion « survivra aux chercheurs ».
Mon lecteur a pu comprendre que mon parcours me met dans une catégorie d’exception, c’est-à-dire que, selon mes interlocuteurs je suis quelqu’un de choisi par les orixás pour accéder à leurs secrets et cela est étroitement lié à mon orixá Oxum. Dans cet univers, les non-humains interviennent et ont un pouvoir sur notre travail.
Lors de la 29e Reunião Brasileira de Antropologia, congrès de l’Association Brésilienne d’Anthropologie, j’ai reçu le Prix Pierre Verger pour une sélection de dix photographies appartenant à la photo-ethnographie de l’initiation au candomblé. Ces deux réussites ont été vues par Pai Manoel en tant qu’une confirmation de l’autorisation de son orixá. Cette dimension de la compréhension de Pai Manoel montre que la notion d’efficacité symbolique élaborée par Lévi-Strauss concernant les méthodes thérapeutiques[42] peut être appliquée au contexte religieux afro-brésilien concernant aussi la relation de négociation entre adeptes et divinités (humains et non-humains).
Les secrets des anthropologues
Dès le début de mon insertion auprès des religions afro-brésiliennes je me suis aperçue qu’il y avait à l’intérieur du cercle académique une espèce de mauvais jugement dirigé vers les anthropologues qui avaient adhéré à ces religions. Des questions par rapport à mon éventuelle appartenance étaient (et sont toujours) fréquemment posées avec un certain mépris. Comme si, au nom de la scientificité, le chercheur se devait de ne pas franchir certaines limites ? Néanmoins, l’initiation est tolérée par les intellectuels si elle est motivée par l’obtention d’informations spéciales comme l’illustre bien le cas de Roger Bastide.
La séduction de Bastide pour les terreiros l’a amené à défendre une méthodologie de terrain selon laquelle le chercheur ne devait pas se priver de l’expérience sociale de ses interlocuteurs, il devait la vivre comme si c’était sa propre expérience. L’auteur arrive même à parler d’une crise de conscience : la prise de conscience de sa propre mentalité cartésienne par rapport au monde du candomblé. Il s’est rendu compte de la nécessité de se « convertir » à une autre mentalité s’il voulait la comprendre. Il demande à son lecteur de ne pas se tromper par rapport au sens du mot « convertir », car il ne s’agit pas de l’acceptation de l’existence d’une pensée prélogique et du déni de l’unité et de l’identité des structures mentales. En fait, Bastide s’est convaincu de se laisser pénétrer par une culture différente de la sienne au moment d’entrer au temple. Pour lui, la recherche scientifique exigeait le passage préliminaire par le rituel d’initiation.
Dans son texte, Bastide écrit que les mères spirituelles l’ont traité comme un « fils blanc »[43] et qu’elles ont compris, avec « leur caractéristique supérieure d’intuition » son désir pour de nouveaux éléments culturels, en acceptant qu’il ne serait pas capable de se nourrir de ces nouvelles substances. C’est-à-dire que les chefs de culte ont tout simplement accepté que Bastide ne pourrait jamais les absorber complètement, malgré son passage par le rituel d’initiation.
Vagner Gonçalves da Silva[44] observe que dans les recherches avant 1940, l’initiation des anthropologues était justifiée en termes de besoins « techniques », le chercheur restant relativement libre de réfléchir aux significations de sa conversion et à sa participation au culte. Silva souligne encore qu’après Bastide et Verger, les frontières entre observation et communion se sont révélées poreuses et ainsi le « devenir natif » devient un mot d’ordre pour plusieurs générations de chercheurs.
Selon l’anthropologue Sergio Ferreti[45], l’anthropologie des religions est l’un des domaines dans lequel nous pouvons constater la critique du travail de l’anthropologue en tant qu’auteur et créateur. Ainsi, l’auteur souligne un problème commun au sein de ces débats : le chercheur qui lors de son terrain se présente comme un dévoué visant une insertion, montre, au sein de l’université, entouré par l’aura d’une prétendue « neutralité », une certaine froideur pour garantir la scientificité de son approche. Dans ces circonstances, on critique l’éloignement de l’anthropologue, l’absence d’une approche qui emphatise la sacralité et l’émotionnel.
En plus de l’acceptation de la foi des chercheurs, il existe encore une autre question qui mérite d’être évoquée, celle de l’engagement des chercheurs avec leurs interlocuteurs. Silva[46] l’a abordé, par exemple, en traitant de l’influence que les chercheurs peuvent exercer lors du travail ethnographique, dans la mesure où ils permettent différents accès aux expériences personnelles et sociales des gens avec qui ils se sont engagés. Souvent le chercheur devient l’objet de curiosité du groupe étudié, dans une dynamique de contrepartie de sa propre curiosité. Silva expose une situation qui l’a fait comprendre comment en général l’anthropologue n’a pas l’habitude de s’exposer dans ses échanges (ou ne le veut pas) : une fois, sur son terrain, une mère-de-saint lui a posé une question par rapport à sa préférence sexuelle, en raison du fait que ces religions permettent la convivialité des individus, des orientations sexuelles variées, et stimule, à partir d’une vision alternative de moralité, l’externalisation des pulsions affectives et émotionnelles. Selon lui, il est naturel que dans ce contexte, les chercheurs puissent se sentir subjectivement motivés à établir des relations moins formelles avec leurs interlocuteurs, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre personnel. Personnellement, je pense que l’anthropologie se fait avec les relations. L’anthropologue doit donner autant qu’il reçoit.
Les histoires d’engagements, de motivations superposées, d’affectivités et de rancœurs, même si elles ne sont pas toujours présentes dans la pratique ethnographique, sont très valorisées par les religieux (et par les chercheurs également), car elles peuvent fournir des faits d’un autre ordre et parfois indispensables pour la compréhension. L’anthropologue Rita Segato, interviewée par Silva[47], souligne le fait que les chercheurs eux-mêmes peuvent avoir de la jalousie par rapport à leurs réseaux de connaissances de terrain et l’interprète comme une façon de préserver des secrets et les engagements établis que les chercheurs ne veulent pas toujours partager avec leurs paires.
Le don du secret
Ma liaison avec l’orixá Exu est souvent mise en évidence par les adeptes, car après tout, le don majeur m’a été donné par lui : l’autorisation m’a permis la réalisation de ce travail et de le supporter devant les possibles mauvaises réactions. Ce don a conduit mon travail vers des chemins inattendus et m’a surtout obligé à adopter une position particulière par rapport aux données obtenues.
En anthropologie, parler de don nous renvoie à Marcel Mauss et son texte fondamental « Essai sur le don » [48]. Mauss évoque plusieurs formes d’organisations sociales présentes parmi divers groupes et régions. Il met en évidence que le don est l’opposé de l’échange mercantile, cependant il y cherche l’ origine de l’échange. Pour lui, les échanges sont réalisés sous la forme de cadeaux apparemment volontaires, mais qui, en réalité, sont obligatoirement donnés et rétribués. Les prestations primitives seraient donc régulées par trois obligations interconnectées : donner, recevoir et rétribuer. Chacune est capable de créer des liens d’énergie spirituelle entre les acteurs, des attachements d’âmes associés au prestige. À cette force, être spirituel ou expression symbolique, Mauss a donné le nom de mana. Il a donc observé que la matrice de ce lien entre les âmes (le mana) se trouvait dans l’obligation de la réciprocité mutuelle.
En guise de conclusion, j’évoquerais la notion d’alliance développée par le même auteur. L’argument central du don est qu’il produit de l’alliance, tant matrimoniales que politiques, religieuses, économiques, juridiques et/ou diplomatiques. La production des alliances avec les chercheurs serait de l’intérêt des adeptes car elles apporteraient visibilité et prestige, en plus de contribuer à la lutte contre l’intolérance religieuse grâce à la compréhension et à la diffusion de ses pratiques.
Les alliances sont réalisées sous forme de liens fraternels où, souvent, l’anthropologue se trouve confronté à la célèbre dichotomie « dedans/dehors ». Le chercheur peut éprouver une certaine confusion par rapport à ces barrières. Lisa Castillo[49] expose son expérience en tant que personne du dehors (être d’un autre pays, d’une autre langue, d’un autre groupe ethnique-social et sans initiation au candomblé) et du développement de liens qui franchissent les limites de la recherche. Castillo attire notre attention sur l’importance de la création de liens d’amitié qui l’ont aidée à surmonter les différences, mais pas seulement : ils signalent l’existence de quelque chose en commun avec ces personnes-là.
Dans mon terrain à Alagoas, j’ai souvent constaté que les adeptes religieux ne distinguaient pas très bien la dimension du travail de recherche d’un anthropologue dans ses particularités et préoccupations. Ils finissent par nous « adopter » dans leurs contextes, ils nous accueillent dans des relations d’amitié qui peuvent faire basculer la frontière d’appartenance à la religion. L’« ami-anthropologue » finit par faire se confondre les dimensions intérieure et extérieure à la religion. Finalement, nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Nous pouvons ne pas être initiés, ne pas être quelqu’un du dedans, mais nos liens affectifs nous laisseront difficilement parmi ceux de l’extérieur.
Bibliographie
BASTIDE R., Estudos afro-brasileiros, São Paulo, Perspectiva, 1973.
CARTIER-BRESSON H., Image à la Sauvette, Göttingen, Steidl, 2014 (1952).
CASTILLO L. E., Entre a oralidade e a escrita : a etnografia nos candomblés da Bahia, Salvador, Edufba, 2008.
FAVRET-SAADA J., Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, Paris, Gallimard, 1997.
FERRETI S., Repensando o Sincretismo, São Paulo, EDUSP, 1995.
FONTES, L., Feitura de Santo – Um Registro do Secreto, Faculdade Integrada Tiradentes, Maceió, 2012.
–, A Dádiva do Segredo – A negociação do Segredo Ritual nas Religões Afro-alagoanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.
GOLDMAN M., « Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilheus, Bahia », Revista de Antropologia, São Paulo, v. 46, n. 2, 2003.
–, « Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia », Ponto Urbe. Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, ano. 2, versão 3.0, 2008.
JOHNSON, P. C., Secrets, Gossip and Gods, Oxford, Oxford University Press, 2002.
LATOUR B., Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, Éditions La Découverte, 1991.
LÉVI-STRAUSS C., « L’efficacité symbolique », Revue d’histoire des religions, t.135, n. 1, 1949, pp. 5-27.
–, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958.
MAUSS M., « Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1968.
SERRA O., Águas do Rei, Petrópolis, Vozes, 1995.
–, Hino Homérico IV a Hermes, São Paulo, Odysseus, 2006.
–, Louvor dos orixás : Cantos Crioulos, São Paulo, Odysseus, 2019.
SILVA V. G., O Antropólogo e sua Magia : Trabalho de Campo e Texto Etnográfico nas Pesquisas Antropológicas sobre Religiões Afro-brasileiras, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
STRATHERN M., O efeito etnográfico e outros ensaios, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
VERGER, P. F., Orixás deuses iorubas na África e no Novo Mundo, trad. par M. Aparecida da Nóbrega, Salvador, Corrupio, 2002.
–, Saída de iaô, São Paulo, Axis Mundi Editora, 2002.
–, Dieux d’Afrique, Paris, Revue Noire, 2002 (1995).
WAGNER R., A invenção da Cultura, trad. par M. Coelho de Souza, São Paulo, Cosac Naify, 2012.
[1] Ilê Axé désigne la maison de culte. D’autres termes sont également communs, comme terreiro, roça et barracão. L’Ilê Axé Legionirê est situé au quartier Benedito Bentes, le plus populeux de la ville de Maceió, capitale de l’État d’Alagoas, au nord-est du Brésil.
[2] FONTES L., Feitura de Santo – Um Registro do Secreto, Faculdade Integrada Tiradentes, Maceió, 2012.
[3] Feitura vient du portugais Fazer, faire. Santo, (saint) est une des désignations des orixás, les divinités afro-brésiliennes.
[4] La camarinha est la chambre où les adeptes restent en réclusion lors des rituels d’initiation. Entrar na camarinha (entrer à la camarinha) est une expression pour dire « s’initier ».
[5] GOLDMAN M., « Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilheus, Bahia », Revista de Antropologia, São Paulo, v. 46, n. 2, 2003, pp. 445-476.
[6] Idem, p. 448.
[7] GOLDMAN M., « Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia », Ponto Urbe. Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, ano 2, versão 3.0, 2008, en ligne.
[8] LATOUR B., Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, Éditions La Découverte, 1991.
[9] Ibidem.
[10] GOLDMAN M., « Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia », op. cit., p. 7 (trad. Libre de l’auteur).
[11] WAGNER R., A invenção da Cultura, trad. par M. Coelho de Souza, São Paulo, Cosac Naify, 2012 (1938).
[12] GOLDMAN M., « Os tambores do antropólogo : antropologia pós-social e etnografia », op. cit.
[13] WAGNER R., A invenção da Cultura, op. cit.
[14] GOLDMAN M., « Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia », op. cit.
[15] FAVRET-SAADA J., Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage. Paris, Gallimard, 1977.
[16] –, Désorceler. Paris, Éditions de l’Olivier, 2009, p. 146.
[17] Idem., pp. 150-151.
[18] FAVRET-SAADA J., Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, op. cit., pp. 29-30.
[19] Ibidem.
[20] Idem, pp. 152-153.
[21] Idem, p. 156.
[22] GOLDMAN M., « Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia », op. cit.
[23] STRATHERN M., O efeito etnográfico e outros ensaios, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
[24] Ibidem.
[25] SERRA O., Louvor dos orixás : Cantos Crioulos, São Paulo, Odysseus, 2019.
[26] –, Hino Homérico IV a Hermes, São Paulo, Odysseus, 2006.
[27] Ibidem.
[28] En 1981, Pierre Verger a documenté et publié ce mythe : Orishas, les Dieux Yorouba en Afrique et au Nouveau Monde. Pour sa part, Juana Elbein dos Santos a transcrit et traduit un itan [ensemble de mythes, de chants, de légendes yoruba, ndlr.] de l’odu qui a le nom d’Oxetuá et comporte une version plus complète du même mythe documenté par Verger.
[29] Ibidem.
[30] Idem, p.133.
[31] Idem, p.131. [« L’odu est une histoire mythologique associée aux différentes positions des coquillages, qui raconte le destin de la personne. Il est fortement lié à son orixá de tête et à la mythologie qui accompagne cet orixá, mais il assume également des qualités propres, liées à la personne », voir Clarice Mota et Marieta Reis, « Axé! Santé, maladie et soins dans les terreiros de Candomblé de Bahia », Parcours anthropologiques, 16, 2021, en ligne ndlr.].
[32] Entretien réalisé en mai 2015.
[33] Axé est la force sacrée des orixás.
[34] Entretien réalisée en mai 2015.
[35] Dans cette maison de culte, sept jours avant le Toré de Caboclo, fête publique en hommage aux entités du culte jurema (le culte et la boisson ont le même nom), existe le rituel de préparation de la boisson, réservé aux gens appartenant à la maison. La boisson est donc préparée par la cheffe de culte et enterrée dans un lieu spécifique du cercado do Boiadeiro. Lors de la fête publique, la boisson est déterrée et distribuée aux fils de visiteurs (en quantité réduite et en dehors du contexte rituel).
[36] Entretien réalisée en 2014.
[37] CARTIER-BRESSON H., Image à la Sauvette, Göttingen, Steidl, 2014 (1952).
[38] SILVA, V. Gonçalves da., O Antropólogo e sua Magia : Trabalho de Campo e Texto Etnográfico nas Pesquisas Antropológicas sobre Religiões Afro-brasileiras, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
[39] Idem, p. 104.
[40] Entretien réalisé en mars 2015.
[41] SILVA, V. Gonçalves da., O Antropólogo e sua Magia, op. cit.
[42] Voir LÉVI-STRAUSS C., « L’efficacité symbolique », Revue d’histoire des religions, t.135, n. 1, 1949, pp. 5-27, et son ouvrage Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, vol. I, p. 220.
[43] BASTIDE R., Estudos afro-brasileiros, São Paulo, Perspectiva, 1973.
[44] SILVA, V. Gonçalves da., O Antropólogo e sua Magia, op. cit.
[45] FERRETI S., Repensando o Sincretismo, São Paulo, EDUSP, 1995.
[46] SILVA, V. Gonçalves da., O Antropólogo e sua Magia, op. cit.
[47] Ibidem.
[48] MAUSS M., « Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1968.
[49] CASTILLO, L. Earl., Entre a oralidade e a escrita: a etnografia nos candomblés da Bahia, Salvador, Edufba, 2008.