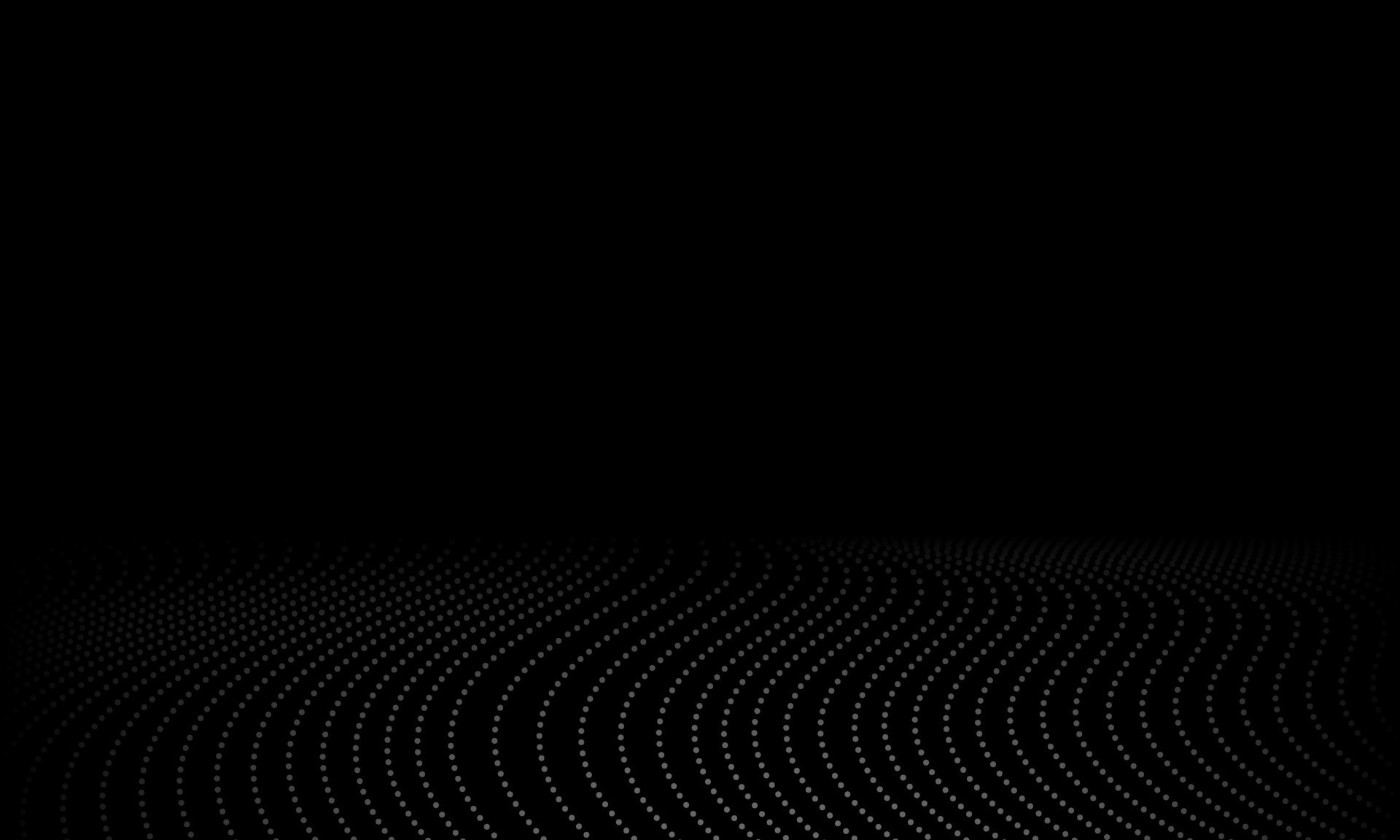Par Rémi Baudouï, Professeur au Département de Science politique et Relations Internationales de la Faculté des Sciences de la Société de l’Université de Genève et Directeur du laboratoire InCite et Manel Kabouche, architecte et urbaniste. Docteure de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble.
L’histoire des villes est aussi celle de l’évolution de leur sécurité qui a pris jusqu’au début du XXe siècle la forme de murs et murailles afin de les protéger des menaces extérieures. Les mutations de la ville industrielle en ville post-fordienne sont à l’origine de nouvelles menaces dont les tragiques attentats du 11 septembre 2001 ont révélé l’importance. À partir de ce tournant majeur, l’élaboration de nouvelles politiques de sécurité urbaine aboutit à l’édification de nouveaux murs dans la ville dont les caractéristiques morphologiques sont inédites. À la matérialité et la verticalité du mur issu de la Révolution industrielle s’opposent des murs banalisés du point de vue constructif ou encore des murs associant matérialité et virtualité.
Depuis l’antiquité, la ville s’est définie par la muraille qui l’entourait afin de la protéger des menaces possibles d’invasion, de pillage et de destruction. Si les fortifications offraient les conditions de la sécurité, elles n’en participaient pas moins de la délimitation et de la distinction physique et formelle nécessaire entre espace urbain et campagne, entre espace marchand du négoce et espace de production rurale, entre un territoire libre aux mains d’une élite bourgeoise et un espace assujetti aux logiques d’imposition du seigneur féodal. C’est par la consécration des portes dans la muraille que la régulation entre l’urbain et la campagne fut assumée pendant des siècles. Le médiéviste Henri Pirenne a montré comment les mutations socio-économiques ont transformé en profondeur les morphologies des villes, leurs croissances ou décroissances mais aussi leurs délimitations selon les conjonctures[1].
Les historiens de l’urbanisme se sont communément accordés à reconnaître quatre phases dans la construction des villes ; la cité antique gréco-romaine protégée derrière ses fortifications défensives ; la ville du Moyen-Âge ceinturée par ses murs mais eux-mêmes sujets à d’importantes variations d’extension ou de repli selon la prospérité ou les crises et catastrophes survenues ; la ville moderne des Lumières acquise à l’ouverture au-delà même du maintien du carcan des murs du système royal ; la ville contemporaine marquée au tournant des XIX-XXe siècles, par l’arasement des fortifications historiques et la construction de son étalement au-delà de son périmètre historique[2]. Cette dernière phase fut longtemps interprétée comme la condition élémentaire de l’accès à la liberté d’être, de penser et de se déplacer. L’émergence dans les années 1960 du structuralisme et du marxisme a remis en cause cette interprétation. En décrivant l’hospice général et la prison moderne comme lieu de contrôle des corps dans l’espace afin de réprimer toute forme de déviance sociale et individuelle, Michel Foucault a démontré que de nouveaux murs pouvaient s’ériger dans la ville pourtant délivrée de ses murailles ancestrales[3]. Le concept de « ville disciplinaire » fut forgé[4]. Il fit l’objet d’importantes analyses notamment pour comprendre l’évolution des villes ouvertes de la révolution industrielle que l’on peut qualifier de villes fordistes par référence au modèle industriel de rationalisation et d’organisation scientifique du travail déployé par le constructeur américain Henry Ford dans ses usines de Détroit. C’est autour des centres d’exploitation des ressources et de la construction des ateliers et usines que les chevaliers d’industrie se sont évertués à édifier des logements et des cités d’habitation afin de sédentariser la main-d’œuvre à des fins productives dans une logique de distanciation sociale et spatiale destinée à les prémunir de toute idéologie marxiste et révolutionnaire[5].
Nous souhaitons réinterroger la pertinence de l’analyse foucaldienne qui a témoigné que l’étalement de la ville fordienne au-delà de son mur d’enceinte promptement abattu, a seulement transféré de l’extérieur vers l’intérieur les dispositifs de séparation et de contrôle des individus dans le territoire. Notre réflexion prend sens dans le cadre de la mutation à partir du milieu des années 1970 de la ville fordienne en ville post-fordienne. À la différence de la première, la ville occidentale d’aujourd’hui se caractérise par l’effacement du modèle de la grande industrie et du système productiviste du secteur secondaire au profit du déploiement de la tertiairisation de ses activités à même de répondre aux nouveaux enjeux de la division internationale des tâches dans les processus de production. À l’activité industrielle externalisée se substitue la mise en place de dispositifs souples et évolutifs permettant le déploiement de services dans les domaines de l’innovation technologique, de la recherche scientifique et de l’échange d’informations entre entreprises. La ville post-fordienne existe d’abord par la nature, la densité et la richesse des réseaux réels et virtuels qu’elle offre comme supports d’échanges de données, de savoir-faire et de modalités d’impulsion de l’innovation, de management et marketing. En assumant la mutation d’un modèle industriel et de la taylorisation à un modèle post-fordien de la tertiairisation et de services, la ville d’aujourd’hui, par la densité et le maillage des réseaux nécessaires à son développement, est soumise à des défis sécuritaires qui, bien que nouveaux, n’en apparaissent pas moins à la fois proroger et faire évoluer les anciens dispositifs de séparation établis sur le principe de la segmentation des territoires urbains.
De notables distinctions s’observent toutefois aujourd’hui entre les dispositifs de sécurisation des villes de ceux en cours de déploiement aux frontières entre États nations. À l’inverse des nouveaux murs frontaliers[6] programmés pour limiter l’afflux de migrants sans papiers, les systèmes de clôture qui se constituent aujourd’hui dans les villes post-fordiennes n’opposent pas nécessairement, visible à invisible et matérialité à immatérialité[7]. Certains types de séparations n’ont guère besoin de justifier une présence matérielle pour signifier l’impossibilité du franchissement, d’autres pourraient exister de manière plus virtuelle pour être pleinement efficaces. À la différence des murs érigés par le passé, dont la délimitation physique de la « verticalité » permettait d’assurer une différenciation entre intérieur et extérieur, les murs d’aujourd’hui s’érigent en instruments de la « profondeur » à même de contrôler un territoire urbain dans ses plis et épaisseurs[8]. Il existerait donc un continuum de barrières et murs imbriqués dans l’espace urbain dans une logique de juxtaposition, d’emboîtement et de superposition. Dans la mesure où la ville resterait « le dernier maquis où peuvent opérer dans une relative impunité des guérilleros modernes »[9], nulle raison à ne pas voir s’ériger toujours plus de nouveaux murs.
Notre analyse sera conduite en deux parties. La première témoignera de l’évolution des concepts d’insécurité et de sécurisation dans le cadre de la ville post-fordienne notamment autour de la rupture majeure des attentats du 11 septembre 2001. La seconde portera sur les différents types de murs que la ville post-fordienne recèle aujourd’hui.
Nouvelles insécurités des villes post-fordiennes et renouveau du paradigme sécuritaire
La ville a historiquement existé comme territoire exogène à son environnement. C’est en ce sens que les murs de la ville ont été déterminants pour penser son bien-être. Le barbare, du point de vue étymologique, représente la figure de celui qui n’appartient pas, ni par sa langue ni par ses mœurs et coutumes, à l’univers éclairé de la civilisation urbaine. Les romains qualifiaient de barbarus l’ensemble des peuples qu’ils maintenaient aux marges de l’Empire. Ce fut notamment le cas des tribus nomades repoussées derrière la construction du limes africain[10]. La menace venant prioritairement de l’extérieur, les édiles ont consacré leurs efforts à l’édification de la muraille et de son enceinte. Sa restauration continue, sa modernisation et son déplacement pour tenir compte des progrès des Arts de la guerre ont relevé d’une mission vitale pour la survie des habitants et de leur système politique et culturel.
La construction de la ville hors les murs à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et la constitution d’un Welfare State ont bercé dans l’illusion d’un effacement progressif des inégalités entre villes et campagnes mais aussi entre centres et périphéries mondiales. Après le choc des révolutions et de la Commune de Paris, la ville au tournant du XXe siècle est saisie par l’usage croissant de l’aviation aérienne dans les conflits armés. De la première guerre mondiale, en passant par le désastre de Guernica jusqu’aux bombardements de Londres ou encore des Alliés en Allemagne, la ville est érigée en cible stratégique. André Glucksmann témoigne qu’au XXe siècle « la menace de rayer une ville de la carte passe pour avoir une valeur dissuasive fondamentale avant même que la bombe thermo-nucléaire ne suscite les stratégies dites anti-cités »[11]. En tant cible consacrée, la ville justifie la constitution de systèmes défensifs de protection censés empêcher l’invasion terrestre ou par les airs[12]. En juin 1940 l’armée britannique dote la ville de Londres d’un anneau militaire défensif pour protéger la capitale de la menace allemande. La rupture de ce modèle stratégique est acquise avec les destructions nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki. L’installation dans la guerre froide modifie en profondeur les questions d’insécurité. Dans une diplomatie fondée sur le seul rapport de force entre grandes puissances, l’arme atomique contribue à la construction d’un équilibre bipolaire de la dissuasion entérinant la division territoriale de l’Europe en deux grands blocs. L’impossibilité de penser un apocalypse nucléaire facilite le déploiement d’un sentiment de sécurité de vivre en ville que renforce la signature à Moscou le 5 août 1963 d’un premier traité international d’interdiction des essais nucléaires qui anticipe le désarmement progressif des arsenaux nucléaires par les accords SALT I et SALT 2. La représentation de la ville que la guerre froide lègue à notre inconscient collectif est celle d’un territoire sécurisé par un no-man’s land à la fois de barbelés, de champs de mines et de missiles sol-air. A l’exemple des cités fortifiées du Moyen-Âge la ville occidentale semblait jusque-là préjuger que la paix était acquise au seul pris d’un suréquipement militaire et de la constitution de boucliers anti-missiles.
La chute du mur de Berlin, la déflation des aires d’influence entre les grandes puissances et la perte progressive de souveraineté des nations dans un monde économiquement ouvert, ravivent les anciennes divisions entre États, entre États et communautés et entre groupes ethniques[13]. Dans son traité de 1991 sur les menaces d’une nouvelle fracture planétaire opposant le Nord enrichi au Sud hétérogène et appauvri, Jean-Christophe Ruffin s’inquiète de l’opposition désormais en cours d’élaboration entre « les nouveaux barbares » et les pays développés soucieux de se protéger de leur venue par la construction d’un nouveau limes aux portes de l’Europe[14]. La guerre resurgit rapidement en son cœur. Nées des proclamations successives d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie, les premières guerres de l'ex-Yougoslavie en 1991-1992 placent la ville à l'épicentre des nouveaux conflits militaires dits de « faible intensité ». La ville historique de Dubrovnik encerclée est bombardée par l'artillerie serbe. Sont également menés les sièges et destructions systématiques des agglomérations d'Osijek, Vukovar, Mostar, Zadar ou encore Bascarsija. Le siège de Sarajevo de 1992 à 1996 par les forces serbes fait plus de 5 000 victimes civiles. L’ « urbicide » devient réalité.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont signifié un tournant majeur dans la prise de conscience des nouvelles insécurités pesant sur les villes. Le détournement d’avions de lignes utilisés comme missiles en différents points du territoire américain est un fait sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Deux aspects essentiels sont à observer. Le premier porte sur la perception des nouveaux risques pour les villes, le second porte sur la nature de la réponse à apporter pour limiter la menace pesant sur elles.
L’attaque contre les Twin Towers a déployé ses impacts au cœur même de ses dispositifs et modes de fonctionnement. La presqu’île de Manhattan fut paralysée par le déploiement d’une dynamique de crise systémique et multiscalaire affectant à la fois les territoires infra-urbains, métropolitains, régionaux, nationaux et intercontinentaux. L’impossibilité d’acheminer des secours a engagé la désorganisation des transports collectifs rapidement étendue aux circulations routières et aux services publics. Tous les systèmes et réseaux vitaux urbains, banques, hôpitaux, police, services d’appel d’urgence, protection civile se sont paralysés. L’arrêt des transports aériens est allé de pair avec la paralysie de Wall Street et la suspension de ses cotations. Dans l’incertitude économique provoquée par la fermeture de cette place financière et l’incertitude politique quant à la poursuite des menaces pesant sur l’Occident, les disruptions sont particulièrement importantes en matière d’échanges et de libre-circulation des hommes et des biens. À l’arrivée, le bilan est celui d’une crise économique sans précédent qui fait perdre à l’échelle mondiale plusieurs centaines de millions de dollars[15]. L’effondrement du tourisme international renforce la récession économique américaine et mondiale. Les attentats d’Al-Qaida ont produit des impacts nationaux et internationaux qu’aucun acte terroriste n’avait jamais atteints.
Par la dynamique de catastrophes qu’ils ont produites de Manhattan à la planète entière, les attentats du 11 septembre 2001 rappellent la nature des liens d’interdépendance qui existent désormais entre territoires et infrastructures de la ville post-fordienne. À l’inverse des analyses historiographiques engagées sur la ville du capitalisme triomphant qui postule de la nécessité pour la puissance privée et publique de structurer la ville dans une logique de sédentarisation des populations pour produire la valeur productive nécessaire à l’accumulation du capital et à sa redistribution, le concept de post-fordisme postule de la nécessité pour les villes de déployer leur attractivité dans une logique de compétitivité régionale, nationale et internationale en s’affranchissant du cadre morphologique historique dont elles avaient hérité. Il ne s’agit plus de souscrire aux principes d’une ville structurée par un centre historique attractif, des périphéries fonctionnelles séparant zones de travail avec ses unités de production des zones résidentielles, le tout dans une cohérence spatiale opposant clairement urbain et rural. Il s’agit prioritairement de repenser la ville comme un support et territoire ouvert facilitant le renouvellement de la valeur productive par des activités tertiaires et de services. L’enjeu fut de penser la ville comme une plate-forme attractive pour des acteurs privés que valorise un dispositif d’externalités performantes offert par la réalisation d’infrastructures rapides de transport – routes, voies ferrées et aéroports – mais aussi des infrastructures immatérielles – le câble, la fibre, les Technologies d’information et de communication (TIC) et les technologies numériques – des infrastructures d’accueil – hôtels, palais des congrès, salles de conférences – un environnement scientifique et intellectuel et une information de qualité susceptible d’œuvrer aux nécessaires prise de décision. Le concept de ville post-fordienne se moule parfaitement dans le modèle de la ville hors les murs polycentrique qui offre les conditions de construire le nouveau modèle territorial de l’innovation (MTI)[16] à même de produire localement la richesse dans des réseaux économique de villes intégrées à très grandes échelles. La perception de l’insécurité de la ville post-fordienne réside dans la mesure de ses fragilités en termes d’infrastructures et de réseaux.
En second, les attentats 11 septembre 2001, par la nature de l’acte et l’importance des destructions matérielles et humaines occasionnées, ont fait voler en éclat les catégories juridiques et culturelles établies jusqu’ici dans l’échelle de la violence humaine. En désignant ces attentats comme le premier « Pearl Harbor terroriste » du XXIe siècle, les acteurs publics, les définissent moins comme un acte terroriste que comme un acte militaire. La « guerre contre le terrorisme » devient prioritaire. Le paradigme de la ville comme espace protecteur s’est radicalement inversé. La ville est désormais le territoire de la vulnérabilité potentielle, d’un risque majeur dû à sa fonction désormais stratégique dans tout type de conflit qu’il soit de forte intensité comme dans le cas militaire – guerre du Golfe de 1991-1992 – ou les confits de faible intensité entre armées et milices rebelles – bataille de Mogadiscio de 1993. La perception des conditions mêmes du maintien de la sécurité dans les villes en est profondément modifiée. Leur sécurisation relève désormais d’un objectif stratégique justifiant la recherche d’une réponse globale sécuritaire posant comme principe initial que la protection urbaine ne peut être du seul ressort de la police. Elle exige la mobilisation tant de la police que de l’armée mais aussi des autres acteurs publics, des représentants de la société civile et de ses habitants.
Les nouveaux murs du dispositif sécuritaire des villes post-fordiennes
Les attentats du 11 septembre 2001 ont facilité la redécouverte de la fragilité consubstantielle des villes post-fordiennes déjà décelée dans le domaine des risques majeurs qu’ils soient naturels ou technologiques. Nous faisons ici référence aux catastrophes de Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986 et aux implications environnementales de la première Guerre du Golfe de 1990 par ses pollutions en hydrocarbures. Plus près de nous, la catastrophe de la Nouvelle-Orléans de 2005 a témoigné de la dynamique de crises et de réactions en chaîne que suscita l’ouragan Katrina engageant à la fois, la destruction des bâtiments, les ruptures des réseaux urbains d’approvisionnement électrique, les explosions de conduites de gaz, la pollution par hydrocarbures des territoires et jusqu’au chaos social résultant des émeutes, pillages, violences et crimes raciaux. Dans le domaine des conflits, il peut être également fait mention des émeutes de Los Angeles de 1992 et en matière terroriste de l’attaque au gaz serin dans le métro de Tokyo en 1995.
L’entrée de plain-pied dans des sociétés de la modernité définit désormais la ville post-fordienne comme une ville dont la survie est de l’ordre de la seule fonctionnalité et de la gestion de ses flux matériels et immatériels que représentent à la fois en amont la saisie des inputs et la formalisation de ses outputs en termes de connaissances, échanges, productions économiques et financières et productions de données et ressources virtuelles. La fragilité de ville est progressivement apparue dès lors résider dans la multitude des réseaux qui l’alimentent en vue de produire de la valeur consommable et exportable. L’introduction dans le domaine de l’insécurité des concepts de « dynamique de crise», d’« effet papillon » ou encore d’« effet domino » a témoigné de la prise de conscience progressive que la ville post-fordienne se trouve être progressivement dépendante de ses réseaux. Dans la normalité de leur fonctionnement, ils sont les agents du bien-être collectif. En cas d’atteinte majeure, ils peuvent être, par un processus de réversibilité de leurs usages fonctionnels, les agents et vecteurs de dysfonctionnements et désorganisations à l’origine de catastrophes matérielles, technologiques et humaines de grande ampleur[17].
Ces analyses nous permettent de comprendre en quoi les enjeux de la sécurisation de la ville post-fordienne se situent prioritairement aujourd’hui moins du côté de la sédentarisation des activités et des individus que du côté du maintien d’une fluidité permanente et ininterrompue des biens, des services et des hommes. L’enjeu fondamental de la gestion sécuritaire réside dans les efforts de prévention et de contrôle de gestion à déployer pour éviter toute menace de disruption pouvant engager un cycle dynamique de crises risquant de paralyser le système urbain par chocs et catastrophes successives. L’acteur de la sécurité s’apparente désormais à la figure professionnelle d’un gestionnaire de la fluidité qui doit se porter garant du maintien de la circulation de la multitude des flux urbains. Toutefois la limite imposée à cette mission est bien réelle. Lorsque la fluidité peut s’avérer porter des menaces et risques en exposant la ville à un ensemble de dynamiques potentielles de crise spécifique, le même gestionnaire se retrouve dans un exercice professionnel inversé. La segmentation des réseaux et la sédentarisation des individus dans l’espace relève alors du bon sens sécuritaire.
À ce stade de notre réflexion, il est nécessaire d’opérer une distinction entre les stratégies individuelles des habitants et celles des acteurs publics. Dans un marché libéral du foncier et du logement, les plus riches des premiers, enclins à faire usage de l’espace comme un outil stratégique de valorisation sociale et culturelle, peuvent être amenés à se protéger derrière les grilles et digicodes de gated communities également appelées walled communities qui les éloignent du danger de toute intrusion sociale extérieure. Pour les plus pauvres, alors que le choix résidentiel n’existe pas, la constitution progressive de banlieues de la relégation sociale s’accompagne d’un processus de décrochage sociétal. L’ambivalence de la stigmatisation se traduit chez les habitants « à la fois par une attitude de rejet et de défense de son lieu de résidence»[18]. Les caillassages de voitures de police ou des pompiers attestent de ce refus de l’intrusion extérieure vécue par les habitants comme une véritable provocation de la part des institutions publiques jouant de la violence légitime pour rétablir l’ordre alors qu’elles sont censées garantir à tout citoyen, égalité, équité et prospérité. À l’édification des murs matériels que les plus riches déploient pour se prémunir de toute forme de mixité sociale et culturelle, s’oppose l’édification de murs virtuels des ensembles de la pauvreté recluse de la République. Les acteurs publics, par leur mission d’aménagement et de développement, apparaissent bien devoir consacrer en dépit de moyens financiers jugés toujours insuffisants, le maintien de ces quartiers et ensembles dans le giron républicain.
La réflexion initiale sur l’édification des premiers murs dans le domaine de la gestion de la fluidité fonctionnelle de la ville relève de la mise en forme du concept de Critical Infrastructure – « infrastructure critique » – élaboré aux États-Unis au milieu des années 1990 dans le cadre, semble-t-il, du premier attentat du World Trade Center de 1993, de celui d’Oklahoma City de 1995 et de celui du gaz sarin dans le métro de Tokyo la même année[19]. Il s’agit selon la définition initiale de l’administration américaine de procéder à la sécurisation «des systèmes et les biens, physiques ou virtuels, qui sont si vitaux… que l’incapacité ou la destruction de tels systèmes ou biens aurait un effet débilitant sur la sécurité économique nationale, la santé publique nationale ou la sûreté, ou toute combinaison de ces questions». En 1997, le Président Clinton constitue une Commission Présidentielle sur la protection des infrastructures critiques dotée d’un budget conséquent. Après les événements tragiques du 11 septembre 2001, la protection des infrastructures critiques devient une priorité nationale avec la création du National Infrastructure Advisory Council (CNAC) composé de vingt-quatre membres issus d’un partenariat entre acteurs privés, experts et administration fédérale[20]. La liste des infrastructures à protéger est progressivement étendue aux « monuments historiques et culturels, symboliques de la nation » ainsi qu’à des sites industriels et des stades sportifs. En 2003, les États-Unis se dotent du Critical infrastructure Warning Information Network (CWIN) pour échanger toutes informations sur les menaces, faiblesses et dispositifs constitués dans le domaine. Dès 2004, la Commission européenne s’engage explicitement dans une réflexion sur la Protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le 24 novembre 2005 paraît le Livre vert sur les infrastructures critiques qui aboutit à la fois à la mise en place d’un programme européen de protection des infrastructures critiques (PEPIC) pour la période 2007-2013 et la mise en place d’un réseau d’alerte pour la protection des infrastructures critiques (CIWIN) en tout point comparable à son homologue américain. Il s’agit en effet d’accélérer la définition de mesures de protection appropriées en favorisant l’échange sécurisé des meilleures pratiques et en servant de moyen de transmission des alertes immédiates et des informations entre tous les systèmes d’alerte rapide de la Commission. Les État-membres s’emploient à leur tour à définir et qualifier leurs infrastructures critiques. Pour la France, l’enjeu sécuritaire est celui d’un « établissement, ouvrage ou installation dont le dommage ou l’indisponibilité ou la destruction par suite d’un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait directement ou indirectement : d’obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ; ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population ». Comme le soulignent les rapporteurs du Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme paru en 2006, il s’agit, en conformité avec le code de la Défense, de mettre « à la charge des opérateurs publics ou privés d’infrastructures vitales les mesures de protection interne contre toute menace, notamment à caractère terroriste »[21].
L’infrastructure critique incorpore désormais tout aussi bien un équipement et dispositif matériel structurant la vie de la nation et des villes comme les gares, les aéroports, les administrations, les centrales de production énergétique, les stations d’eau et d’épuration, les usines, plates-formes d’échanges et de distribution, centres de recherche, hôpitaux, casernes militaires… que des réseaux matériels et immatériels garantissant les échanges et distributions fonctionnelles propres à la vie collective : réseaux d’eau, d’assainissement, de distribution énergétique, autoroutes, routes de l’information, circulations terrestres, maritimes et aéroportées, transport des produits dangereux et toxiques, systèmes de communication…
Pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation, fut créée en 2009 l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) dans le but de construire une cyber-sécurité de leurs dispositifs informatiques. La sécurisation d’une infrastructure critique revêt donc clairement deux dimensions complémentaires, une gestion informatique adaptée aux plus de deux cents entreprises définies comme Organisme d’importance vitale (OVI) et pour lesquelles il s’agit de redoubler de vigilance sur le plan de la protection des systèmes d’information et d’autre part la mise en place d’une sécurité physique des bâtiments qui interdise l’accès à toute personne étrangère à son activité. Dans ce cas, les dispositifs de sécurité sont classiques puisqu’ils se composent à la fois de barrières ceinturant leurs périmètres, de systèmes de détection des intrusions, de caméras panoramiques à infrarouge permettant de détecter tout mouvement humain dans une perception panoramique de 360°. Aux dispositifs matériels traditionnels se surajoutent désormais de nouveaux dispositifs de la profondeur à même de prendre en considération les logiques spécifiques des réseaux que sont leur échelle, leur maillage et l’étendue de leur déploiement. De telle sorte que la sécurité puisse recouvrir différents points du réseau et plusieurs embranchements ou connexions jugées stratégiques tout en recherchant à limiter les interdépendances fonctionnelles entre infrastructures afin de limiter les dynamiques aléatoires de crises. Du point de vue sécuritaire, le démêlage des réseaux devient une priorité de gestion[22].
La gestion sécuritaire des grandes infrastructures critiques répond à la nécessité de conserver aux territoires et notamment à la ville leur efficience opérationnelle dans tous les domaines de la vie quotidienne. Elle ne préjuge en rien du second mouvement de sécurisation des villes qui situe la mobilité et la fluidité du côté de la menace et du risque. Ce mouvement complémentaire prend racine du point de vue conceptuel dans la fonction première des villes en matière de sédentarisation et fixation des individus dans l’espace et de lutte contre le barbare entendu comme menace exogène venue d’ailleurs. Sous le poids d’un monde économique ouvert et de la récession économique, l’Europe s’est progressivement engagée dans une politique de fermeture de ses frontières et de lutte contre l’immigration clandestine préalablement forgée par ses propres États membres. La convention d’application des accords de Schengen de 1990 qui organise l’ouverture des frontières entre les pays européens signataires apparaît a posteriori avoir participé de la constitution du « véritable mur virtuel de Schengen » qui propose le contrôle des flux migratoires à partir de la délivrance d’un visa d’entrée dans l’espace européen[23]. Le traité de Maastricht de 1992 constitue le point d’orgue de cette nouvelle politique. Il institue les conditions d’entrée, de circulation et de séjour sur le sol européen, proclame la nécessité de lutter contre l’immigration, le séjour et le travail irrégulier des pays tiers sur son territoire. À la libre circulation de ses propres résidents à l’intérieur de ses frontières, s’oppose désormais le strict contrôle des ressortissants hors Europe en accord avec les besoins économiques et démographiques d’une politique d’émigration partagée. D’autorité, la France et les autres nations partenaires réactualisent leurs dispositifs existants de lutte contre l’immigration clandestine reposant sur le renvoi des étrangers en situation irrégulière. Le principe de la rétention administrative de tout étranger qui, à l’issue d’un arrêté d’expulsion, d’une décision de reconduite à la frontière, ou d’une peine d’interdiction du territoire « ne peut quitter immédiatement le territoire français », « peut être maintenu, s’il y a nécessité, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ » existait déjà au titre de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il fut confirmé par la loi du 10 janvier 1980, dite Loi Bonnet, qui autorise le maintien dans un établissement pénitentiaire de l’étranger en attente d’expulsion pour une durée pouvant aller jusqu’à sept jours. Par décision du Premier ministre du 5 avril 1984 sont créés les centres et locaux de rétention administrative (CRA et LRA), placés sous la responsabilité de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale[24]. La loi du 17 juillet 1984 renforce le contrôle aux frontières pour lutter contre l’immigration clandestine et maintient le placement des étrangers à expulser en CRA et LRA. Sous la présidence de François Mitterrand, les CRA passent de 1 en 1981 à 6 en 1995 ; sous Jacques Chirac de 7 en 1996 à 16 en 2007 ; sous Nicolas Sarkozy de 17 en 2007 à 21 en 2012. Ils sont aujourd’hui 26.
Les CRA ont été implantés selon les opportunités foncières sur des terrains à l’écart ou aux marges des agglomérations. L’installation du CRA de Lyon sur l’aéroport Saint-Exupéry, les trois du Mesnil-Amelot près de l’aéroport de Roissy et celui de Lesquin à proximité de l’aéroport de Lille permettent de garantir la discrétion recherchée tout en facilitant l’optimisation de leur fonctionnement. La soustraction à la vue directe du citoyen est obtenue dans le cas des trois CRA de Paris localisés dans le bois de Vincennes. Le CRA du Canet – le 25e du nom – fut implanté au début des années 2000 dans la ville de Marseille dans un territoire enclavé entre d’une part l’autoroute du Soleil (A7) et sa bretelle (A557) en direction du Port Maritime, et d’autre part par le boulevard Danièle Casanova que jouxtent les aires de stockage et les voies de triage de la gare du Canet. Par l’appel d’offre du concours organisé par le maître d’ouvrage, le ministère de l’Intérieur, les lauréats ont souscrit aux principes mêmes d’une architecture furtive du camouflage offrant les conditions d’effacement de la fonction coercitive du bâtiment dans son environnement. Et les concepteurs du Canet d’affirmer : « Le but est de ne rien montrer, de ne rien démontrer puisqu’il n’y a rien à voir, rien de visible y compris depuis l’autoroute dont nous avons affranchi les vues en créant une rangée de cyprès en complément de la barrière végétale existante »[25]. L’enfouissement et/ou la disparition visuelle des bâtiments relève du souci pour les acteurs d’effacer ce qui, pourrait conduire, par une prise de conscience citoyenne, à la protestation voire aux violences et dégradations ou encore à des modalités d’obstruction de la rétention administrative et de l’expulsion hors de France et d’Europe[26].
Même si les autorités administratives affirment que les CRA ne sauraient être assimilés à la prison, ils assument comme les premiers la fonction de priver les retenus de la liberté de circuler et de se déplacer librement. À défaut de pouvoir supprimer les signes et symboles de leur fonction coercitive, ces équipements de la rétention provisoire, à l’image de la prison, existant dans la clôture d’un espace contrôlé, surveillé et gardé par l’élévation d’un mur et d’un portail. Dans son rapport pour avis sur les crédits de la police prévus au titre du projet de loi de finance 2001, le député Louis Mermaz s’était ému des conditions dégradées d’existence au sein des CRA qu’il qualifia de « geôles indignes », d’« horreur de notre République tant la visite des centres de rétention brouille les repères de la citoyenneté et donne le sentiment de pénétrer dans un autre pays, à une autre époque, loin de la France de l’an 2000 »[27].
Depuis quelques années, les pays occidentaux sont désormais confrontés à de nouvelles formes de violence que définit aux États-Unis le concept de homegrown terrorism décliné au Royaume-Uni en domestic terrorism, au Canada en « terrorisme domestique » et en France en « terrorisme de l’intérieur». La diversité des mots témoigne de l’universalité du processus : soit un passage à l’acte d’individus non étrangers plus ou moins isolés et démunis en termes d’organisation et de logistique des opérations. La constitution progressive du concept de homegrown jihadism décliné par la suite en « terrorisme jihadiste » définit l’émergence d’une violence spécifique dans le cadre précis de revendications religieuses d’inspiration islamistes par opposition à un terrorisme laïc – qu’il soit le fait de groupuscules d’extrême gauche ou d’extrême droite. La fondation de l’État islamique, la guerre en Syrie ont pleinement participé à l’internationalisation du conflit attirant des jeunes européens dans les groupes armés islamistes potentiellement pourvoyeurs de violence radicale en retour dans leur pays de naissance. Les attentats de Madrid en 2004, de Londres de 2005, de Paris en 2015, de Bruxelles en 2016 ont pleinement fait prendre conscience de la mutation des villes en cibles stratégiques. Pour le seul cas de la France, il faut en effet faire mention des attentats de Toulouse et Montauban en 2012, ceux de Dijon et Nantes en 2014, ceux de Paris et Vincennes en 2015, Valence, Saint-Etienne du Rouvray et Nice en 2016, Paris et Marseille en 2017. Deux dimensions doivent être ici soulignées. La recrudescence de la violence s’effectue prioritairement dans le domaine de l’espace public urbain en ce qu’il offre les conditions de maximaliser les dommages physiques et permet de publiciser, avec le traitement des médias, la nature de la cause politique et idéologique. De nouveaux modes opératoires se déploient notamment à partir du détournement de camions en armes de destructions et d’usage de voitures béliers. Si, comme le souligna en son temps le ministre de l’Intérieur Manuel Valls, « ces individus, véritables ennemis de l'intérieur, représentent une menace diffuse qui demande donc un travail de surveillance lourd et méticuleux »[28], elle s’est progressivement accompagnée de la mise en place de mesures préventives de sécurisation de l’espace public au titre desquelles figure bien évidemment la protection des bâtiments stratégiques et symboliques. C’est dans ce cadre précis que se construit aujourd’hui le mur de protection de la Tour Eiffel qui sera constitué d’une paroi de verre anti-balle de trois mètres de hauteur.
La vidéo-surveillance préventive qui existait par ailleurs à l’entrée des immeubles de grande hauteur, immeubles de bureau et équipements de grandes affluences, a été aussi ainsi généralisée dans les espaces publics. Aux anneaux d’acier – Ring of Steel – que représente le déploiement dans les centres villes de plusieurs centaines, voire milliers de caméras – le seul arrondissement de Lower Manhattan en dispose de plus de 3000 – se surajoute la nécessité pour les villes importantes d’œuvrer à la protection physique des axes urbains de déplacement. Le modèle de référence est le premier Ring of Steel constitué par les autorités londoniennes pour se prémunir contre les attentats causés par l’IRA en 1992 et 1993 au cœur de la City. Le réseau de vidéo-surveillance est couplé avec un dispositif de sécurité physique comprenant des barrières, des chicanes suréquipées de herses métalliques, des zones de parkings extérieurs et des zones libres dégagées. L’établissement de checkpoints tout autour du périmètre ainsi sécurisé garantit le contrôle de tout individu ou véhicule en direction du centre-ville ou souhaitant le quitter. Ce dispositif, pour avoir été particulièrement éprouvé au fil du temps dans divers contextes politiques, répond particulièrement bien aux enjeux sécuritaires du homegrown jihadism. Comme par le passé, il s’agit de limiter et filtrer les passages des individus dans des espaces publics à haute fréquentation et d’en limiter les usages pour les véhicules au titre seulement de l’approvisionnement en biens et services. Le contrôle des accès aux voitures et aux camions comme celui des piétons offre les moyens de décélérer les vitesses au cœur de la technique surprise de l’attaque de la voiture et du camion béliers. Les murs sécuritaires de la lutte anti-terroriste peuvent également être complétés ou être substitués par le dépôt de blocs de béton venant limiter circulations et accès aux bâtiments et immeubles stratégiques.
Conclusion
Les murs de la ville post-fordienne, tels qu’ils s’érigent aujourd’hui se substituent, tant du point de vue de la fonction que de la forme, aux murs de la ville fortifiée. Ils dépassent également les murs de « la ville disciplinaire » analysée par les acquis foucaldiens sur l’invention du système carcéral et de l’enfermement des corps pour réprimer toute forme de déviance sociale et individuelle. Depuis les murs protecteurs de la ville du Moyen Âge, ceux de la ville moderne et les dispositifs de contrôle et d’enfermement de la ville industrielle, les enjeux sécuritaires de la gestion urbaine ont aujourd’hui fortement évolué. La ville post-fordienne existe comme support d’activités tertiaires et de services et oppose à la sédentarité comme référence, le déploiement de la mobilité comme condition de développement de sa puissance économique, politique et sociale.
Le mur ne saurait plus réellement exister comme une barrière verticale protectrice signifiant par sa pesanteur, sa masse et sa verticalité, l’impossibilité de son franchissement. Il est aujourd’hui un espace de médiation entre l’intérieur et l’extérieur selon des hiérarchies du visible ou de l’invisible directement commandées par les propres objectifs stratégiques qui lui sont assignés. A l’inverse de la verticalité des murs passés ou des murs présents construits pour limiter la fuite des populations pauvres d’un État-nation vers un autre, il s’inscrit plus durablement dans une profondeur spatiale qui lui permet de réguler efficacement populations, groupes sociaux, individus et activités selon des séquences et temporalités spécifiques. Si le mur assure protection et sécurité, il le doit tant aux modalités de sa clôture qu’aux possibilités qu’il offre comme territoire de régulation permanente pour permettre aux mobilités de conserver toutes leurs efficiences productives. La qualité du mur en ville ne repose plus dans l’obstruction définitive et absolue des circulations. Elle réside dans la garantie de la porosité nécessaire aux échanges humains et productifs. Aussi la question du management des porosités devient centrale dans l’économie de la sécurité globale de la ville post-fordienne même si au demeurant il peut subsister et se déployer ici et là des lieux possédant des murs physiques conservant la mission initiale de non-franchissement d’espace. Tel est le cas des prisons, mais aussi des CRA – pour lesquels le nouveau Président de la République Emmanuel Macron entend allonger la durée légale de rétention – et dans une moindre mesure des espaces stratégiques relevant de la gestion des infrastructures critiques.
Du point de vue sécuritaire, la ville post-fordienne apparaît donc être constituée d’espaces juxtaposés aux mobilités différenciées selon leur valeur et leur importance stratégique. Ils définissent des hiérarchisations et des impossibilités de déplacement physique qui ne sont pas sans rappeler les topographies des villes en guerre pour lesquelles les cheminements des habitants sont étudiés et adaptés à la fois selon la nature des contraintes, clôtures et fermetures des accès et aussi selon les dangers potentiels et les lignes de front militaire constituées. À la différence toutefois de ces dernières, la construction de murailles invisibles que ne peut repérer l’œil non aguerri du simple quidam, rend plus difficile la perception de tous les dispositifs de contrainte surgis dans l’espace. En terme de cheminements, la ville post-fordienne se présente dans le domaine sécuritaire comme un territoire urbain discontinu et fragmenté obligeant chaque usager à faire preuve d’intelligence et de pragmatisme dans ses déplacements et ses évitements de lieux. Comment conserver l’espace public ouvert à tous pour poursuivre l’aventure de la démocratie et de la citoyenneté tout en assurant les conditions de la sécurité de ses usagers ? Il s’agit là du défi majeur que les acteurs publics urbains se doivent aujourd’hui de relever.
Bibliographie
AVENEL C., « La construction du problème des banlieues entre ségrégation et stigmatisation », Journal francais de Psychiatrie, 2009, n° 34, pp. 36-44, [en ligne].
BADIE B., Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999.
BAUDOUÏ R., « De la menace atomique aux conflits de faible intensité. L’emprise croissante de la guerre sur la ville », Les Annales de la Recherche urbaine, 2001, n°91, pp. 28-34.
BAUDOUÏ R., et ESPOSITO F., « La lutte anti-terroriste contre les réseaux urbains. Vers un nouveau modèle d’urbanité», Urbanités, 2015, n° 6, s.p., [en ligne].
BAUDOUÏ R., et KABOUCHE M., « Les centres de rétention administative : la programmation ordinaire de l’indignité », Urbanités, 2017, vol. 8, s.p., [en ligne].
BESSON R., « Capitalisme cognitif et modèles urbains en mutation. L’hypothèse des systèmes urbains cognitifs», Territoire en mouvement, n° 23-24, 2104, pp. 1-2, [en ligne].
DELEUZE G., Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Éditions Minuit, 1988.
DI CINTIO M., Un monde enclavé, voyage à l’ombre des murs, Québec, Lux, 2017.
DREYFUS J., La ville disciplinaire : Essai sur l’urbanisme, Paris, Galilée, 1976.
DUBUISSON M., « Barbares et barbarie dans le monde gréco-romain, L’Antiquité classique, année 2001, n° 70, pp. 1-16.
DUFOUR J-L., La guerre, la ville et le soldat, Paris, Éditions Odile Jacob, 2002.
FOUCAULT M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
GALLAND J-P., « Critique de la notion d’infrastructure critique», Flux, 2013, n°81, pp. 6-18.
La France face au terrorisme, Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, Paris, La Documentation française, 2006.
GLUCKSMANN A., « Le totalitarisme en effet», Traverses, 1977, n°9, pp. 34-39.
LAVEDAN P., Histoire de l’urbanisme, Paris, H. Laurens, tome 1 Antiquité et Moyen Âge, 1926 ; tome 2 Renaissance et temps modernes, 1941 ; tome 3 Époque contemporaine, 1952.
LHOMME S., Les réseaux techniques comme vecteur de propagation des risques en milieu urbain – Une contribution théorique et pratique à l’analyse de la résilience urbaine. Thèse de doctorat en géographie, Université Paris-Diderot, [en ligne].
LOUBRET, « Un nouveau camp pour étrangers à Marseille », 2006, CQFD Journal, n°35, s.p., [en ligne].
MERMAZ L., « Intérieur et décentralisation. Police » Avis présenté au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2001, Assemblée Nationale n° 2628, s. p., [en ligne].
MICHEL-KERJAN E., « Aux États-Unis, la menace terroriste reste dans tous les esprits », Le Monde, 13 juin 2003.
MURARD L. et ZYLBERMAN P., Le petit travailleur infatigable. Villes-usines, habitat et intimités au XIXe siècle, Paris, 1976.
NEISSE F., et NOVOSSELOFF A., « L’expansion des murs : Le reflet d’un monde fragmenté ? », Politique étrangère, 2010, n° 4, pp. 731-742, [en ligne].
PIRENNE H., Les villes du moyen âge, essai d’histoire économique et sociale, Bruxelles, Maurice Lamertin, 1927.
RUFFIN J-C., L’Empire et les nouveaux barbares, Paris, Lattès, 1991.
STIGLIZ B., « Le prix du 11 septembre », Project Syndicate, [en ligne].
VALLET E., et DAVID C-P., « Du retour des murs frontaliers dans les relations internationales», Études internationales, vol. 43, numéro 1, mars 2012, pp. 5-25, [en ligne].
VALLS M., Discours devant la commission des lois – Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, 14 novembre 2012, s.p., [en ligne].
[1] PIRENNE H., Les villes du moyen âge, essai d’histoire économique et sociale, Bruxelles, Maurice Lamertin, 1927, 203 p.
[2] LAVEDAN P., Histoire de l’urbanisme, Paris, H. Laurens, tome 1 Antiquité et Moyen Âge, 1926, 520 p. ; tome 2 Renaissance et temps modernes, 1941, 504 p. ; tome 3 Époque contemporaine, 1952, 446 p.
[3] FOUCAULT M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 352 p.
[4] DREYFUS J., La ville disciplinaire : Essai sur l’urbanisme, Paris, Galilée, 1976, 215 p.
[5] MURARD L. et ZYLBERMAN P., Le petit travailleur infatigable. Villes-usines, habitat et intimités au XIXe siècle, Paris, 1976, 300 p.
[6] VALLET E., et DAVID C-P., « Du retour des murs frontaliers dans les relations internationales», Études internationales, vol. 43, numéro 1, mars 2012, pp. 5-23.URL : id.erudit.org/iderudit/1009137ar.
[7] DI CINTIO M., Un monde enclavé, voyage à l’ombre des murs, Québec, Lux, 2017, 433 p.
[8] DELEUZE G., Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit, 1988,192 p.
[9] DUFOUR J-L., La guerre, la ville et le soldat, Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, p. 278.
[10] DUBUISSON M., « Barbares et barbarie dans le monde gréco-romain», L’Antiquité classique, année 2001, n° 70, pp. 1-16.
[11] GLUCKSMANN A., « Le totalitarisme en effet», Traverses, 1977, n°9, p. 34.
[12] BAUDOUï R., « De la menace atomique aux conflits de faible intensité. L’emprise croissante de la guerre sur la ville » , Les Annales de la Recherche urbaine, 2001, n° 91, pp. 28-34.
[13] BADIE B., Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, 306 p.
[14] RUFFIN J-C., L’Empire et les nouveaux barbares, Paris, Lattès,1991, 247 p.
[15] STIGLIZ B., « Le prix du 11 septembre », Project Syndicate, May 10, 2105, s.p.
[16] BESSON R., « Capitalisme cognitif et modèles urbains en mutation. L’hypothèse des systèmes urbains cognitifs», Territoire en mouvement, n° 23-24, 2104, pp. 1-2, [en ligne].
[17] LHOMME S., Les réseaux techniques comme vecteur de propagation des risques en milieu urbain – Une contribution théorique et pratique à l’analyse de la résilience urbaine. Thèse de doctorat en géographie, Université Paris-Diderot, 365 p., [en ligne].
[18] AVENEL C., « La construction du problème des banlieues entre ségrégation et stigmatisation », Journal francais de Psychiatrie, 2009, n° 34, p. 40, [en ligne].
[19] GALLAND J-P., « Critique de la notion d’infrastructure critique», Flux, 2013, n°81, p. 6.
[20] MICHEL-KERJAN E., « Aux États-Unis, la menace terroriste reste dans tous les esprits », Le Monde, 13 juin 2003.
[21] La France face au terrorisme, Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, Paris, La Documentation française, 2006, p. 76.
[22] BAUDOUÏ R., et ESPOSITO F., « Les réseaux urbains contre la ville. Vers un nouveau modèle d’urbanisme de la sécurité » Urbanités, n° 6, [en ligne].
[23] NEISSE F., et NOVOSSELOFF A., « L’expansion des murs : Le reflet d’un monde fragmenté ? », Politique étrangère, 2010, n° 4, p. 736, [en ligne].
[24] BAUDOUÏ R., et KABOUCHE M., « Les centres de rétention administative : la programmation ordinaire de l’indignité », Urbanités, 2017, vol. 8, s.p., [en ligne].
[25] LOUBRET, « Un nouveau camp pour étrangers à Marseille », 2006. CQFD Journal, n°35, s.p., [en ligne].
[26] Les incidents avec les passagers de vols civils de compagnies aériennes, à l’occasion du transfert des retenus sur des vols civils des compagnies aériennes témoignent du risque que fait peser sur leur déroulement, leur publicisation.
[27] MERMAZ L., « Intérieur et décentralisation. Police » Avis présenté au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2001, Assemblée Nationale n° 2628, s. p., [en ligne].
[28] VALLS M., Discours devant la commission des lois – Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, 14 novembre 2012.