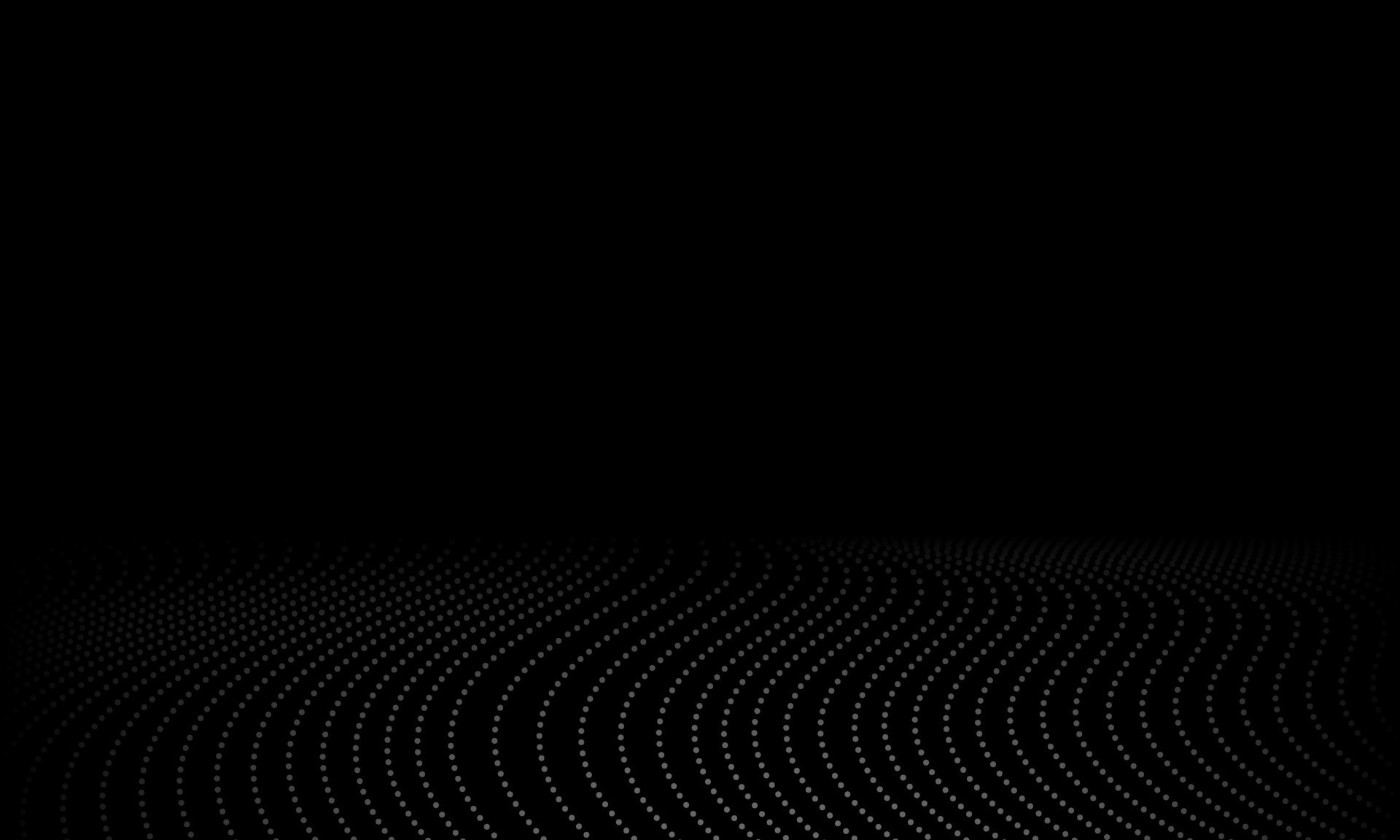VARIA
Par Sébastien Joffres, Doctorant en sociologie, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Dans l’histoire de la sociologie, les liens de notre science avec le politique ont été régulièrement questionnés. Après les pères fondateurs posant un interdit quant à l’action politique du sociologue, plusieurs ont réengagé cette réflexion pour en proposer diverses traductions. Nous pensons – pour ne citer qu’eux – à Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Bruno Latour, Michael Burawoy... Pour la discipline, cette question est bien fondamentale. Les réponses que nous lui apportons viennent dire selon quelles conditions le sociologue entend produire des discours et quelle(s) validité(s) nous pouvons leurs accorder. Elles définissent aussi la place du chercheur dans l’ordre du monde et sa construction.
Avec un peu d’imagination, nous pouvons dire que si Weber a laissé derrière lui Le savant et le politique, alors Pascal Nicolas-Le Strat lèguera Le savant fait politique[1]. Il travaille aussi ce chantier[2] en y développant une version originale et radicale de la réponse à la question épistémologique qui devient sous sa plume « épistémopolitique »[3]. Dans le cadre du projet politique des communs – qui se pose comme voie alternative à l’État et au capitalisme – il propose que le chercheur et avec lui les sciences sociales, soit pleinement partie prenante de la construction de cette nouvelle voie. Ce n’est plus en tant qu’expert ou bien qu’intellectuel avant-gardiste qu’il participe à la construction d’un futur désirable. Il ne pose pas un discours à distance, décrétant ce qui devrait être. C’est en tant qu’acteur, apportant les outils de la recherche, selon une certaine éthique ou épistémopolitique, qu’il contribue au même titre que les autres, à fonder les communs dans le cadre d’expérimentations de modes de vie, de collaboration, de travail, d’intervention... Le chercheur n’est donc plus missionné ou bien intéressé à distance. Il participe en tant que citoyen concerné. Nicolas-Le Strat propose donc d’inscrire les sciences sociales au cœur d’un projet de société.
Construire les communs
Nous communons[4]
« Le commun, en tant que principe politique, laisse espérer une réappropriation collective des questions qui nous concernent en commun ; en tant que forme de gouvernement, il garantit que les biens et services d’intérêt collectif seront bel et bien administrés en commun, sur une base démocratique »[5].
Le projet du commun vient s’opposer à deux ennemis. D’une part, le capitalisme avec son marché produit des inégalités, soumet les gens à ses objectifs de rentabilité, détruit les liens entre individus... D’autre part, l’État contrôle, rigidifie, gouverne... Dans ces deux logiques, la vie est gérée ailleurs que là où elle se déroule et par d’autres que ceux qui la vivent. Chacun est dépossédé de ce qui le concerne au profit de l’intérêt public défini par l’État et/ou du marché. En réponse, le terme « commun » porte cette revendication que l’ensemble des éléments naturels (l’eau, le gaz, la terre...) et artificiels (le langage, les espaces de vie, l’organisation du travail...) qui nous concernent soient notre propriété commune et soient gérés selon la voie d’une démocratie radicale. Ces éléments doivent être utilisés, entretenus, gouvernés et travaillés en commun sans qu’une instance supérieure à l’individu et aux communautés concrètes qu’il institue avec les autres, prétende les gérer. C’est un gouvernement par le bas, où les seuls entités de gestion et de décision peuvent être celles qui sont pensées, décidées, construites et animées par celles et ceux qui prennent part.
Cette démocratie doit être participative en ce que chacun puisse s’exprimer à partir de son expérience de vie et contributive[6] en ce que chacun puisse proposer à partir de ce qu’il expérimente. Il s’agit donc à la fois de discuter sur ces communs, mais aussi d’essayer, de contribuer, d’inventer, de se tromper... C’est une démocratie du commun en ce que son principe général est de gérer en commun et une démocratie « des communs » en ce que cette logique se joue partout où les individus sont en mesure de la mettre en place[7]. L’horizon qu’offre l’auteur est celui d’une globalité pensée selon le commun et qui soit constituée d’une multitude de lieux, de projets effectivement pensés et agis selon cette logique. Le commun est à la fois principe global et local. Nicolas-Le Strat présente ce projet comme désirable et absolument nécessaire pour notre époque. Il le qualifie de « déboîtement radical »[8], de « décalage »[9]. Il ne s’agit pas d’appeler une troisième voix qui servirait de béquilles aux deux autres, mais de proposer un voie alternative qui remplacerait les précédentes. Le commun est donc un horizon : il se conjugue au futur.
Nous communons
Une fois que nous avons dit cela, nous n'avons rien dit du propos central de l’auteur. Si le commun peut être vu comme futur utopique, celui dont il parle principalement et qu’il étudie se conjugue au présent. Il ne s’agit pas de constater un passé ou de regarder vers un avenir désirable, l’encenser et prouver sa supériorité. Il est question d’étudier comment se constituent les communs maintenant. C’est cette activité, de manière située, dans des projets de vie en communauté, des créations artistiques, la gestion de squats, des interventions sociales, etc. que l’auteur étudie sous le terme de « travail du commun ». Il n’est pas question d’analyser comment les gens agissent ensemble (travail en commun), mais comment est-ce qu’ils créent les conditions, les règles et les dispositifs pour agir en commun.
Un constructivisme radical
« [...] dans quels processus sommes-nous entraînés, voire emportés ? Dans nulle autre perspective que celle déterminée par nos coopérations et collaborations »[10].
Le projet politique que défend l’auteur n’est en rien basé sur une vision ontologique de l’humanité ou naturalisée du monde. Le commun n’est pas l’essence de la vie en société ou bien des ressources naturelles. C’est un construit. C’est un choix. L’auteur s’inscrit donc dans une perspective politique radicalement constructiviste. Ce qui est mis au centre c’est d’une part le choix des modalités de l’être ensemble et d’autre part leur réalisation concrète. Le projet des communs se justifie sur la base des critiques localisées que portent des individus concrets se retrouvant à l’encontre de l’État et du capitalisme. Il vient à l’existence à travers ce que les gens mettent en place pour le vivre. Le commun n’existe que parce que nous le construisons et non parce qu’il s’impose comme principe transcendant.
Le commun est au présent politique : il ne s’agit pas de l’attendre pour demain, mais de le construire aujourd’hui, au « rez-de-chaussée de nos activités »[11], c’est-à-dire dans les projets collectifs que nous pouvons porter, dans nos institutions de travail, dans nos relations quotidiennes. Le commun est aussi au présent sociologique : il s’agit de tracer sa constitution dans l’activité des militants. Le monde est abordé à travers les processus qui lui donnent consistance et l’activité des acteurs qui lui permet d’exister. L’auteur passe peu de temps en Histoire et consacre aussi peu de temps à définir l’horizon utopique. L’essentiel de son effort est de décrire les micro-politiques du commun. Nous retrouvons ici la filiation Félix Guattari. Le projet politique global n’est qu’en arrière-plan. Ce qui compte principalement, c’est la multiplication d’initiatives qui localement tentent de construire autre chose de manière à faire bouger les lignes de forces. C’est dans la démultiplication de ces expériences moléculaires que peut se trouver la force d’un changement à un plus grand niveau.
Ces caractéristiques constituent une dimension extrêmement importante et stimulante du travail de Nicolas-Le Strat tant sur le plan sociologique que politique. Il y a dans son approche quelque chose d’original. Il consacre par exemple un chapitre du Travail du commun à la capacitation[12]. Il permet de mesurer le décalage avec d’autres approches. Il y critique certaines définitions de l’empowerment, très en vogues dans les politiques publiques et le travail social, qui décrivent le pouvoir d’agir comme quelque chose d’ontologique. Du fait de ce caractère, la capacitation est repoussée à demain car doit se faire au préalable tout un travail de révélation du pouvoir d’agir. Les intervenants sociaux doivent accompagner les usagers à trouver en eux ce pouvoir avant d’en faire usage. Or, l’auteur, plaçant la capacitation du côté d’une construction, il la conjugue au présent. L’enjeu n’est pas de la trouver en nous, mais de travailler au commun. Par ce travail, elle s’exprime dès maintenant et en même temps nourrit ses conditions d’existence. Elle n’est pas limitée par ce qu’ontologiquement nous avons comme capacité, mais par le projet que nous portons et ce que nous mettons en place. Nous sommes presque tentés de dire que ce choix d’un constructivisme radical est émancipateur en ce qu’il libère d’une nature présupposée de l’être humain. Le regard est alors porté sur le dispositif, sur l’environnement et non sur la nature et la valeur fantasmée de l’individu. Sur le plan sociologique, cette approche rabat sur la question du « comment ? » et permet de ne pas réifier le commun ou l’être humain capable. Comment peuvent-ils exister ? Comment se construisent-ils ? Par quels outillages leurs donne-t-on corps ? Et ces questions permettent d’étudier la réalité en profondeur. Bien plus que d’autres qui réifieraient le commun, le rendant ainsi opaque.
Ce type de sociologie est une sociologie de l’activité car elle se centre sur ce qui est fait, sur les processus animant et construisant une réalité ainsi qu’une sociologie des dispositifs en ce qu’elle porte son regard sur des assemblages de personnes, d’outils, de discours... Le commun de Nicolas-Le Strat n’est pas un lieu de débat entre individus discursifs ou bien un trésor de l’humanité. Il est une création qui ne pourra exister que parce qu’auront été mis en place certains agencement de personnes, d’objets, de temps, d’espaces, d’outils d’expression, et parce que ses participants y travaillent.
Le commun est-il une utopie ?
Si le projet d’une démocratie du commun reste en ligne d’horizon, c’est le commun au présent et tel qu’il se fait au réel qui occupe l’auteur. Son dernier livre est très utopique par certains aspects car chargé d’un désir de changements radicaux. Mais ce qui l’intéresse encore plus fort est la construction concrète des communs, réalisations fragiles, partielles, mobiles, en évolution. Il donne à voir des communs en tension entre réalisation et projection. Ces communs-là n’ont rien d’imaginaires et n’habitent pas des lieux fantasmatiques. Ils sont en tous lieux où nous arrivons à les construire et ils sont au présent bien que tendus vers le futur. Ses communs n’ont rien de méthodiques, il n’en pose pas une définition claire, univoque, pure et parfaite. Ce qu’il étudie est ce qui s’inscrit, de manière large, dans les dynamiques qui se retrouvent sous ce label. En bref, son travail du commun, bien que motivé par un futur idéal, est plein de réel. Nous pouvons alors nous demander si le commun est une utopie ? Le but de la question n’est évidemment que rhétorique. Son seul intérêt est de pointer vers l’analyse de l’auteur en tension entre réel et désir au présent et société transformée au futur.
Les sciences sociales commuent
La recherche-expérimentation
« Ma préoccupation […] n’est pas principalement l’engagement individuel du sociologue dans l’action, mais bien l’engagement collectif d’un métier et d’une pratique, à savoir une recherche en science sociale en tant que dispositif de coopération pour agir et penser. Comment la recherche en science sociale s’engage-t-elle dans l’action et prend-elle sa part, et toute sa part, aux enjeux politiques du moment »[13].
Lorsque l’auteur écrit sur le travail du commun, il ne le fait pas en tant que chercheur-observateur des projets étudiés, mais en tant que « citoyen-chercheur-impliqué ». En parallèle et en antériorité de son travail sur le commun, il a développé tout un propos sur la manière dont la sociologie, et par extension les sciences sociales, peuvent et doivent participer de la construction d’alternatives. Sa pratique de la recherche s’est inscrite notamment dans le cadre de ce qu’il appelle « expérimentations » à la suite de Jean Dubost et André Lévy, c’est-à-dire :
« des actions ou des expériences concrètes, qui se veulent innovantes, prospectives (communautés, groupes autogérés...) et qui constituent en elles-mêmes une forme de recherche, une recherche en acte […]. Elles constituent des recherches non seulement parce qu’elles mettent à l’épreuve des idées ou des utopies, mais aussi parce qu’elles s’accompagnent d’une réflexion et d’une analyse, menées au fur et à mesure par leurs auteurs ou promoteurs (carnets de notes, échanges plus ou moins organisés, comptes rendus écrits...) pour mieux comprendre les conditions et les limites de leurs expériences et éventuellement pour les faire connaître »[14].
Le chercheur prend part au projet de constitution d’un commun. Il le fait en tant que personne concernée, avec son expérience et, entre autres mais pas que, avec ses outils et pratiques de chercheur. L’intérêt est que la recherche puisse s’intégrer comme activité ayant place dans l’écosystème de l’expérimentation et qu’elle soit un outil de connaissance et de transformation.
Pour comprendre cette nécessité, il est important de saisir ce que fait la recherche. Elle est créative[15]. En général, le chercheur espère contrôler les biais qu’il introduirait en situation. Notre hypothèse est que les sciences sociales, malgré toutes leurs réflexions épistémologiques pour qualifier au plus près ce qu’elles font – au sens d’activité et de produit de cette activité – gardent cette impression que faire du terrain revient à plonger dans la vie réelle. Cela est comme réaliser un prélèvement de tissu pour le mettre sous le microscope en ayant une impression de contact direct avec le réel. Seulement, cette sensation oublie tout l’artifice de la situation : un microscope nécessite des produits colorants, des révélateurs, des polarisateurs, etc. afin de voir le réel. Il est un metteur en scène, il n’ouvre pas un accès direct au monde. Nicolas-Le Strat, en ce qui concerne cette illusion naturaliste des sciences sociales, ne fait que déplier entièrement les postulats de base : la présence du chercheur compte. Le chercheur perturbe et cette perturbation est sa force. Il est un créateur d’agencements qui permettent à la réalité de venir s’actualiser tout comme le microscope permet à des tissus d’être visibles pour l’homme. Elle vient se mettre en scène dans le cadre qu’offre le dispositif de recherche. Et cette actualisation est à penser par le collectif et le chercheur en fonction de ce qu’ils espèrent percevoir de leur expérimentation. Cette actualisation n’est pas simplement à penser comme un processus de révélation, mais bien dans le plein sens du terme : la réalité se recrée, vient exister à nouveau compte pour des objectifs de connaissance et d’action. La recherche participe à constituer la réalité de l’expérimentation sous un nouvel angle de vue, avec de nouveaux mots, en offrant de nouvelles possibilités. Par exemple, si un collectif souhaite réfléchir et travailler sur les affects ou bien sur les rapports genrés, le dispositif de recherche devra être pensé pour faire apparaître l’expérimentation sous l’angle nécessaire à ce travail.
Cela crée un espace de pensée et de travail dans la réalité. Voir, dire et lire[16] à nouveau compte cette réalité en tension entre un présent et un devenir, un réalisé et un désirable qu’est l’expérimentation est un des objectifs de la recherche. Elle crée un décalage pour mieux saisir les enjeux politiques et sociaux afférents et pour voir ce qui est produit. Il est à la fois question de penser l’existant, mais aussi de poser des hypothèses sur le possible. Et encore, penser l’existant n’est pas poser une vérité, une explication, mais proposer des centres de perspective en espérant qu’ils seront opérant, qu’ils affecteront l’expérimentation en reconfigurant le voir, le dire et le lire des acteurs. La recherche constitue au sens fort. Elle permet à l’expérimentation d’exister dans un nouvel espace et de nouveaux processus. Dans le dispositif de recherche, les rapports genrés pourront apparaître en exergue par exemple, mettant de côté d’autres dimensions, afin d’être questionnés et agis.
Il en découle que dans la recherche-expérimentation, le savoir n'est pas « à côté » de l’action, mais à avoir avec l’action et nous sommes même tenter de dire « est une action » : une action qui a pour but de reconfigurer le pensable et le possible et ainsi de construire le pouvoir d’agir des acteurs et de l’éprouver. Même en termes de dispositif, ce projet de connaissance n’est pas « à côté » de l’expérimentation, espace de réflexivité, où le chercheur accompagne un processus de pensée dont les autres acteurs seraient responsables du retour vers l’action. Il est pleinement dans l’expérimentation en tant que partie prenante, en tant que dimension, que mode d’existence de l’expérimentation. De manière concrète, les dispositifs peuvent être des espaces-temps à part, mais pensés de manière à ce qu’ils puissent communiquer avec les autres parties de l’expérimentation. Le chercheur peut par exemple mener des entretiens sur l’histoire de vie et faire retour sur ces entretiens. Ils peuvent aussi être des dispositifs couplés à des activités ne relevant pas strictement de la recherche. Par exemple, lorsque le chercheur introduit un concept dans une réunion pour tenter de qualifier la réalité, cet apport peut venir rebattre les cartes du voir, du dire et du lire.
Si la recherche est pleinement affirmée comme contributive, elle ne se suffit pas à elle-même pour faire l’expérimentation. Elle s’insère à côté d’autres dynamiques (les relations interpersonnelles, la relation avec les institutions, les temps de travail...) et d’autres éléments (environnement, espaces, matériels...). Le chercheur doit donc se préoccuper de ce que fait la recherche à la situation, de comment est-ce qu’elle s’articule et affecte. Il n’est pas en charge de la recherche, de son côté, en parallèle du reste, mais il travaille à ce que la recherche ait sa place dans le quotidien de l’expérimentation, au même titre que d’autres aspects. Il est conscient que ce n’est pas le processus de penser tout seul qui affecte, mais que c’est parce qu’elle s’articule aux autres dimensions de l’expérimentation et aux autres personnes qu’il y a des transformations. Ces idées permettent de mettre en avant le fait que malgré l’affirmation du rôle constituant de la recherche, il n’en reste pas moins que ce n’est pas joué d’avance. Cela fait partie de la construction des communs et n’existera qu’en fonction de ce qui se mettra en place.
Cela nous permet de parler d’une tension qui traverse le travail de l’auteur. D’une part, nous avons le chercheur. Il porte une part de responsabilité quant à l’existence de la dynamique de recherche, notamment quant à la manière dont elle se déroule : respecter les autres savoirs, reconnaître les compétences de chacun... Mais la recherche est appelée à devenir une activité collective, c’est-à-dire dont les objectifs, la mise en place et l’évaluation sera portée par chacun. La recherche-expérimentation, au réel, se situera donc dans les multiples possibilités de concrétisation qui se sont entre un chercheur portant toute l’initiative et une activité totalement collectivisée. Si le lecteur a été attentif, il aura aussi perçu le prolongement de cette tension. La recherche-expérimentation oscille entre dynamique clairement identifié – « là, maintenant, on fait de la recherche » – et dynamique diffuse, à la manière de la figure du chercheur qui est tendue entre figure individuelle et figure collective.
La recherche dont l’auteur nous parle n’est évidemment pas celle qu’il a prévue avant d’arriver le terrain. Ici, le chercheur ne peut pas être protégé par un protocole méthodologique, par un échantillonnage préalable. La production de connaissances se fait selon la vie de l’expérimentation, en fonction des questions qui surgissent, des évènements et des possibilités. En fait, le chercheur ne dirige pas la recherche. Si elle devient réellement une activité collective, c’est que le travail de problématisation et de production de connaissances est l’affaire de tous. Cela implique que le chercheur reconnaisse à chacun une compétence égale à participer à l’effort de recherche et donc qu’il ne s’inscrive pas dans un rapport de supériorité. Par ailleurs, cette modalité demande à ce que le chercheur et les savoirs produits par la recherche acceptent la confrontation avec les autres savoirs circulant dans l’expérimentation, voir même que cette confrontation soit pensée. Alors que la science s’est construite en s’extirpant du sens commun, la proposition de Nicolas-Le Strat est qu’ici, elle se construit en dialogue avec lui. Cette position vient enrichir les tensions déjà exposées. D’une part, l’importance de la recherche est affirmée en tant qu’apport spécifique. D’autre part, sa non-supériorité est mise en avant ainsi que la nécessité qu’elle ne soit pas le seul mode d’existence des communs.
L'activité comme centre de perspective
La recherche est une activité
Dans les écrits de Nicolas-Le Strat, la recherche n’est pas une institution, c’est-à-dire un territoire normé, différencié, introduisant une hiérarchie des savoirs et définissant un rôle exclusif du chercheur. S’il en reconnaît cette dimension, c’est essentiellement sur le registre de l’activité concrète qu’elle implique. C’est ce qu’il fait lorsqu’il décrit la recherche-expérimentation. Il définit les processus qu’implique ce type de démarche. Mais c’est aussi un effort qu’il a mené quant à sa propre activité notamment lors de deux journaux de recherche qui ont été publiés[17]. Il vient y dire ce qu’est chercher au quotidien. De même, sur le type de terrain qu'il pratique, il appelle à une recherche open-source, c'est-à-dire qui rend visible ses processus aux personnes qui y sont confrontées, et ce en critique de la recherche classique qui ne laisse que très peu voir ses coulisses. Ainsi dépeinte, la recherche perd de son caractère exclusif au chercheur. Elle perd une part de son attache à l’institution universitaire. Décrite essentiellement sous l’angle de l’activité, elle peut alors être pensée sur des terrains autres que ceux qu’elle pratique habituellement et s’articuler à d’autres logiques, il est alors pensable qu’elle perde de sa pureté pour venir au sein de l’action. Et surtout, c’est pour cela qu’il est possible de la penser comme appelée à devenir collective. Ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut être réellement constituante de l’expérimentation. Elle ne se construit en tant que bien commun créatif et productif que parce que tous peuvent y prendre part. C’est une activité avant d’être un statut et un capital symbolique.
Cette approche de la recherche vient nourrir le constructivisme radical de l’auteur. C’est ce que la recherche produit qui est mis en avant. De même, une des compétences fondamentales du chercheur est l’attention aux processus qu’il impulse et auxquels il participe. Il est attentif à les penser au préalable mais aussi à savoir s’insérer dedans de manière opportune ainsi qu’à accompagner les effets de la recherche. Cette posture épistémopolitique porte fondamentalement son regard sur ce qui se construit et ce qui peut se construire ou est empêché. Et nous pourrions terminer en disant que ce qui prime pour l’auteur est que la recherche produise quelque chose pour l’expérimentation plutôt qu’elle fabrique du savoir pour l’institution universitaire. L’action est centre de perspective pour l’analyse mais aussi, d’une certaine manière, étalon pour l’évaluation de la recherche.
L’activité, opérateur d’objectivation ?
Il est clair qu’une telle position rentre de prime abord en opposition avec l’épistémologie classique car le chercheur fait politique et la recherche est transformée en sport de combat. Et pas seulement en lutte idéologique à distance, mais en sport qui se pratique directement sur le terrain de la construction d’alternatives locales. Le chercheur peut-il être plus lié que ça à l’action lorsque l’intérêt fondamental de la recherche est de construire pour le quotidien et non pour le savoir ? Cependant, nous défendons l’idée que la démarche de l’auteur, notamment du fait de sa centration sur l’activité, offre des perspectives intéressantes en termes d’objectivation.
Tout d’abord, elle permet une forme de symétrie. Alors qu’habituellement, le chercheur analyse principalement l’activité des autres, et dans quelques encarts méthodologiques, il se questionne – souvent a minima – sur la sienne et son impact, l’auteur mène ici une analyse qui englobe l’activité de tous car elle s’inscrit dans le même objet : l’expérimentation. Il n’y a pas d’un côté l’objet et de l’autre le chercheur, chacun bénéficiant d’un régime d’analyse différent. Le chercheur est un élément assumé du microcosme et son approche permet de bien prendre en compte ce que cela produit.
Par ailleurs, dans le cadre de ses journaux de recherche, nous constatons qu’il ne se limite pas à décrire une activité factuelle. Il détaille aussi ses implications subjectives avec ses objets de recherche et les personnes rencontrées sur ses terrains. Et comme nous l’avons déjà écrit, il prône une recherche dont les coulisses sont accessibles Au final, du fait de cette mise en visibilité de son activité, c’est un chercheur que ses lecteurs et collègues-expérimentateurs peuvent «géo-localiser » facilement dans un paysage politique. Le chercheur ne cache pas qui il est, ce qu’il fait et les raisons de ce qu’il fait sous l’apparat méthodologique habituel. Il avance à découvert, permettant ainsi aux autres de comprendre sa posture, sa place discursive et d’action. Son travail peut alors être regardé du point de vue de l’activité réelle (bien sûr médiée par son énonciation) et non sur la base d’un apparat méthodologique servant en fait de boîte quasi-noire.
Sa perspective par l’activité offre d’autres choses. De nombreuses recherches arrivent sur le terrain en ayant défini au préalable ce qu’elles allaient trouver. Par exemple, dans le champ de la formation qui est le nôtre, le « savoir », la « formation », « les compétences », « l’apprendre » sont souvent définis avant. Le chercheur sait donc ce qu’il va trouver, imposant ainsi à la réalité ce dont elle est constituée. Ce faisant, il réifie en partie ce qu’il étudie, niant à notre avis, une grande part de leur historicité. De même, il s’empêche de voir ce qui sous-tend l’existence de ces choses. Cette approche permet de maintenir l’illusion commune de l’existence des objets. Par exemple, concernant les « savoirs », ceux qui les étudient tentent d’en définir les différentes catégories. Assez couramment, sont distingués des savoirs qui relèveraient de l’action et d’autres qui seraient théoriques. Ces définitions réifient ces savoirs et empêche de voir toute l’armature institutionnelle qui vient couper le monde en deux ordres. Du côté des formations, les dispositifs sont construits sur cette dichotomie venant ainsi asseoir son pouvoir. Partir des définitions des savoirs empêche de voir ce qui leurs donnent de l’existence en tant que catégories différenciées.
Avec le travail du commun, l’auteur offre une autre perspective. Son approche par l’activité casse l’illusion d’une existence réifiée du commun. Il n’existe pas. Il est un travail. Le voir comme un travail permet de prendre de la distance avec le quotidien. S’il n’est pas une chose transcendante, alors il faut aiguiser son regard pour voir les multiples processus, lieux, temps, objets qui le construisent. S’il n’est pas défini par le haut, mais dans ce que nous voulons bien mettre derrière lui, alors il est face à nous, dans nos mains, comme un objet que nous pouvons travailler et penser plus aisément et en détail. Cette approche, selon nous, destitue les choses de leur pouvoir transcendant, de manière à nous permettre de les penser à nouveau compte, comme le fruit de notre activité. Casser la réification permet selon nous de mieux manipuler ce que l’on étudie comme des objets car ils perdent l’illusion de réalité qu’ils ont sur nous. C’est en perdant le statut de chose finie et existante, qu’elles deviennent de bons objets scientifiques d’une certaine manière.
En conclusion, nous souhaiterions appuyer le propos de notre dernière partie. Les propositions épistémopolitiques de l’auteur sont extrêmement originales et « scientifiquement incorrectes » pour ce qu’elles mettent le chercheur (l’individu) et la recherche (l’activité collective) comme un des fondements potentiels du travail du commun. La cité du savoir s’en retrouve presque complètement dissoute pour faire partie du quotidien de la cité commune. Et pourtant, ce faisant, il répond à sa manière à deux exigences fondamentales de notre discipline. Non seulement, il questionne et socialise sa subjectivité. Ce travail permet de répondre à l’exigence de réflexivité du chercheur sur sa pratique. Mais encore, il objective ce qu’il étudie grâce à son approche par l’activité.
Il est clair que ces deux exigences prennent un sens particulier dans le cadre des expérimentations. En effet, l’ouverture de son activité au regard des autres permet d’empêcher un rapport de pouvoir symbolique entre le chercheur-sachant et les autres recevant le savoir du chercheur. Cette ouverture, comme dans le cas de l’open-source, est aussi source d’une prise de pouvoir. Cela répond aux valeurs politiques défendues dans ces expérimentations. De même, l’attention à ce qui se fait a un sens tout particulier dans ces alternatives qui sont non seulement centrée sur le présent pour prêter attention à comprendre ce que produit ce qui est tenté et aussi centrée vers un futur désirable. Ces situations mettent particulièrement en avant la construction. La nécessité d’agir et la fragilité des configurations, l’incertitude du futur attirent probablement les regards vers la construction.
Mais il nous semble que son projet d’une sociologie au cœur de l’utopie est aussi extrêmement inspirante pour la recherche qui ne se revendiquerait pas d’une telle implication politique. Au final, Nicolas-Le Strat propose une démarche disposant d’une forte cohérence interne. Le sociologue regarde ce qui se construit par l’activité. Il fait partie des constructeurs. Il analyse donc sa recherche au même titre que les actions des autres et en lien avec l’action des autres. Cette cohérence est renforcée par une sorte de mise en abîme. La recherche porte sur, entre autre, la dynamique de recherche. Et étudier l’activité se fait par une activité qui tombe donc sous notre regard de chercheur. Ce tour est réussi simplement par une acceptation de ce que la recherche reconnaît comme inévitable, mais dont elle se méfie habituellement : l’implication et la perturbation. Les assumer et en jouer dans la perspective constructiviste permet d’une certaine manière de les contrôler en les intégrant pleinement à l’objet d’étude. À sa manière, l’épistémopolitique de Nicolas-Le Strat nous donne une belle leçon d’épistémologie.
Bibliographie
NICOLAS-LE STRAT P., Fabrique de sociologie (Journal d'activité – Novembre 2009/Février 2011), Montpellier, Fulenn, 2011.
–, Carnets de correspondances. Cuaderno de correspondencias (édition bilingue), Montpellier, Fulenn, 2011.
–, Le travail du commun, Saint Germain sur Ille, Les éditions du commun, 2016.
–, Une sociologie des activités créatives-intellectuelles, Sainte-Gemme, P.U.S.G., 2014.
[1] Titre fictif.
[2] Cet article s’est inspiré de la lecture de ses deux derniers ouvrages : Le travail du commun, Saint Germain sur Ille, Les éditions du commun, 2016, et Une sociologie des activités créatives-intellectuelles, Sainte-Gemme, P.U.S.G., 2014.
[3]Voir par exemple le chapitre « Vers une épistémopolitique du commun », in Le travail du commun, Op. Cit.
[4] Le verbe « communer » est un néologisme introduit par Negri et Hardt : « De même que le boulanger fait du pain, que le tisserand tisse ou que le meunier moud son grain, l’homme du commun ''commune'', c’est-à-dire qu’il produit du commun », in HARDT M. et NEGRI A., in NICOLAS-LE STRAT P. (dir.), Le travail du commun, Op. Cit., p. 23.
[5] NICOLAS-LE STRAT P., Le travail du commun, Op. Cit., p.14.
[6] Idem, pp. 14-15.
[7] Idem, p. 14.
[8] Idem, p. 11.
[9] Idem, p. 13.
[10] Idem, p. 15.
[11] Idem, p. 16.
[12] Ce terme est une des possibles traductions du mot empowerment.
[13] NICOLAS-LE STRAT P., Une sociologie des activités créatives-intellectuelles, Op. Cit., p. 255.
[14] DUBOST J. et LÉVY A., in Une sociologie des activités créatives-intellectuelles, Op. Cit., pp. 263-263.
[15] Pour plus de détails, la lecture du chapitre suivant sera intéressante « La portée constituante (instituante) d’une sociologie » in Une sociologie des activités créatives-intellectuelles, Op. Cit., pp. 319-330.
[16] Idem, p. 329.
[17] Fabrique de sociologie (Journal d'activité – Novembre 2009/Février 2011), Montpellier, Fulenn, 2011 ; Carnets de correspondances. Cuaderno de correspondencias (édition bilingue), Montpellier, Fulenn, 2011.