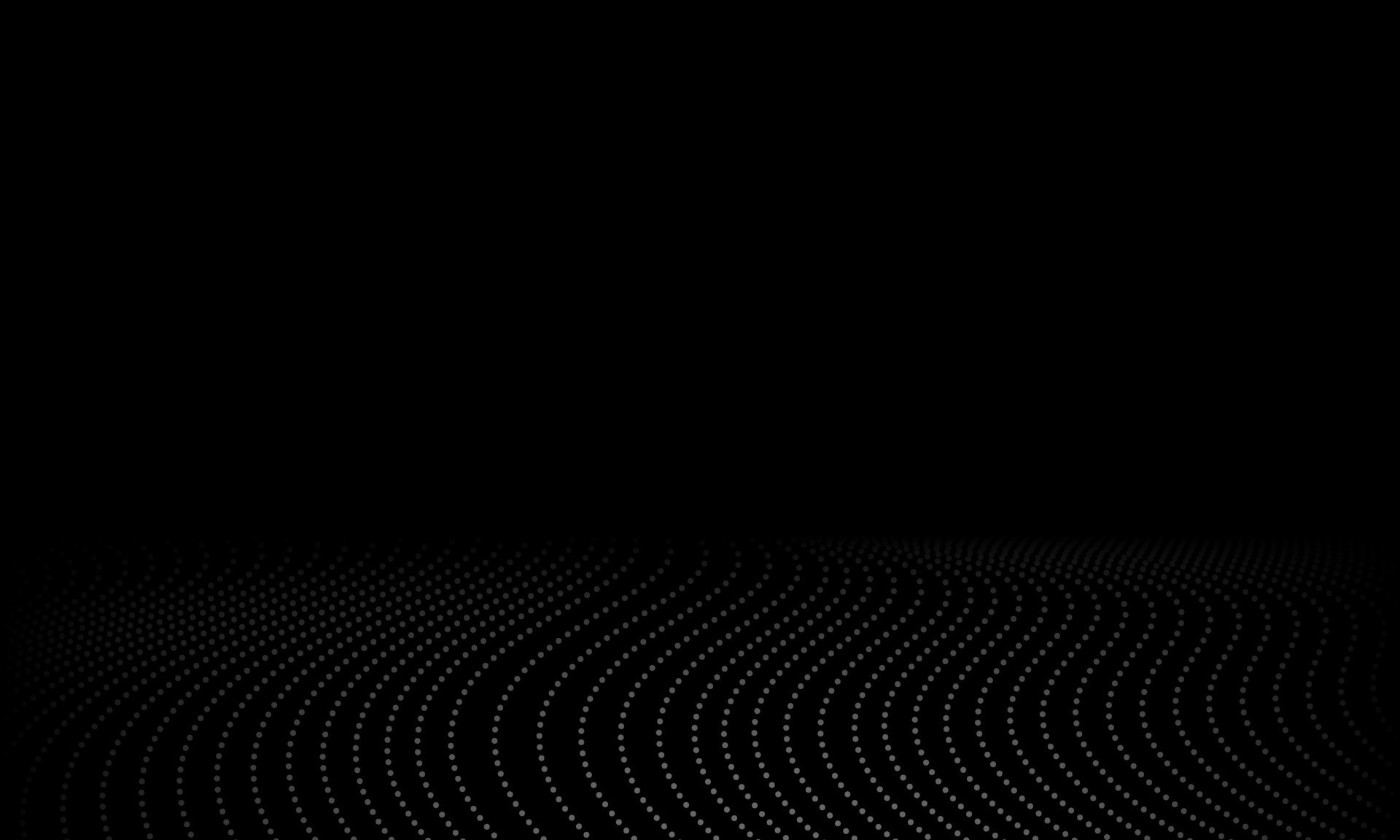Par André Tosel, Professeur émerite de philosophie.
Althusser et la critique de l’historicisme : la philosophie de la praxis comme continuum équivoque de détermination
Louis Althusser, voici cinquante ans, en 1965, a manifesté dans un texte fameux de Lire le Capital II, au point V intitulé « Le marxisme n’est pas un historicisme », sa difficulté à saisir la complexité de la pensée de Gramsci et à accepter la compréhension gramscienne de la philosophie de Marx comme « historicisme absolu ». Nous pouvons partir de ce jugement qui pose le problème de la cohérence et la portée réelle de la philosophie de la praxis en la diversité de ses expressions qui en fait une constellation apparemment fuyante et glissante.
Althusser a certes, et c’est rare chez lui, pris des précautions en reconnaissant au préalable « une œuvre géniale profondément nuancée et subtile », riche en « découvertes fécondes dans le domaine du matérialisme historique »[1]. Il a voulu de même circonstancier la critique qu’il lui adressait en la limitant à la seule sphère de la philosophie énoncée alors encore en termes de matérialisme dialectique. Toutefois ces précautions donnent encore plus de force à la critique. Celle-ci, en effet prend soin au préalable de souligner la fonction positive, qui est critique et polémique, de l’historicisme absolu tel qu’elle s’exprime dans la revendication d’immanence. L’historicisme absolu qui est humanisme absolu a deux fonctions positives pour Althusser :
1) refuser toute interprétation métaphysique de la philosophe marxiste et 2) indiquer comme concepts “pratiques” le lieu et la direction où la conception marxiste doit s’établir pour rompre tous liens avec les métaphysiques antérieures : le lieu de “l’immanence”, de “l’ici-bas” que Marx opposait déjà comme le “diesseits” (notre ici-bas à la transcendance “jentseits”) des philosophies classiques[2].
Mais si Gramsci valorise ainsi les Thèses sur Feuerbach (en ce cas la thèse n°2) comme texte de référence, il ne peut pas dépasser ce stade indicatif, et, comme il ne prend pas en compte le type de scientificité du Capital, il nous laisse dans l’indétermination philosophique et se borne à réduire la philosophie à être l’expression simple de l’histoire et l’histoire à être le corps de la philosophie la plus expressive de son temps et de ses problèmes.
Cette lecture qui ira toujours plus renforçant et compliquant la critique anti-historiciste, part d’un texte de Gramsci, des Appunti di filosofia, première série, Cahier 4, 11, 432-3, repris et développé dans un cahier spécifiquement philosophique, le Cahier 11, 27, 1436-7. Le texte commence par indiquer la nouveauté radicale de la philosophie de la praxis propre à Marx :
Sur le plan théorique la philosophie de la praxis ne se confond avec aucune autre philosophie ni ne se réduit à elle : elle est non seulement originale en tant qu’elle dépasse les philosophies précédentes, mais elle l’est en tant qu’elle ouvre une route complètement nouvelle, c’est-à-dire renouvelle de fond en comble le mode de concevoir la philosophie elle-même.
Elle incorpore et transvalue surtout l’hégélianisme qui est l’élément du mode de philosopher le plus important dans la formation de Marx. Althusser cite alors le texte :
L’hégélianisme a tenté de dépasser les conceptions traditionnelles de l’idéalisme et du matérialisme en une nouvelle synthèse qui eut sans nul doute une importance exceptionnelle et qui représente un moment historico-mondial de la recherche philosophique. C’est ainsi qu’il arrive lorsqu’on dit dans l’Essai [Althusser ajoute Croce entre parenthèses alors qu’il s’agit du Manuel de sociologie de Boukharine, un des principaux théoriciens soviétiques du matérialisme historique avant le gel stalinien et objet de la critique contenue dans le Cahier 11] le terme “immanence” dans la philosophie de la praxis est employé dans un sens métaphorique, on ne dit rien du tout ; en réalité le terme d’immanence a acquis une signification particulière qui n’est pas celle des “panthéistes”, et qui n’a rien de la signification métaphysique traditionnelle, mais qui est nouvelle et doit être fixée. On a oublié dans l’expression très courante (de matérialisme historique) qu’il fallait mettre l’accent sur le second terme “historique”, et non sur le premier qui est d’origine métaphysique. La philosophie de la praxis est “l’historicisme” absolu, la mondanisation et la “terrestréité” absolues de la pensée, un humanisme absolu de l’histoire. C’est dans cette direction qu’il faut creuser le filon de la nouvelle conception du monde[3].
Althusser comprend parfaitement qu’identifiée à une conception du monde la philosophie de la praxis soit cette conception du monde laïque, la seule capable de succéder à la religion pour exercer un rôle pratique dans l’histoire réelle, en pénétrant la vie pratique des hommes, en fournissant une vue générale du cours du monde, unifiant tout à la fois la pensée et le comportement politique des « intellectuels » et des « simples » dans la construction d’une hégémonie dont les masses subalternes sont les acteurs. Althusser accepte de même que les conceptions du monde soient définies comme des idéologies, des formations théoriques dotées d’efficace politique qui pénètrent dans toutes les couches de la société et aident à transformer la conduite de la vie quotidienne. Il va même jusqu’au bout des équations gramsciennes et il décline la conception du monde nouvelle comme idéologie organique à vocation hégémonique élaborée par le parti communiste, prince machiavélien moderne Althusser reconnaît le continuum qui unit philosophie de la praxis, conception du monde nouvelle, religion unissant enfin vraiment les simples et les intellectuels, idéologie organique supérieure aux idéologies (au sens de légitimation mystificatrice) des rapports de pouvoir et de formations de l’imaginaire. L’historicisme est justifié en ce qu’il est vrai que l’on ne peut séparer désormais la philosophie de l’histoire et donc de la politique, qu’inversement toute politique effective est à la fois histoire et philosophie.
L’historicisme comme indication pratique permettant la formulation de la révolution philosophique de Marx n’est pas une erreur. Althusser en arrive alors au point extrême de ce qu’il considère comme positif chez Gramsci.
L’historicisme du marxisme n’est que la conscience de cette tâche et de cette nécessité : le marxisme ne peut prétendre à être la théorie de l’histoire que s’il pense dans sa théorie même les conditions de cette pénétration dans l’histoire, dans toutes les couches de la société et jusque dans la conduite quotidienne des hommes. […] Gramsci ne fait qu’exprimer cette nécessité, non seulement pratiquement, mais consciemment, théoriquement inhérente au marxisme. L’historicisme du marxisme n’est alors que l’un des aspects et des effets de sa propre théorie bien conçue, il n’est que sa propre théorie conséquente avec soi : une théorie de l’histoire réelle doit passer aussi comme l’ont fait jadis d’autres “conceptions du monde”, dans l’histoire réelle. Ce qui est vrai des grandes religions doit l’être à plus forte raison du marxisme lui-même, non seulement en dépit, mais à cause même de la différence qui existe entre lui et ces idéologies, en raison de sa nouveauté philosophique puisque sa nouveauté consiste à inclure le sens pratique de sa théorie même[4].
Mais là s’arrêtent ses mérites. Toute cette problématique entre dans la science de l’histoire et ne concerne pas la philosophie en tant que réflexion immanente de la structure de cette science, en tant qu’intelligence par cette science de la production de ses effets de vérité qui ne sont pas des effets idéologiques comme les autres. Ce n’est pas la seule immanence qui distingue les conceptions du monde ou idéologies. « C’est la forme distinctive de cette immanence absolue : la forme de la scientificité » qui fait « coupure » entre les éléments du continuum, « entre les anciennes religions ou ihdéologies même organiques et le marxisme qui, lui, est une science, et qui doit devenir l’idéologie « organique » de l’histoire humaine, en produisant dans les masses « une nouvelle forme d’idéologie (une idéologie qui repose cette fois sur une science – ce qui ne s’était jamais vu –. Cette distinction qui insiste sur la forme de la scientificité est une coupure que Gramsci ne réfléchit pas. Cette carence de réflexion conduit Gramsci à « réunir sous un même terme – philosophie de la praxis – la théorie scientifique de l’histoire (matérialisme historique) et la philosophie marxiste (matérialisme dialectique) et à penser cette unité comme une “conception du monde” ou comme une “idéologie” somme toute comparable aux anciennes religions »[5].
Il ensuit que Gramsci est conduit à « penser le rapport de la science marxiste à l’histoire réelle sur le modèle d’une idéologie organique (historiquement dominante) et agissante à l’histoire réelle et en définitive à penser ce rapport à l’histoire réelle sur le modèle du rapport d’expression directe qui rend assez bien compte d’une idéologie organique à son temps »[6]. On ne sort donc jamais de l’idéologie puisque en définitive les conceptions du monde, les religions et la philosophie de la praxis s’inscrivent dans la sphère générique de l’idéologie et que « la science est elle-même superstructure », une « catégorie historique » réductible aux rapports humains qui la soutiennent en tant que pratique, alors que cette pratique théorique est production de connaissances vraies dans son ordre qui est celui de la pensée et qui vaut comme tel.
Althusser vise juste dans la mesure où il fait apparaître la complexité et la singularité du réseau catégoriel qui définit la philosophie de la praxis et il pose la question de la vérité dont relèverait une théorie de l’histoire qui s’établit dans une continuité entre philosophie, conception du monde, religion et idéologie. Les termes de ce continuum idéologique sont reliés par leur fonction pratique d’unification de forces sociales distinctes ou opposées, en lutte pour une hégémonie qui est elle-même divisée. Elle est divisée selon qu’il s’agit de promouvoir la capacité d’agir et de penser des masses subalternes modernes dans la transformation des rapports de domination, d’exploitation, et d’assujettissement, ou selon qu’il s’agit pour les forces dominantes et dirigeantes de maintenir et surtout de renforcer leur hégémonie, en faisant accepter domination, exploitation et assujettissement comme autant de rapports sociaux faisant sens et constituant un monde indépassable.
Voilà pourquoi Althusser s’interroge sur la place occupée par les religions dans ce continuum et sur la fonction de vérité de la philosophie de la praxis. Il s’inquiète de l’équivalence relative établie entre la philosophie de la praxis et la conception du mode qui la définit et de la religion, Gramsci emprunte cette équivalence à Croce. Comment alors distinguer de la religion – catholique surtout – une conception du monde laïque fondée sur l’immanence, sur le développement de la pensée scientifique et philosophique libre, sur le refus de tout surnaturalisme métaphysique, sur la récusation de tout recours à une transcendance rendant impossible de développer la pensée sous « la forme de la scientificité » ? Insistons avec Althusser en reprenant en son entier un texte cité « Gramsci est constamment hanté par la théorie crocienne de la religion ».
S’il en accepte les termes, et s’il l’étend des religions effectives à la nouvelle conception du monde qu’est le marxisme ; s’il ne fait sous ce rapport aucune différence entre ces religions et le marxisme ; s’il les range, religions et marxisme, sous le même concept de “conceptions du monde” ou “idéologies” ; s’il identifie aussi aisément religion, idéologie, philosophie et théorie marxiste sans relever que ce qui distingue le marxisme de ces “conceptions du monde” idéologiques, c’est moins cette différence formelle (importante) de mettre fin à tout ”au-delà” supraterrestre que la forme distinctive de cette immanence absolue (sa “terrestréité”) : la forme de la scientificité[7].
Éléments pour une analyse du continuum idéologique : une première approche scalaire
Il nous semble utile de tenter une topologie de ce continuum dans les Cahiers de prison en le considérant à partir de ses points extrêmes. Présentons un premier schéma. La proposition de philosophie de la praxis occupe le point haut de ce continuum et son point bas est occupé par la notion d’idéologie au sens négatif. Chacun de ces extrêmes se dilate à son tour et se déplace en se traduisant dans des équivalents qui apportent chacun des aspects différents sur la base d’une critique.
Le niveau supérieur ou terminal du continuum : la philosophie et la philosophie de la praxis
La philosophie représente un degré supérieur de l’activité de penser, comme les sciences. Elle se distingue de la religion et du sens commun lesquels coïncident souvent et sont affectés de la mention d’idéologie. Si la philosophie n’existe pas en général, mais toujours dans la pluralité des philosophies déterminées, de même que la religion existe toujours sous des formes historiques, il n’en demeure pas moins que « la religion et le sens commun ne peuvent pas constituer un ordre intellectuel, parce qu’ils ne peuvent pas se réduire à l’unité et à la cohérence dans la conscience individuelle, pour ne rien dire de la conscience collective » (Q. 11, 1, 1378). La philosophie comme telle exige une liberté de penser que la religion et le sens commun n’impliquent pas en ce que tous deux présupposent le renvoi à une instance qui fait autorité. La pluralité des philosophies met celles-ci en concurrence et implique que chacun opère un choix qui relève à la fois de raisons intellectuelles et de motivations pratiques. Définie comme affirmation d’une conception du monde et comme conduite selon cette conception, toute philosophie est un acte d’opération politique (operare politico, Q. 11, 1, 1379). Considérée comme ordre intellectuel, la philosophie de la praxis se distingue des modes de philosopher dominants jugés métaphysiques qu’elle critique. Les raisons intellectuelles de cette critique sont inséparables de la critique de la politique menée en fait par ces philosophies. Elles soutiennent la possibilité d’un ordre historique – politique et social – nouveau et elles font opter pour le choix politique de la lutte pour cet ordre. Pour Gramsci, la philosophie de la praxis comme construction d’un ordre intellectuel et politique supérieur lutte sur deux fronts.
Il s’agit d’abord du front constitué par la philosophie idéaliste spéculative allemande (Hegel) ou italienne en laquelle Gramsci s’est formé. Cet idéalisme italien a voulu se faire réforme de l’hégélianisme dont il accepte l’immanence liée à un concept historicisé de l’esprit. Gramsci est d’abord proche de Gentile. S’il accepte, en effet, la proposition venue d’Antonio Labriola d’identifier la philosophie de Marx comme philosophie de la praxis, Gentile en récuse le matérialisme économique et lui substitue la conception de l’acte pur du penser comme référence terrestre absolue. Toutefois Gramsci se rapproche plus tard de Croce qui nourrit sa pensée de contenus plus riches, tout en réduisant la pensée de Marx à une simple méthodologie de l’histoire. Celle-ci permet cependant de dépasser le déterminisme économiste qui contamine le marxisme de la Seconde Internationale et surtout de la Troisième, en empêchant de résoudre le problème décisif de l’histoire en son moment politique actuel. Ce problème est posé par la question suivante : comment la structure (en son automatisme tendanciel qui est un produit historique, non un destin) engendre-t-elle le mouvement historique en produisant un bloc historique avec les superstructures et en créant les conditions des luttes hégémoniques ? Comment rendre compte de ce mouvement qui engendre une situation de révolution passive (fascisme et libéralisme américain) et comment le dépasser dans le sens d’une hégémonie des subalternes ? Cette situation implique une réélaboration de la théorie marxiste en tous ses moments – théorie de la causalité historique, rapports entre nécessité et liberté, question de la prévision dans et de l’action se faisant, statut des soi-disant lois historiques qui ne sont que des régularités tendancielles, articulation entre conditions objectives durables et conjonctures singulières où joue l’action humaine, formation des volontés collectives antagoniques ou simplement relativement opposées à partir des conditions, relations de ces volontés en fonction des capacités acquises des unes à absorber les autres dans des formation sociales plus ou moins universelles et dans leurs structures (État élargi à la société civile). Au terme relatif de cette déconstruction et reconstruction se repose la question de la dialectique et des contradictions manquée par l’idéalisme italien. Celui-ci sur le plan politique défend l’ordre social dominant sous ses deux formes concurrentes, que ce soit comme césarisme fasciste ou comme libéralisme constitutionnel.
Il s’agit en second lieu, mais simultanément, du front que définit le positivisme évolutionniste. Ce dernier réduit le matérialisme historique à une sociologie économiciste et scientiste qui se veut modelée sur les sciences naturelles et leur matérialisme naturaliste. Il opère la fétichisation des lois, du déterminisme, du « facteur technique ». Il défend le culte d’une évolution progressiste, mais celui-ci peut soit passer par la médiation des luttes de classes (version socialiste réformiste) soit par une conception du conflit réduit la lutte plus ou moins biologisée des plus forts pour leur survie (version libérale). Ce positivisme a contaminé le marxisme et paralysé ses capacités d’analyse socio-historique en s’assurant de la garantie d’une finalité objective inscrite dans le progrès historique. Incapable de penser l’action politique de manière stratégique, fétichisant l’État, il a allié un réalisme réformiste de courte vue à ce supplément qu’est une théorie normative des valeurs de type néokantien, pour ménager une liberté sans efficace et buter sur les rapports entre nécessité et liberté. L’idéalisme est supérieur théoriquement à ce positivisme, à la condition que soit reformulée la théorie du matérialisme historique.
La tâche est donc celle d’une réforme intellectuelle et morale de la philosophie, elle vise à retrouver dans une conjoncture nouvelle le niveau de la théorie atteint par Marx dans la haute culture. Ce niveau, en effet, a été à la fois perdu à la base dans le procès de diffusion et de vulgarisation d’un marxisme positiviste auprès des masses et en même temps dissous en son sommet par l’offensive de la philosophie néo-hégélienne italienne et la généralisation continentale du positivisme auprès des scientifiques. La philosophie de la praxis doit produire son autonomie et sa spécificité unique dans la haute culture, montrer sa supériorité au sein de la philosophie des spécialistes et faire la preuve de sa dimension épocale unique. C’est là une ambition « historiale », colossale, dont témoigne le début du texte cité par Althusser. En Q. 11, 27, 1434-5, Gramsci énonce « le concept fondamental » de sa reconstruction : « La philosophie de la praxis “se suffit à soi”, elle contient tous les éléments pour construire une totale et intégrale conception du monde, une philosophie totale et une théorie des sciences naturelles, mais plus encore, pour aussi vivifier une organisation intégrale pratique de la société, c’est-à-dire pour devenir une civilisation totale, intégrale ». Elle est « révolutionnaire » au sens éminent en ce qu’elle opère une « scission complète » avec les philosophies traditionnelles, métaphysiques à divers titres ou incomplètement immanentes et terrestres : « Une théorie est effectivement “révolutionnaire” dans la mesure où elle est élément de séparation et de distinction consciente en deux camps, en tant qu’elle est un sommet inaccessible au camp adverse ». Gramsci insiste sur cette autonomie et cette indépendance qui met la philosophie de la praxis « en antagonisme avec toutes les philosophies et religions traditionnelles ». Même si en tant que conception du monde elle est d’une certaine manière idéologie, elle est paradoxalement une idéologie « véritative » en quelque sorte : « elle est si robuste et féconde en nouvelles vérités que le vieux monde y recourt pour fournir son arsenal en armes plus modernes et plus efficaces ». Le pouvoir cosmogénétique – pouvoir de produire un nouveau monde comme un bloc historique économique, politique, culturel – est corrélatif de la puissance de production d’un savoir vrai du monde, dans le monde. « La philosophie est la critique et le dépassement de la religion et du sens commun et en ce sens elle coïncide avec le « bon sens » qui s’oppose au sens commun » (Q. 11, 1, 1378). Le continuum implique des oppositions et la principale concerne le sens commun que l’on pourrait nommer « idéologie ».
Le niveau inférieur ou initial du continuum : les deux sens de l’idéologique et des idéologies
Gramsci ne traite pas explicitement du concept marxien d’idéologie. Il en reçoit cependant l’usage fait dans les débats du temps. Il souligne les deux sens ou les deux faces que le terme a chez Marx, le sens négatif et le sens positif, pour donner le primat au second. Le sens négatif est le « sens péjoratif » (l’ideologia al senso deteriore) : il connote une conscience distordue du réel historique, voire inversée, qui se prend pour vérité éternelle et ne sait ni se relativiser ni s’historiciser. Gramsci préfère reprendre et élargir la caractéristique positive que Marx indique dans la Préface de 1859 à la Contribution à la critique de l’économie politique : les idéologies relèvent de la partie la plus médiate de la superstructure : ce sont les formes – juridiques, politiques, artistiques, philosophiques de conscience – qui permettent aux hommes de concevoir les conflits en lesquels ils sont pris et de les combattre. Gramsci élargit ce concept positif si bien que ce point bas du continuum reçoit sa nécessité pratique et sa dignité théorique de forme. En ce sens, il ne faut pas interpréter le continuum de manière verticale comme une ascension qualitative du bas inférieur vers le haut supérieur, mais de manière horizontale comme un spectre où se constituent des formes à la fois plus complexes et plus capables en quelque sorte de manière quantitative d’intégrer de plus en plus d’aspects du réel historique, tout en demeurant ouvertes aux contradictions qui les traversent et les poussent à se transformer indéfiniment en raison de leur fonction antagonique. Il existe bien une supériorité relative ou plutôt relationnelle d’une forme sur une autre et elle est d’ordre quantitatif, non qualitatif : il s’agit de la capacité de mieux penser le tout social en approfondissant la connaissance de ses structures tout en identifiant les positions contradictoires assignées aux forces sociales en lice.
Les idéologies ont une efficace en ce que c’est sur leur terrain que les sujets forment leur volonté individuelle et collective et identifient leurs objectifs. La critique de l’économisme et du déterminisme dans la conception vulgaire de la relation entre structure et superstructures interdit de faire de ces dernières de simples apparences ou illusions comme Croce le reproche indûment à Marx en le rejetant dans le marxisme vulgaire du positivisme. Croce a usé du sens péjoratif de l’idéologie pour mieux rejeter la conception positive, adéquate, du rapport entre structure et ce que Gramsci nomme très vite des « idéologies organiques » qui ont une teneur de réalité et de vérité comme éléments du bloc historique : « les forces matérielles sont le contenu, les idéologies la forme ». Certes, cette distinction est pédagogique et elle ne doit pas être recouverte par la distinction dualiste métaphysique entre le réel et l’apparaître, ni être interprétée dans le sens d’une opposition. C’est ce que précise un texte du même Cahier 7, 21, 869, sous le titre évocateur « validité des idéologies » : « Les forces matérielles ne seraient pas concevables historiquement sans forme et les idéologies seraient des lubies individuelles sans les forces matérielles ».
Ainsi, les idéologies peuvent bien « être des constructions, des instruments de direction politique » dans une approche que Gramsci dit dominer chez Marx et qu’il nomme « critico-destructrice ». Mais il faut valoriser l’approche positive et organique. Pour Marx, dit le texte Q. 4, 15, 437 :
Les “idéologies” sont toute autre chose qu’illusion et apparence ; elles sont une réalité objective et opérante, mais elles ne sont pas le ressort de l’histoire, voilà tout. Ce ne sont pas les idéologies qui créent la réalité sociale, mais c’est la réalité sociale, dans sa structure productive, qui crée les idéologies. Comment Marx pourrait-il avoir pensé que les superstructures sont apparence et illusion ? Ses doctrines sont aussi une superstructure. Marx affirme explicitement que les hommes prennent conscience de leurs tâches sur le terrain idéologique, ce qui n’est pas une mince affirmation de “réalité” : sa théorie veut précisément elle aussi “faire prendre conscience” à un groupe social déterminé de ses propres tâches, de sa propre force, de son propre devenir. Mais il détruit les “idéologies” des groupes sociaux adversaires qui précisément sont des instruments pratiques de domination politique sur le reste de la société : il démontre comment elles sont privées de sens, parce qu’en contradiction avec la réalité effective.
Une surprise nous est ici réservée : le continuum que nous avons présenté comme orienté dans la direction unilinéaire d’une complexité et d’une adéquation quantitative croissantes n’est pas réductible à cette figure. Il prend plutôt la figure d’un cercle où le début apparent dans les formes idéologiques de bas niveau épistémologique se renverse en ce que les formes élaborées de la philosophie et notamment de la philosophie de la praxis doivent se réinvestir dans les premières formes, se faire idéologie qui transforme l’idéologie, et ainsi indéfiniment, puisque la nouvelle idéologie devient la forme de vie et de penser efficace qui se constitue en matériau de la nouvelle critique philosophique. Il faut appliquer le concept d’idéologie comme forme de conscience positive à la théorie des idéologies de Marx elle-même. La philosophie de la praxis est une idéologie comme les autres mais supérieure en ce qu’elle peut et doit faire prendre conscience à une classe de sa fonction organique possible. Cette tâche exige que la philosophie de la praxis comme idéologie organique – en cours de réélaboration théorique supérieure – se distingue des autres idéologies adversaires, en faisant apparaître leur caractère devenu inorganique ; elle doit montrer que ces idéologies sont (re)tombées dans la catégorie d’ « instruments pratiques de domination politique » parce qu’elles sont contradictoires en tentant de réconcilier vainement des intérêts opposés.
La philosophie de la praxis se projette dans les formes idéologiques pour les critiquer en se présentant non pas comme résolution pacifique et verbale des contradictions, mais comme terme de la contradiction, terme capable de résolution effective. Le résultat de cette intervention est une modification des formes de conscience, mais ces formes peuvent à leur tour devenir « idéologiques au sens péjoratif », se faire instrument de domination productrice d’illusions pour les gouvernés et voulues comme illusions et tromperies pour les gouvernants. Elles sont alors l’objet et le matériau d’une nouvelle critique de la part de la philosophie de la praxis. Ici se présente une alternative.
Ou bien la philosophie de la praxis réussit à entreprendre cette critique et cela l’oblige à un affinement de ses concepts et un approfondissement de sa problématique : assimilés par la classe et les masses subalternes destinataires de cette intervention, ces concepts et cette problématique procurent une plus grande force intellectuelle et politique pour conduire la lutte pour l’hégémonie. Ils se font alors « conception du monde organique », élément du nouveau bloc historique en construction à venir.
Ou bien la philosophie de la praxis n’y parvient pas et elle se laisse transformer et déformer par la conception du monde dominante. Elle risque alors à son tour de devenir une idéologie au sens péjoratif du terme. Cette situation d’idéologisation possible caractérise la conjoncture présente où Gramsci tente de donner à la philosophie de la praxis sa fonction unique, celle d’une conception du monde qui représente dans la théorie et la politique la lutte hégémonique de la nouvelle force sociale contre, d’une part, l’économisme et le positivisme univoquement matérialiste et, d’autre part, contre le volontarisme et le spontanéisme unilatéralement idéalistes.
Là s’opère la transformation du continuum idéologique en cercle ou plutôt en spirale. On va d’une idéologie historique socialement déterminée qui est une philosophie non critique à la philosophie qui est l’idéologie théorique capable en vérité de critiquer cette dernière en produisant une autre forme idéologique ; et on repart de cette forme transformée qui doit relancer la critique de la philosophie laquelle se modifie en cette occasion. Rien n’assure de la continuité du cercle ou de la circulation des formes qui est aussi une traduction. Le circuit peut s’interrompre et une idéologie orientée sur la production d’une conception du monde totale et intégrale peut se voir paralysée et réduite par une autre conception du monde au statut d’une idéologie de subalternes ou bien fétichisée en instrument de direction politique produisant des illusions. Celles-ci ont alors une double fonction : d’une part, elles empêchent les classes dominantes de comprendre adéquatement l’histoire qu’elles imaginent faire et elles légitiment des intérêts particuliers en valeurs universelles ; d’autre part elles jettent dans la confusion les classes dominées qui ne peuvent pas donner un sens transformateur à leur lutte et font de l’histoire qui est celle de leur défaite un destin subi dans la passivité. L’histoire se faisant paralyse la critique et l’autocritique. Le cercle du continuum est ainsi une spirale qui n’est pas garantie dans son mouvement ascensionnel – s’élever dans un sens hégémonique – et peut soit s’interrompre soit déchoir, retomber en donnant lieu à des formes idéologiques et politiques imprévues, efficaces mais mises au service de la domination politique et économique et de l’assujettissement idéologique d’un nouveau sens commun empêchant la lutte révolutionnaire.
Un texte de seconde rédaction (en Q. 10, II, 41, xii, 1430) opère une reprise modificatrice du texte cité (Q. 4, 15) et consigne ce pas en avant :
Pour la philosophie de la praxis les idéologies sont bien autres qu’arbitraires, elles sont des faits, qu’il faut combattre et dévoiler dans leur nature d’instruments de domination historiques réels non pour des raisons de mentalité, etc., mais précisément pour des raisons de lutte politique, pour rendre les gouvernés politiquement indépendants des gouvernants, pour détruire une hégémonie et en créer une autre, comme moment nécessaire du renversement de la praxis […]. En ce sens est juste l’affirmation de Croce (“Matérialisme historique et économie marxiste”) que la philosophie de la praxis est “l’histoire faite ou in fieri”. Il y a cependant une différence fondamentale entre la philosophie de la praxis et les autres philosophies : les autres idéologies sont des créations inorganiques parce que contradictoires, parce que dirigées vers la conciliation d’intérêts opposés et contradictoires : leur “historicité” sera brève parce que la contradiction émerge après tout événement dont elles ont été l’instrument. La philosophie de la praxis au contraire ne tend pas à résoudre pacifiquement les contradictions existantes dans l’histoire et dans la société, elle est par contre la théorie de ces contradictions ; elle n’est pas l’instrument de gouvernement des groupes dominants pour avoir le consensus et exercer l’hégémonie sur les classes subalternes ; elle est l’expression de ces classes subalternes qui veulent s’éduquer elles-mêmes à l’art du gouvernement et qui ont intérêt à connaître toutes les vérités même les plus désagréables et à éviter les tromperies (impossibles) de la classe supérieure et encore plus celles qu’elles se font sur elles-mêmes.
L’idéologie ne se réduit donc pas à un rapport imaginaire de tout individu à la représentation du réel, à l’idéologique. Il s’agit de formes de conscience collective propres à des classes et à des groupes : elles ont un sens politique mais intègrent ce sens politique dans une vision du monde plus large. Ces formes sont constitutives dans leur pluralité antagoniste de ce qui doit être thématisé comme sens commun et elles s’opposent en se subordonnant à une idéologie dominante. L’idéologie comme telle est donc un système plus ou moins organisé d’idées et de normes de conduite qui ont une extension diffuse, ouverte. Elle est politique, et essentielle pour la conquête et le maintien du pouvoir des classes dominantes. L’idéologie n’existe pas en général, mais elle existe sous une pluralité de formes polarisées entre la forme dominante et les formes dominées. Ces dernières sont prises dans un sens commun qui est un produit historique complexe, vécu comme une évidence naturelle. Ce qui est général, c’est l’obligation systémique qui contraint un groupe social en lutte pour le pouvoir de procéder à « l’élaboration unitaire d’une conscience collective ». Comme le montre l’exemple de la presse d’opinion, « la diffusion à partir d’un centre homogène d’un mode de penser et d’opérer en est la condition principale, mais elle ne doit et ne peut pas être la seule. Une erreur très répandue consiste à penser que chaque couche sociale élabore sa conscience et sa culture de la même manière, avec les mêmes méthodes, c’est-à-dire les méthodes des intellectuels de profession » (Q. 1, 3, 33). La théorie se fait analyse comparative et historique en même temps que le concept d’idéologie se dilate et se lie à celui de conception du monde et de sens commun, sous la perspective de la formation d’une conscience collective. Ces résultats nous conduisent à modifier et à déterminer notre première approche en introduisant les termes équivalents à chacun de ceux qui ont été pédagogiquement pris comme point initial de départ et point relativement terminal, termes qui ne sont pas absolument initiaux ou terminaux.
Conception du monde, sens commun, religion. La seconde approche : détermination circulaire du continuum
La philosophie de la praxis s’énonce en des équations devenues célèbres qui la disent égale à une conception philosophique du monde, au sens commun des subalternes, à une religion de masse, mais ces équations impliquent une modification, décisive de chaque terme. La conception du monde est totale ou intégrale, on l’a vu ; le sens commun est propre à une volonté pratique active ; la religion de masse n’est pas la religion de la liberté selon Croce, mais une hérésie de la religion de la liberté. Ces termes se traduisent les uns dans les autres à la condition d’opérer ces qualifications. Il faudrait définir cette famille d’équations en précisant que chacune définit un concept qui n’est pas exactement superposable à un autre, alors que tous sont en corrélation. Comme l’indique Guido Liguori dans l’entrée « Ideologia » du volume Le parole di Gramsci[8], « ils forment un réseau conceptuel… Ils peuvent différer en fonction du degré de conscience et de fonctionnalité, plus ou moins médiates eu égard à la praxis et à la politique » ; ils témoignent du caractère de la réflexion en chemin dans les Cahiers mais « ils expriment une théorie qui dans l’ensemble est suffisamment cohérente et explicite »[9].
Le continuum idéologique circulaire compris à partir de son effectuation individuelle et collective : conception du monde et sens commun
« Tous les hommes sont philosophes », telle est la thèse démocratique radicale qui relance la recherche. Elle vaut d’abord pour chaque individu : dépourvu de culture philosophique, l’individu, à sa manière non réfléchie, immédiate, spontanée, ne peut pas ne pas manifester une activité intellectuelle minimale, dans la mesure où il parle, où il s’assimile les significations inscrites dans les réseaux d’appartenance sociale qui le définissent dès sa naissance et sa venue à un monde historique et social, dans la mesure où il s’inscrit dans une forme de religion populaire déjà là. Gramsci nomme idéologie cette philosophie spontanée pour faire apparaître la fonction nécessaire et irréductible de la « validité des idéologies ». Si la philosophie est idéologie, l’idéologie est philosophie en ce qu’elle donne une dimension véritative minimale – qui peut se révéler illusoire et instrumentale, mais qui est nécessaire – à la conception du monde en laquelle chacun advient au monde, y occupe un lieu qui est ou non une position permettant le développement de son humanité. Cette philosophe spontanée propre à « tout le monde » est contenue en trois formes de vie et d’expression : « 1) dans le langage lui-même qui est un ensemble de notions et de concepts déterminés, non pas un simple jeu de mots grammaticalement vides de contenu ; 2) dans le sens commun et le bon sens ; 3) dans la religion populaire et donc aussi dans tout le système de croyances, superstitions, opinions, modes de voir et d’opérer qui se présentent en ce que généralement on appelle “folklore” » (Q.11, 12, 1375). On voit ici s’enchevêtrer les termes du réseau conceptuel.
Distinguons-en le sens commun qui est habituellement l’opposé de la philosophie et qui en est en fait la première manifestation, non l’autre absolu. Le sens commun est la conception du monde elle-même envisagée dans sa fonction pratique et politique de production d’un lien social composé de représentations plus ou moins cohérentes, d’idées plus ou moins élaborées, de normes de conduite plus ou moins suivies. Il définit un « conformisme » social de classe ou de groupe, voire de masses (subalternes en ce cas). Il est en rapport à la fois avec la fonction dans la production propre à ces communautés dans une société donnée et avec les stratégies hégémoniques possibles afférentes à cette position qui a alors sens quasi militaire. Cette position peut être, en effet, tenue ou non avec conscience et même avec un savoir relatif de ses possibilités hégémoniques : elle peut être assimilée à un destin subi dans la passivité, la conscience étant occupée par des éléments d’un sens commun traditionnel prêchant la résignation ; elle peut inversement être la base de départ pour une expansion graduelle en développant ses thématiques modernes, économiques et politiques, et envisager une universalisation quantitative à la majorité de la société, une assimilation des couches les plus larges de cette société dans un conformisme supérieur.
Par sa conception personnelle du monde on appartient toujours à un regroupement déterminé et précisément à celui de tous les éléments sociaux qui partagent un même mode de penser et d’opérer. On est les conformistes d’un conformisme quelconque, on est toujours hommes-masses ou hommes-collectifs. La question est la suivante : de quel type historique est le conformisme, l’homme-masse dont on fait parti ? Quand la conception du monde n’est pas critique et cohérente mais occasionnelle et désagrégée, on appartient simultanément à une multiplicité d’hommes-masse, la personnalité individuelle de chacun est composite de manière bizarre : se trouvent en elle des éléments de l’homme des cavernes et des principes de la science la plus moderne et avancée, des préjugés de toutes les phases historiquement grossièrement localistes et des intuitions d’une philosophie à venir telle que sera celle du genre humain unifié mondialement (Q.11, 11, 1377).
Le sens commun des masses subalternes modernes est particulièrement divisé en ce qu’il est marqué par la non contemporanéité de ses éléments ; cette dernière se révèle en ses potentialités opposées. D’une part, il contient des éléments progressistes qui expriment la plus complète modernité et qui définissent leur originalité historique par rapport aux classes dirigeantes. D’autre part, il inclut des éléments « anachroniques », des superstitions religieuses, des croyances magiques, des habitudes de vie provinciales et mesquines, des comportements de soumission au clergé réactionnaire ou aux élites foncières du passé, des aptitudes à l’obéissance à l’ordre capitaliste dominant qui impose et fait vivre comme rationnelles les formes d‘exploitation. Cette contradiction du sens commun des masses empêche « l’homme actif de masse » qui « opère pratiquement » de parvenir à « la claire conscience théorique de son mode d’opérer qui est cependant une connaissance du monde dans la mesure où il en est la transformation. Sa conscience théorique peut être historiquement en contraste avec son mode d’opérer » (Q. 11, 12, 1385). La philosophe de la praxis est la conception du monde qui conduit la critique de cette contradiction et qui en fait une partie de sa constitution théorique : elle intervient à la base comme réforme intellectuelle et morale du sens commun des subalternes qui sont aussi intellectuellement des « simples » opposés aux « intellectuels » des classes dirigeantes et dominantes, mais ces simples peuvent pour la première fois dans l’histoire devenir intellectuels et dirigeants à leur tour.
On peut quasiment dire que l’homme-masse a deux consciences théoriques (ou une conscience contradictoire), une qui est implicite dans son mode d’opérer et qui réellement l’unit à ses collaborateurs dans la transformation pratique de la réalité et une autre superficiellement explicite ou verbale qu’il a hérité du passé et accepté sans critique. Cette conception “verbale” n’est pas cependant sans conséquence : elle le relie à un groupe social déterminé, elle influe dans sa conduite morale, dans l’orientation de la volonté, de manière plus ou moins énergique, au point d’en arriver à cette extrémité où le caractère contradictoire de la conscience ne permet aucune action, aucune décision, aucun choix et produit un état de passivité morale et politique (Q. 11, 12, 1385).
La philosophie de la praxis est la réforme du sens commun des subalternes en un nouveau sens commun ou « bon sens » qui peut se développer comme un devenir populaire de la conception du monde inspirée par la philosophie de la praxis – laquelle maintient sa spécificité « technique » et son effort d’élaboration supérieure dans la haute culture. Cette réforme se vit sous une forme moléculaire comme un socratisme pratique et politique, un « connais-toi toi-même » lorsque l’individu dans sa biographie cesse de « préférer “penser” sans en avoir conscience », « de “participer” à une conception du monde “imposée” mécaniquement par le milieu extérieur, c’est-à-dire par un des nombreux groupes sociaux en lesquels chacun est impliqué automatiquement dès son entrée dans le monde conscient » (Q.11, 12, 1376). Elle est une conversion théorique et pratique, une catharsis individuelle qui doit se faire collective. Il devient possible de sortir de sa propre stupidité et de son impuissance et d’« élaborer sa propre conception du monde de manière consciente et critique, et donc en connexion avec le travail de son cerveau, de choisir sa propre sphère d’activité, de participer activement à la production de l’histoire du monde, d’être le guide de soi-même, et non d’accepter passivement et subrepticement de l’extérieur l’empreinte imposée à sa propre personnalité » (Q. 11, 12, 1376).
Au plan collectif ce socratisme prend la forme d’une élaboration philosophique qui a pour but immanent de critiquer la conception du monde dominante même au sein du groupe subalterne, d’en produire une autre plus unitaire et cohérente et de « l’élever jusqu’au point auquel est parvenu la pensée mondiale la plus avancée ». Sens commun réformé ou non, conception du monde des classes dirigeantes et des masses subalternes sont des moments internes de la philosophie de la praxis qui tous font histoire et sont politiques, tous sont politiques et histoire. La réforme du sens commun est aussi réforme et constitution de la philosophie de la praxis dans la mesure où se forme en elle « la conscience de son historicité, de la phase de développement qu’elle représente et du fait qu’elle est en contradiction avec les autres conceptions ou avec des éléments des autres conceptions. Sa propre conception du monde répond à des problèmes déterminés posés par la réalité qui sont déterminés et “originaux” dans leur actualité » (Q. 11, 12, 1377).
C’est le passage du sens commun (ici des subalternes) à la philosophie (ici de la praxis) et de la philosophie au sens commun qui est le centre de continuum qui se fait cercle en mouvement. « Ce passage est assuré par la politique » (Q. 11, 12, 1382). Concrètement il s’agit d’« élaborer une philosophie qui disposant d’une diffusion ou d’une diffusivité parce que liée à la vie pratique et implicite en elle devient un sens commun renouvelé avec la conscience et le nerf des philosophies individuelles ». Il ne s’agit donc pas à partir de cette critique du sens commun et du monde culturel existant d’« introduire ex novo » de manière intellectualiste et extérieure « une science dans la vie individuelle de “tous”, mais d’innover et de rendre “critique” une activité déjà existante » qui est le fait d’intellectuels spécialisés qui se constituent alors en « pointes avancées » du progrès du sens commun des subalternes et partagent la perspective potentiellement hégémonique de ces masses et la traduisent en formant au sein des masses des intellectuels spécialisés, en gardant le contact avec les contenus du sens commun qui sont liés aux problèmes historiques actuels.
C’est ce passage politique qui doit mettre en contact pour le réformer le sens commun des masses et qui universalise et affine la conception du monde élaborée par des intellectuels qui sont du côté des masses ou émergent de leur sein. Mais ces intellectuels doivent se laisser instruire par ce que le sens commun des masses précisément sent et ne comprend pas adéquatement et qu’eux-mêmes ne peuvent comprendre qu’à la condition de le sentir. La question du rapport entre sens commun et conception du monde supérieure se déplace ; elle se pose comme question du rapport entre la masse des simples et une élite d’intellectuels spécialisés dans l’organisation théorique et politique des masses. C’est ici que nous rencontrons une ultime équation de notre continuum, celle qui dérangeait et inquiétait Althusser : sens commun (rénové) = conception du monde (supérieure) = nouvelle religion (laïque) = idéologie = politique.
La religion laïque au sein du continuum idéologique : une énigme ou une issue logique ?
La complexité du continuum idéologique gramscien apparaît, en effet, dans la différence qui se marque entre deux séries ordonnées de lemmes mis en équations. D’une part, on a l’équation générale existante de fait entre philosophie au sens traditionnel = conception du monde dominante = religion traditionnelle = idéologie au sens à la fois péjoratif et positif = politique comme hégémonie d’une classe dominante. D’autre part, on a l’équation singulière à construire entre philosophie de la praxis comme couronnement de l’histoire de la philosophie, conception du monde intégrale et totale des subalternes, religion laïque de la liberté unissant simples et intellectuels, idéologie comme forme positive de pensée et de conduite en lutte hégémonique avec les autres idéologies historique, politique comme hégémonie des subalternes tendant à unifier l’humanité. C’est sur la présence et la fonction de la religion qu’il nous faut insister pour tester l’originalité de l’historicisme gramscien et aborder la question des rapports entre vérité, politique et idéologie que nous avons laissée en suspens depuis la critique althussérienne.
Pour y voir clair il faut, comme nous y invite l’entrée « religion » du Dizionario Gramsciano, rédigée par Tomaso La Rocca[10], distinguer trois définitions de la religion selon Gramsci, toutes dominées par la référence au christianisme.
- La première définition concerne la religion au sens chrétien traditionnel. Elle réunit trois éléments : « 1) la croyance qu’existent une ou plusieurs divinités transcendant les conditions terrestres et temporelles ; 2) le sentiment des hommes de dépendre de ces êtres supérieurs qui gouvernent totalement la vie du cosmos ; 3) l’existence d’un système de rapports (culte) entre les hommes et les dieux » (Q. 6, 41, 715). Empruntée à Turchi, un historien des religions, cette définition est trop large et inclut des idéologies sociales non religieuses.
- La seconde définition a pour objet ce que Gramsci nomme religion laïque dont l’interprète principal est Croce qui défend la possibilité et la dignité accomplie d’une vie sensée dans l’immanence, dépourvue de toute croyance en une transcendance divine et toute soumission aux Églises. La religion désigne « l’unité de foi entre une conception du monde et une norme de conduite conforme », mais Gramsci interroge : ne faut-il pas alors « affirmer que la religion laïque comme unité de foi pourrait se nommer tout aussi bien “idéologie” ou “politique” » ? (Q. 11, 12, 1378).
- La troisième définition est celle que Gramsci présente comme la sienne. Elle fait de la religion un élément du sens commun, susceptible de varier avec les métamorphoses de ce dernier, mais toujours en contraposition relative.
« La philosophie est un ordre intellectuel, c’est-à-dire ce que ne peuvent être ni la religion, ni le sens commun. Voir comment dans la réalité religion et sens commun ne coïncident pas ; mais la religion est un élément du sens commun, désagrégé. [...] La philosophie est la critique et le dépassement de la religion et du sens commun et en ce sens elle coïncide avec le “bon sens” qui s’oppose au sens commun ». (Q. 11, 12, 1378).
Les deux définitions non gramsciennes, la première surtout, sont souvent l’objet d’une critique qui doit beaucoup à la critique de Marx. Cette critique a reçu une expression typique dans un article du 19 août 1920 intitulé « Socialisti e cristiani »[11]. Gramsci ne reviendra jamais sur cette critique.
Les socialistes marxistes ne sont pas religieux : ils croient que la religion est une forme transitoire de la culture humaine qui sera dépassée par une culture supérieure, la culture philosophique ; ils croient que la religion est une conception mythologique de la vie et du monde qui sera dépassée et remplacée par une conception qui pose et recherche au sein même de la société humaine et dans la conscience individuelle les causes et les forces qui produisent et créent l’Histoire. Mais tout en n’étant pas religieux, les socialistes marxistes ne sont pas davantage antireligieux ; l’État ouvrier ne persécutera pas la religion : l’État ouvrier demandera aux prolétaires chrétiens la loyauté que tout État ouvrier demande à ses citoyens, il leur demandera que s’ils veulent être dans l’opposition, cette opposition soit constitutionnelle et non révolutionnaire.
Sur le plan théorique, la philosophie de la praxis se caractérise par une intransigeance critique inflexible : elle insiste sur l’impossibilité de réconcilier une conception transcendante, surnaturaliste, avec la philosophie de la praxis. Elle critique de même la religion laïque de la liberté chère à Croce qui se veut pourtant immanentiste et historiciste : cette religion aboutit à fétichiser en idées quasi platoniciennes des principes comme celui de la Liberté supposée être le sujet éternel de l’histoire et voué à s’incarner adéquatement dans l’État libéral. Gramsci se bat sur les deux fronts de la religion ici définis. Il récuse comme formes de métaphysique tous les dualismes entre âme et corps, matière et esprit, structure et superstructure, homme et nature, masses et intellectuels, société civile et État. La religion peut se nicher comme l’idéalisme métaphysique ou le matérialisme mécaniste en chacun de ces dualismes pour fétichiser un terme ou un autre. Cette intransigeance théorique culmine dans la thèse radicale que la religion est une utopie qui demeure inévitable historiquement et aujourd’hui encore pour autant qu’« il a y toujours eu une grande partie de l’humanité dont l’activité a toujours été taylorisée et rigidement disciplinée et a cherché de s’évader par l’imagination et le rêve des limites étroites de l’organisation existante qui l’écrasait. La plus grande aventure, la plus grande “utopie” que l’humanité a créée collectivement, la religion, n’est-elle pas un mode d’évasion hors du “monde terrestre” ? N’est-ce pas en ce sens que Balzac parle du loto comme d’un opium de la misère, phrase reprise ensuite par d’autres ? » (Q. 21, 13, 2152). Ce texte de la dernière phase de rédaction des Cahiers reprend un texte plus ancien du Cahier 6, 28, 706, où sont cités Marx et la formule de la religion opium du peuple).
Cette thèse est constante, mais elle n’est pas que négative : il y a une valeur philosophique de l’utopie qui tout à la fois recèle un contenu de vérité et une valeur politique. L’utopie, religieuse ou non, est manifestation des contradictions qui déchirent la société et aussi tentative inadéquate de résolution. Cette position est affirmée avec vigueur dans le Cahier 4, 45, 472 et reprise dans le Cahier 11 : la philosophie de la praxis s’oppose à la religion et aux métaphysiques comme à des figures de la même fonction d’utopie. Ce qui unit la religion et ces philosophies, c’est l’utopie d’un autre monde où règne le Dieu de justice et où s’épanouissent l’idée de « l’homme en général » ou de « nature humaine ».
La religion est la plus gigantesque utopie, c’est-à-dire la plus gigantesque [le Cahier 4 dit « mastodontique »] “métaphysique” apparue dans l’histoire parce qu’elle est la tentative la plus grandiose de concilier sous forme mythologique les contradictions de la vie historique ; elle affirme, en vérité, que l’homme a la même “nature”, qu’existe l’homme en général, en tant que créé par Dieu, fils de Dieu, et donc frère des autres hommes, égal aux autres hommes, libre au milieu des autres hommes et comme eux, et qu’il peut se concevoir comme tel en se réfléchissant en Dieu, “autoconscience” de l’humanité, mais elle affirme aussi que tout cela n’est pas de ce monde, mais d’un autre monde (utopique). Ainsi les idées d’égalité, de fraternité, de liberté fermentent parmi les hommes, en ces couches d’hommes qui ne se voient ni égaux, ni frères des autres hommes, ni libres par rapport à eux. Ainsi est-il advenu qu’en tout soulèvement radical des multitudes, d’une manière ou d’une autre, sous des formes et des idéologies déterminées, aient été posées ces revendications (Q. 11, 62, 1489).
De ce point de vue, le droit naturel moderne est aussi une utopie, il exprime des aspirations profondes des masses mais il tend à se faire politique. Il existe une dimension utopique à la fois dans le contenu de la religion populaire – les hérésies médiévales – et les élaborations du rationalisme abstrait qui sont de dérivation religieuse et peuvent donner lieu à des religions politiques, comme l’utopie de « la religion de la liberté » chère à Croce – qui pourtant entend par son historicisme spéculatif se dégager du rationalisme abstrait des Lumières. La philosophie de la praxis une fois encore se constitue sur plusieurs fronts : son appréciation historique et critique de l’utopie a une triple orientation. Elle va des idéologies philosophiques les plus sophistiquées, de l’utopie démocratique du droit naturel moderne et de la théorie de la nature humaine, aux idéologies métaphysiques traditionnelles de l’esprit. Elle dérive de ces deux formations de la religion populaire et de son utopie. Elle s’oppose à tout le complexe des philosophies, des religions et du sens commun religieux classé sous la rubrique « utopie ». Elle fait davantage et elle est seule à faire cela : elle enracine tous ces cas dans l’analyse détaillée des contradictions d’une réalité historique déchirée. Elle substitue à ces utopies une représentation unifiée qui identifie les termes potentiellement résolutoires de ces contradictions dans les forces qui doivent purifier leur sens commun pour devenir hégémoniques en contribuant à élaborer une conception du monde résolument politique et laïque. Machiavel est l’exemple de cette politique : il critique les utopies moralistes et religieuses pour identifier dans la création d’un État national-populaire la tâche historique immanente qui dans le présent immédiat demeure encore utopique. La philosophie de la praxis est confrontée à une tâche politique de plus grande envergure et autrement épocale en ce qu’elle a pour horizon l’assimilation des masses subalternes dans un système d’institutions éthico-politique en prise sur la rationalisation démocratique de la production et sur le devenir actif du plus grand nombre. Là est son utopie auto-critique et réaliste.
Ce système qui se veut total et tendanciellement unifié à partir de la capacité à résoudre les contradictions que peuvent manifester en s’organisant des forces qui sont des termes de ces contradictions. Les autres philosophies, religions et idéologies, sont aussi des termes pris dans ces contradictions, mais elles n’ont pas cette capacité théorique et pratique qui n’est pour l’instant que potentielle et prise en un devenir non garanti. Nous retrouvons un texte connu. Achevant et réformant la dialectique de Hegel :
La philosophie de la praxis est une philosophie libérée (ou qui cherche à se libérer) de tout élément idéologique unilatéral et fanatique, elle est la pleine conscience des contradictions dans lesquelles le philosophe lui-même, compris individuellement ou compris comme groupe social, non seulement comprend les contradictions mais se pose lui-même comme élément de la contradiction, élève cet élément au rang de principe de connaissance et d’action.
Tant qu’existent des contradictions la philosophie de la praxis est liée à la nécessité, à un monde historique où les idées et les idéaux ne sont pas réalité. Le principe de connaissance d’action oblige à l’analyse de ces contradictions et à la recherche des stratégies capables de les résoudre. L’effet de vérité de ces connaissances est inséparable de l’effet de pouvoir et inversement. On peut affirmer qu’une fois ses contradictions résolues, se produira le règne de la liberté comme règne de la pensée. Nous sommes bien loin de cette situation uchronique : « Actuellement le philosophe (de la praxis) ne peut seulement que faire cette affirmation générique et il ne peut pas aller plus loin : de fait il ne peut pas s’évader du terrain actuel des contradictions, il ne peut pas affirmer autrement que de manière générique un monde sans contradictions, sans créer immédiatement une utopie » (Q. 11, 62, 1487-8 reprise de Q. 4, 41, 471-2).
Nous sommes ici entrés dans le vif de la conception gramscienne de la religion comme sens commun. Toute l’analyse concernant le sens commun devrait, semble-t-il, confirmer sa pertinence. La religion devrait être prise dans le cercle transformateur du continuum idéologique : il s’agirait de rendre du moins autocritique la culture religieuse populaire existante en partant d’elle définie comme sens commun ou savoir désagrégé, stratifié et métaphysique, sans envisager pour autant sa résorption immédiate dans la philosophie qui conduit la critique, sans non plus faire de la philosophie de la praxis une philosophie du christianisme. Si on donne à la religion des masses populaires une place dans le sens commun, que peut-être sa forme réformée en « bon sens » ? Sa forme ne peut être qu’une forme dotée d’une forte dimension politique dans la mesure où la masse d’abord inconsciente et désorganisée doit articuler sa conscience religieuse propre aux tâches qui font d’elle un acteur conscient de ses objectifs de transformation. Elle doit être confrontée à la critique du sens commun en tenant compte des formes nécessairement plurielles de religion et en intégrant dans la politique l’élément de laïcité exigible.
Cet élément n’est pas pur : il ne s’obtient pas nécessairement par le moyen d’une critique rationaliste de la religion et de la transcendance, mais il se développe par l’exploitation de cette expérience, qui est expérience de vérité minimale, ressentie en personne, que font « les simples » dans l’immanence, expérience de leur fonction proprement moderne dans la vie sociale d’acteur possible dans la production et la politique. « La conscience d’être partie d’une force hégémonique déterminée (c’est-à-dire la conscience politique) est la première phase pour une autoconscience ultérieure et progressive en laquelle théorie et pratique finalement s’unifient » (Q. 11,12, 1385).
Cette conscience se forme avec des hauts et des bas. Elle n’est jamais acquise. D’une part, elle peut être une simple foi qui commande l’exercice de la volonté en des situations de soumission et de défaite et elle « se transforme en acte de foi, en une certaine rationalité de l’histoire » qui est « un substitut de la prédestination, de la providence » (Q. 11,12, 1388). D’autre part, cette foi peut se transformer en foi raisonnée dans ses capacités politiques. Elle s’élève, en effet, quand « le subalterne devient dirigeant et responsable de l’activité économique de masse » : il transforme son sens commun quasi providentialiste et passif en un bon sens, de celui qui est devenu un peu « protagoniste, qui a cessé d’être une chose et devient “ une personne” historique » responsable. Il n’est plus seulement celui qui a foi dans une hégémonie à venir, qui ne peut que faire acte de résistance aux volontés extérieures. Il est devenu « un agent, et nécessairement actif et entreprenant ». Cette catharsis du résistant passif et fidéiste en protagoniste actif et agent capable d’entreprise raisonnée est fragile, certes, et doit être reproduite indéfiniment. Mais elle est décisive. Elle est la traduction pratique de l’intervention théorique de la philosophie de la praxis dans la vision du monde du déterminisme mécaniste et elle contribue à l’élaboration de la théorie du bloc historique.
Ainsi une religion de subalternes – le marxisme déterministe mécaniste devenu sens commun et vécu comme analogue à la croyance religieuse en la prédestination – laisse place à un sens commun « religieux » renouvelé. Il devient possible aux subalternes de transformer leur religion passive où domine la foi sur l’argumentation rationnelle en une religion plus active qui rend raison historiquement de sa foi et la transforme peu à peu en conception du monde plus immanente, plus laïque, plus politique – que l’on peut d’abord nommer avec Croce religion de la liberté. Gramsci n’accepte pas cette appellation ; il entend la radicaliser et la laïciser à son point maximal de rupture avec le sens commun comme religion des masses subalternes, en la transformant en « hérésie de la religion de la liberté » dont le propre est d’unir simples et intellectuels dans le même cercle de modifications corrélatives au sein d’une conception du monde intégrale. Croce entend que la philosophie soit pensée comme la vérité de la religion et que la religion de la liberté, laïque, immanente et historiciste soit pensée comme philosophie du christianisme purifié de sa tentation théologico-politique. Gramsci critique cette religion crocéeenne comme moment et aspect du christianisme passé, récent et contemporain, en particulier du catholicisme : « Toute religion est une multiplicité de religions » (Q. 11, 13, 1397) et chacune exige la même critique et le même dépassement que celui qui a été déjà précisé à propos du rapport entre philosophie et sens commun en général puisque « la philosophie est la critique et le dépassement de la religion et du sens commun » (Q. 11, 12, 1378).
La religion de la liberté pose, en effet, un problème spécifique en ce que la critique que Gramsci lui inflige fait apparaître que sa supériorité relative s’inverse en défaut rédhibitoire : elle n’est pas capable paradoxalement d’affronter et de résoudre le problème que le catholicisme a su du moins poser : produire « une unité de foi entre une conception du monde et une norme de conduite conforme ». Le christianisme en tant que catholicisme reçoit alors une valeur historique et sociale inattendue : il a compris l’importance du rapport étroit qu’il faut maintenir entre religion pratique des simples et religion des intellectuels de la hiérarchie. Ce rapport doit être pensé et traduit dans la mesure où il traite la question des rapports entre politique et sens commun, c’est-à-dire le problème des rapports entre mouvement ouvrier – parti prince moderne – État éthico-politique. C’est sur ce terrain que l’hérésie de la religion de la liberté se constitue.
L’expression d’hérésie de la religion de la liberté est en fait rare dans les Cahiers. Elle intervient dans la critique de Croce qui poursuivie dans les trois séries des Appunti di Filosofia (Cahiers 4, 7, 8) se concentre dans le Cahier 10 I, 13, 1238. L’expression a pour fonction de discuter avant tout de l’Histoire de l’Europe au XIXe siècle que Gramsci lit avec passion en 1932 dès sa publication partielle par Croce. Il en tire pour la reformuler la notion d’histoire éthico-politique après avoir montré que Croce contredit son immanentisme et son historicisme en réduisant toute l’histoire sous une formule générique empruntée à Hegel. L’hérésie gramscienne consiste dans le refus de ce mode générique de penser l’histoire, mais aussi dans la reprise qui est reformulation de l’idée crocienne d’une histoire éthico-politique, articulée à la compréhension des rapports de force définissant le bloc historique et identifiant sans déterminisme mécaniste, l’hégémonie. Croce est ici d’une aide précieuse, en effet, en ce qu’il permet d’introduire des « éléments d’histoire éthico-politique dans la philosophie de la praxis : concept d’hégémonie, réévaluation du front philosophique, étude systématique de la fonction des intellectuels dans la vie étatique et historique, doctrine du parti politique comme avant-garde de tout mouvement historique progressif » (Q. 10 I, 13, 1235-6). Mais Croce compromet ces apports en ce que sa conception de l’histoire demeure spéculative c’est-à-dire non complètement historiciste, insuffisamment immanentiste.
Gramsci lui adresse deux critiques importantes qui permettent en contre-champ de mieux préciser son propre historicisme et son propre immanentisme qui définissent l’hérésie qu’il injecte dans la religion de la liberté pour la transformer en une conception du monde plus conforme aux possibilités et aux tâches des subalternes.
- Tout d’abord Croce érige en absolu spéculatif un principe général, la liberté, qui devient malgré l’historicisme affiché, sinon une idée éternelle quasi platonicienne, du moins une métacatégorie transhistorique.
Cette généralité abstraite conduit à réduire l’histoire à la lutte éternelle entre ce principe et un autre principe contraire, le principe d’autorité. Croce rend ainsi indistincte l’histoire en annulant ses conditions, ses formes complexes et ses luttes spécifiques en une gigantomachie abstraite de principes opposés. Il ne rend pas compte des raisons de la victoire de ce principe de liberté ou plutôt il fait croire que ce principe avait en lui-même par ses propriétés logiques le pouvoir miraculeux de devenir hégémonique.
S’il était vrai de manière aussi générique que l’histoire du XIXe siècle avait été histoire de la liberté, toute l’histoire précédente aurait été de manière tout autant générique histoire de l’autorité ; tous les siècles précédents auraient été de la même couleur grise et indistincte, sans développement, sans lutte. Il y a plus : un principe hégémonique (éthico-politique) triomphe après voir vaincu un autre principe (et après l’avoir subsumé comme son moment dirait de fait Croce). Mais pourquoi aura-t-il vaincu ? Par ses dons intrinsèques de caractère “logique” et rationnel abstrait ? Ne pas rechercher les raisons de cette victoire signifie faire une histoire extérieurement descriptive, sans mise en évidence des rapports nécessaires et causaux (Q. 10 I, 11, 1236).
Les principes éthico-politiques sont multiples et si la lutte entre eux est réelle et peut se concentrer autour de deux principes, s’il y a bien lutte entre deux « religions » qui sont des éléments de l’effectivité historique, il est théoriquement improductif et pratiquement dangereux de se borner à « décrire l’expansion triomphale de l’une d’entre elles « alors qu’il s’agit aussi “de la justifier historiquement” ».
- Ces considérations sur l’abstraction anhistorique et sur le caractère amorphe de la religion de la liberté sont en fait acceptées par Croce malgré lui dans la mesure où il est obligé de prendre acte du fait que la religion de la liberté s’incarne dans des institutions politiques et se réalise en combinaison avec les formes de « religion populaire » comme le nationalisme qui est lui-même pris en combinaison avec le catholicisme.
Ces combinaisons qui pouvaient contredire le principe de liberté ont été combattues par Croce lui-même qui leur a opposé l’universalité abstraite du principe. Croce n’est pas parvenu à élaborer un concept d’histoire non spéculatif parce que chez lui « l’histoire éthico-politique fait abstraction du concept de bloc historique dans lequel le contenu économique social et la forme éthico-politique s’identifient concrètement dans la reconstruction des diverses périodes historiques (Q. 10 I, 11, 1237). La religion de la liberté présuppose un concept d’histoire réduit à « la présentation polémique de “philosophèmes” plus ou moins intéressants, mais elle n’est pas histoire ». « L’histoire de Croce représente des “figures” désossées, sans squelette, aux chairs molles et tombantes aussi sous le fard des ornements littéraires de l’écrivain » (Q. 10 I, 11, 1238). Cette histoire est en fait une histoire politique, libérale, de combat. Elle se pare d’une éternité méta-historique alors qu’en fait elle intervient et se résout comme politique sur un triple front : elle est opposée au conservatisme catholique, au socialisme et au communisme, au fascisme, à toutes ces « religions » invitées à se laisser métaboliser par le libéralisme éthico-politique de Croce. Ce dernier est la forme théorique de la révolution passive que le libéralisme entend conduire sans s’identifier trop vite au libéralisme économique, pour mieux convaincre les subalternes de son caractère indépassable et les arracher tout à la fois au communisme menaçant et au fascisme dominant, l’un et l’autre étant présentés comme deux religions ennemies, mais le fascisme étant en fait pire comme une anti-religion quasi diabolique.
L’hérésie de la religion de la liberté et ses traductions : du cercle entre le sentir des simples et le comprendre des intellectuels à l’institution du partir politique d’État
On peut alors en venir à la proposition gramscienne : « Avec le langage de Croce on peut dire que la religion de la liberté s’oppose à la religion du Syllabus, qui nie en bloc la civilisation moderne ; la philosophie de la praxis est une “hérésie” de la religion de la liberté parce qu’elle est née sur le même terrain de la civilisation moderne » (Q. 10, 1, 13,1238). En quoi réside l’hérésie ? Non pas d’abord dans une sécularisation des contenus chrétiens, ce qui aboutirait à faire de la philosophie de la praxis une captation gnostique du christianisme et de ses thèmes – incarnation, rédemption, messianisme laïque, eschatologie de la fin des temps – comme Karl Lowith le reproche à Marx et à Ernst Bloch qui serait sur ce point son interprète fidèle. Gramsci souligne que l’hérésie est une autre conception du monde qui réaffirme la critique fondée sur l’immanence et l’historicisme, non une philosophie post-chrétienne du christianisme. Ce qui définit l’hérésie, c’est la forme institutionnelle totalement politique de la religion en tant que conception du monde, c’est son aptitude à hériter de la promesse de la modernité : l’assimilation des masses à un degré supérieur de culture et la réduction de l’opposition entre gouvernants et gouvernés, simples et intellectuels, foi passive, imposée, et compréhension active et réfléchie de soi et du monde.
Reprenons une ultime fois un de ces textes synthétiques qui formulent la question en mettant en jeu tous les lemmes de la proposition gramscienne :
En ce point se pose le problème fondamental de toute conception du monde, de toute philosophie qui est devenue un mouvement culturel, une “religion”, une “foi”, c’est-à-dire qui ait produit une activité pratique et une volonté et qu’en elles soit contenue comme “prémisse” théorique implicite (une “idéologie”, pourrait-on dire si au terme d’idéologie on donne la signification plus élevée d’une conception du monde qui se manifeste implicitement dans l’art, dans le droit, dans l’activité économique, en toutes les manifestations de vie individuelles et collectives), c’est-à-dire le problème de conserver l’unité idéologique, en tout le bloc social qui précisément est cimenté et unifié par cette idéologie déterminée. La force des religions et spécialement de l’église catholique a consisté et consiste en ce qu’elles sentent énergiquement la nécessité de l’unité doctrinale de toute la masse “religieuse” et qu’elles luttent pour que les couches intellectuellement supérieures ne se détachent pas des inférieures. L’église romaine a toujours été la plus tenace dans la lutte pour empêcher qu’”officiellement” se forment deux religions, celle des “intellectuels” et celle des “âmes simples” (Q. 11, 12, 1380-1).
La production de cette unité idéologique a été manquée par les philosophies idéalistes immanentistes et par tous les mouvements qui se sont inspirés de la Renaissance – qui fut pourtant un sommet de haute culture.
Elle ne s’est pas transformée en une nouvelle Réforme qui, elle, fut un mouvement populaire réel mais initialement incapable de s’élever comme sommet en philosophie. Cette dualité entre Renaissance et Réforme s’est reproduite dans la suite de l’histoire moderne. Les Lumières françaises et la Révolution de 1789 ont réussi à un moment à élever la culture populaire des simples et les intellectuels ont, à autre un moment, assimilé les aspirations populaires. Le jacobinisme représente ce point haut, mais avec la Restauration cette unité a été brisée. Par contre l’idéalisme allemand – de Kant à Fichte et à Hegel – actualise une figure inverse : il fait franchir à la haute culture un seuil philosophique jamais atteint, mais sans pouvoir se traduire en force politique auprès des simples pris dans la misère politique allemande.
Marx est une étape décisive dans la haute culture et éclaire la possibilité objective d’une transformation des masses prolétariennes. La synthèse de haut niveau qu’il a produit s’est cependant disloquée : la réforme de masse s’est accomplie comme diffusion d’une vulgate matérialiste déterministe qui stérilise le marxisme-léninisme officiel mais peine à transformer le sens commun des masses en héritant du passé. Lénine a bien élevé la nouvelle conception à son maximum de politicité, sans en mesurer ni penser cependant la dimension de conception du monde supérieure qui est immanente à sa politique. En Occident l’œuvre de Marx a été traduite, filtrée par l’idéalisme italien qui en a utilisé certains éléments pour se rajeunir et développer son hégémonie dans la haute culture ; celle-ci défend avant tout et à divers titres l’hégémonie des classes dirigeantes. Elle a donné un coup d’arrêt à l’assimilation des masses en les maintenant dans une forme de nouvelle « simplicité » à laquelle elles consentent et qui les empêche de comprendre les enjeux historiques et politiques et les rend passives.
La question de l’appareil d’hégémonie scolaire est le test : les penseurs idéalistes qui se veulent laïques ont accepté le Concordat avec le Vatican qui condamne les masses à n’accéder qu’à un enseignement primaire livré à l’Église et les expose à l’inculcation de la métaphysique traditionnelle et de sa thèse d’une nature humaine immuable et pécheresse. Les intellectuels traditionnels qui se veulent modernes – Croce et Gentile – ont manifesté la faiblesse radicale de leur conception du monde : « ne pas avoir su créer une unité idéologique entre le bas et le haut, entre les “simples” et les “intellectuels” ». Il s’agit alors pour la nouvelle force subalterne de produire ses propres intellectuels à partir de leur fonction dans la société de production, de les éduquer à prendre en compte « la volonté des simples de s’élever à une forme supérieure de culture et de conception du monde », à interpréter et comprendre ce qu’ils sentent sans le comprendre, d’établir le cercle du sentir et du comprendre. Les intellectuels nouveaux de ces masses ne peuvent exister socialement qu’en s’organisant politiquement en un parti politique qui rendra cohérents les principes et les problèmes que ces masses posent par leur activité pratique, en constituant ainsi un bloc culturel et moral. Le parti politique est un appareil décisif :
Dans le travail d’élaboration d’une pensée supérieure au sens commun et scientifiquement cohérente il n’oublie jamais de demeurer au contact des “simples” et trouve en contact la source des problèmes à étudier et à résoudre. C’est seulement par ce contact qu’une philosophie devient “historique”, s’épure des éléments intellectualistes de nature individuelle et se fait “vie” (Q. 11, 12, 1382).
Il ne fait pas de doute que ce travail d’élaboration circulaire exige la formation d’intellectuels de type nouveau, d’une nouvelle élite, démocratique, capable de comprendre, d’assimiler et de rectifier tout à la fois ce que les masses sentent dans leur position sociale et culturelle, afin que les couches populaires puissent produire l’effet d’hégémonie en assimilant cette haute culture. Cette assimilation pose de nouveaux problèmes qu’il faudra sentir et comprendre à leur tour dans ce cercle pédagogique qui est la condition de possibilité vitale de la transformation du continuum idéologique. Il faut penser la nécessité régissant chaque mouvement culturel qui tend à substituer le sens commun et les vieilles conceptions du monde : « travailler incessamment pour élever intellectuellement des couches populaires toujours plus vastes, c’est-à-dire pour donner une personnalité à l’amorphe élément de masse, ce qui signifie travailler à susciter des élites d’intellectuels d’un type nouveau qui surgissent directement de la masse tout en demeurant en contact avec elle pour devenir les armatures du corset » (Q. 11, 12 , 1392).
On pourrait croire alors que l’analogie du rapport entre masses et élites intellectuelles spécifiques organisée en parti politique avec le rapport entre simples fidèles et église hiérarchique ne soit pas tant la sécularisation complète de la religion qu’une version modifiée d’une pensée catholique dont la philosophie hérite et dit la vérité sans être son autre, en demeurant dans son horizon de pensée qui est celui d’une transcendance politique d’organisation et non pas une immanence d’appareil hégémonique. La philosophie de la praxis serait alors un catholicisme cryptique que les penseurs catholiques pourraient considérer comme une déviation païenne totalitaire, une hérésie néfaste au sens religieux strict du terme. Comment interpréter, en effet, ce texte fameux du Cahier 13 qui reprend Machiavel, formule la théorie du parti communiste comme prince moderne et qui identifie le continuum idéologico-politique comme son terme final (et donc inaugural d’un nouveau cycle) ? La philosophie de la praxis est-elle une religion politique qui témoignerait de l’impossibilité d’une sécularisation laïque puisqu’elle reposerait sur le transfert indépassé d’un schéma d’organisation religieuse sur le dynamisme de la politique ?
Une partie importante du Prince moderne devra être consacrée à la question d’une réforme intellectuelle et morale, c’est-à-dire à la question religieuse ou à une conception du monde ». Celle-ci ne doit pas être seulement en négatif la fin de la lutte des classes et de l’exploitation des masses et en positif la création d’une hégémonie fondée sur un État éthico-politique élargi à une société civile transformée. « La réforme intellectuelle et morale a en définitive pour but immanent la création du terrain pour un développement ultérieur de la volonté collective nationale populaire orientée vers l’accomplissement d’une forme supérieure et totale de civilisation moderne (Q. 13, 1, 1560).
La modernité s’achèverait alors en un métacatholicisme fondé sur une réforme intellectuelle et morale qui accomplit à la fois la Réforme, œuvre des simples et des masses, et la Renaissance, œuvre de la haute culture et de ses intellectuels d’élite.
On pourrait ainsi se demander sur ce point si Marx et le marxisme sont ici accomplis comme pensée-action politique de la lutte révolutionnaire des classes subalternes ou plutôt déplacés comme théorie de la modernité laïque définie par la religion politique et sa culture. Cette question trouve sa légitimité dans le texte qui achève le paragraphe 1 du Cahier 13 :
Le Prince moderne, en se développant, bouleverse tout le système des rapports intellectuels et moraux en tant que son développement signifie précisément que tout acte est conçu comme utile ou dangereux, comme vertueux ou scélérat en tant qu’il a comme point de référence le Prince moderne lui-même et sert à accroître son pouvoir ou à lui être contraire. Le Prince prend la place, dans les consciences, de la divinité ou l’impératif catégorique, il devient la base d’un laïcisme moderne, d’une laïcisation complète de toute la vie et de tous les rapports éthiques (Q. 13, 1, 1561).
L’histoire de l’URSS stalinienne et du parti unique devenu État donnerait à ce texte un sens totalitaire récurrent qu’il n’a pas. L’existence des partis politiques et du système qui les relie à l’État et à la société civile est bien un moment de la modernité. Le risque de religion politique n’a pas davantage épargné le républicanisme laïque qui a souvent poursuivi l’entreprise de séparation de l’État et de l’Église en développant une religion de foi civile organisée autour d’un signifiant maître, la République, avec ses codes et ses prescriptions éthiques, ses institutions vite fétichisées, avec son marquage des corps et ses prétentions de civilisation universelle à exporter dans les colonies.
En guise de conclusion : la dialectique comme mise en équivalence de la philosophie et de la politique
Ce qui fait le propre de la thèse gramscienne est qu’elle repose sur un présupposé, celui d’une unification culturelle rendue possible et totale de la société par le travail comme assimilation de ses masses fragmentées et séparées. Gramsci compte sur les nouvelles conditions de la production – le fordisme et l’américanisme – pour créer les bases de cette unification religieuse et culturelle qui est pour lui le sens historique immanent de la modernité. On ne lit pas assez les quelques lignes qui précèdent le texte cité sur le Prince qui « prend la place de la divinité ou de l’impératif catégorique ». Elles assignent à la réforme intellectuelle et morale une condition économico-politique que l’on sous-estime et lui évitent de se réduire à une opération culturelle et religieuse, vouée à produire une transcendance incohérente.
Peut-il y avoir une réforme culturelle, c’est-à-dire une élévation civile des couches déprimées de la société, sans une précédente réforme économique et un changement dans la position sociale et dans le monde économique ? Voilà pourquoi une réforme intellectuelle et morale ne peut ne pas être liée à un programme de réforme économique, bien au contraire le programme de réforme économique est en fait le mode concret sous lequel se présente toute réforme intellectuelle et morale (Q. 13, 1, 1561).
L’hérésie de la religion de la liberté n’hypostasie ni l’État des subalternes ni le parti : ce sont là des appareils indispensables pour réarticuler politique et économie ; ils doivent être objet de la critique des simples et être contrôlés par des mécanismes internes. Ils sont particulièrement difficiles à créer pour deux raisons. D’une part, les simples ne peuvent pas adhérer politiquement et agir uniquement pour des raisons intellectuelles. Ils ne peuvent pas se dispenser de penser et d’agir dans un élément dominé par une foi qui peut être éduquée, non éliminé. On demeure dans l’ordre de la rhétorique non dans celui de l’analytique pour paraphraser Aristote et Vico. D’autre part, il est difficile de sélectionner dans les masses subalternes les intellectuels nécessaires, d’autant que ces intellectuels sont, à leur tour, voués à se disposer selon des « hiérarchisations d’autorité et de compétence intellectuelle ». La révolution passive que définit la situation historique consiste sur ce plan à rejeter les masses dans une activité passive subie et à désagréger par intégration, à décapiter les sommets du parti, à dissoudre sa fraction médiane nécessaire pour assurer le contact entre simples et intellectuels.
L’hérésie gramscienne affirme sa spécificité qui en fait la critique laïque de ce qui est en définitive un modèle analogue mais négatif qu’il faut surtout ne pas suivre.
La position de la philosophie de la praxis est antithétique à la position catholique : la philosophie de la praxis ne tend pas à maintenir les “simples” dans leur philosophie primitive du sens commun, mais au contraire à les conduire à une conception supérieure de la vie. On affirme l’exigence du contact entre intellectuels et simples non pas pour limiter l’activité scientifique et pour maintenir une unité au bas niveau des masses, mais précisément pour construire un bloc intellectuel-moral qui rend politiquement possible un progrès intellectuel de masse et non pas seulement celui d’un petit nombre de groupes intellectuels (Q. 11, 12, 1384-5).
La question de sa vérité ne relève pas d’une logique transcendantale ; elle se pense comme Machiavel l’a montré, lui le penseur qui a uni en son temps Réforme et Renaissance, dans la reconnaissance et la connaissance de la réalité des rapports de force qui intègrent des rapports hégémoniques de connaissance. La philosophie de la praxis est bien science dans la mesure où elle inclut la connaissance des rapports de force dans l’histoire se faisant et où cette connaissance est constitution d’un processus de vérité. Ce processus a pour enjeu un conflit d’hégémonies relatif à la réalisation de l’égalité réelle, à l’unification politique et culturelle, pratique et théorique, d’une société (qui a pour limite le genre humain) à l’intérieur d’un point de vue de classe et même de masse. La vérité philosophique coïncide avec la politique comme deux versions de la même « chose » ou realtà effetuale (Machiavel) en deux langages différents. La politique n’a pas d’autre test que le procès d’universalisation dans une même position des dynamiques internes de l’histoire. Une force sociale n’a une supériorité historique que par sa capacité à se faire interprète de cet entrelacs de politique et de vérité et d’orienter les dynamiques sociales jusqu’au point d’universaliser pratiquement et théoriquement sa propre positon au sein d’un conflit hégémonique avec les autres. Il y a bien une science vraie qui ne relève pas des sciences de la nature et qui a pour objet la structure et la transformabilité des rapports sociaux et politiques de force et des rapports sociaux de connaissance. La vérité est inséparable du problème de l’unification du concept plastique d’« homme » qui n’a rien à voir avec l’idée fixe d’une nature humaine.
Voilà pourquoi Gramsci en définitive reformule la dialectique entre forme de la pensée et forme contradictoire et conflictuelle du devenir réel. Il faut réformer la réforme idéaliste de la dialectique accomplie par Croce et Gentile et repenser la scientificité de Marx comme égalité entre, ou équation entre, philosophie et politique : les rapports de forces sont tout autant des rapports de connaissance dans la mesure où ils se structurent dans les luttes pour l’hégémonie. L’hégémonie se traduit dans l’immanence historique comme capacité d’assimiler les masses subalternes. Contrairement à que ce soutenait Althusser, le continuum idéologique gramscien n’exclut pas la forme de scientificité. C’est dans les rapports pratiques politiques qui sont des luttes hégémoniques que se médiatisent idéologie et connaissance critique, foi et vérité, partialité et universalité. La philosophie de la praxis est construction d’hégémonie en tant qu’elle ne peut exister que comme philosophie de masse. La vérité qu’elle construit est objective en tant qu’elle est universellement subjective et constitue une vérité-liberté. Elle opère en égalisant tendanciellement les différences entre masses et élites, entre les masses mêmes et en réformant « religieusement » les consciences. Elle est unité dialectique de philosophie et de sens commun ; pour elle la religion est une forme de politique et non l’inverse et l’idéologie est forme de connaissance caractérisée par des degrés quantitativement différents de vérité universalisable politiquement et de politicité universellement véri-dictive.
Bibliographie
Textes originaux
Les Cahiers de la prison sont cités et traduits à partir de l’édition italienne de référence établie par Valentino Gerratana, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, édition de 2000.
Désormais nous disposons de l’indispensable Dizionario Gramsciano 1926-1937, a cura di Guido Liguori e Pasquale Vozza, Roma, Carocci, 2009, 918 p.
Je me permets de renvoyer à l’anthologie Antonio Gramsci Textes choisis, présentés par André Tosel, Paris, Le Temps des Cerises, 2014.
Ouvrages utilisés
ALTHUSSER L., Lire le Capital, Paris, PUF, 1996.
BADALONI N., « Gramsci e la filosofia della prassi come previsione », in Storia del Marxismo, vol. III, 2, Dalla crisi del’ 29 al XXe Congresso,Torino, Einaudi, 1981.
ID., Il problema dell’immanenza nella filosofia politica di Gramsci, Venezia, Arsenale, 1988.
BUCI-GLUCKSMANN Ch., Gramsci et l’État : pour une théorie matérialiste de la philosophie, Paris, Fayard, 1974.
BURGIO A., Gramsci storico. Una lettura dei « Quaderni del carcere », Roma/Bari, Laterza, 2002.
DEL NOCE A, Il suicidio della rivoluzione, Milano, Rusconi, 1978.
FROSINI F., Gramsci e la filosofia. Saggio sui « Quaderni del carcere », Roma, Carocci, 2003.
ID., La religione dell’uomo moderno. Politia e verità nei Gramsci e la filosofia. Saggio sui « Quaderni del carcere » di Antonio Gramsci, Roma, Carocci, 2010.
FROSINI F. & LIGUORI G., Le parole di Gramsci. Per un lessico dei « Quaderni del carcere », Roma, Carocci, 2004.
IVES P. & LACORTE R. (dir.), Gramsci, Language, and Translation, New York/Toronto, Plymouth U.K. Lexington Books, a division of Rowman and Littlefield Publishers, 2010.
LA ROCCA T., Gramsci e la religione, Brescia, La Queriniana, 1991.
LOSURDO D., Gramsci : du libéralisme au « communisme critique », Paris, Syllepse, 2004.
NARDONE G., Il pensiero di Gramsci, Bari, Di Donato, 1971.
PAGGI L., Le strategie del potere in Gramsci. Tra fascismo e socialismo in uno solo paese (1923-1926), Roma, Editori Riuniti, 1984. Ce volume contient deux essais majeurs en appendice : « Il problema Machiavelli » et « Da Lenin a Marx. La teoria generale del marxismo in Gramsci ».
ROBELIN J., Marxisme et socialisation, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1988.
PORTELLI H., Gramsci et la question religieuse, Paris, Anthropos, 1974.
THOMAS P., The Gramscian Moment, Leiden-Boston, Brill, 2009.
TOSEL A., Marx en italiques. Aux origines de la philosophie italienne contemporaine, Mauvezin, Editions Trans Europ Repress, 1991.
ID., Le marxisme du XXe siècle, Paris, Syllepse, 2011.
TRENTIN B., La cité du travail. Le fordisme et la gauche, Paris, Fayard, 2012.
[1] ALTHUSSER L. et al., Lire le Capital II, Paris, PUF, 1996 (1968), 688 p., p. 320.
[2] Idem, p. 321.
[3] Cité par ALTHUSSER L., Lire le Capital II, Op. Cit., p. 321.
[4] Idem, p. 323-4.
[5] Idem, p. 327.
[6] Ibidem.
[7] Idem, p. 326.
[8] FROSINI F. et LIGUORI G., Le parole di Gramsci. Per un lessico dei « Quaderni del carcere », Roma, Carocci, 2004, 272 p., pp. 131-149.
[9] Idem, p. 144.
[10] Dizionario Gramsciano 1926-1937, a cura di Guido Liguori e Pasquale Vozza, Roma, Carocci, 2009, 918 p., pp. 700-704.
[11] GRAMSCI A., in L’Ordine nuovo 1919-1920, A cura di Valentino Gerratana e Antotio A. Santucci, Torino, Einaudi, 1987, p. 636.