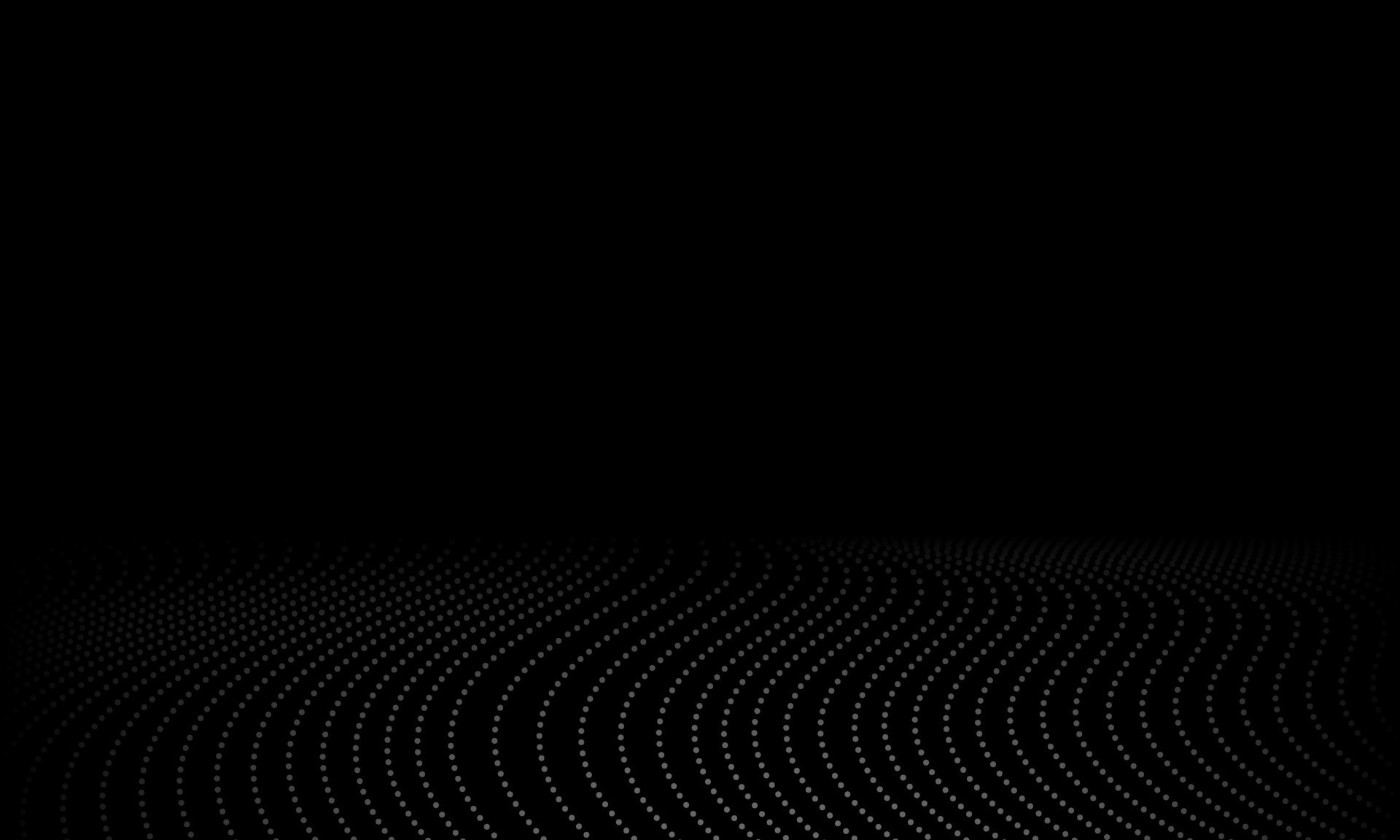Par Eric Lucy, Docteur en Sciences de l'éducation et responsable de formation à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine.
Parfois il existe une douloureuse disconvenance entre les intentions et les actions notamment dans les expériences de la limite, de la frontière ou de la séparation. Ce sont des épreuves où la pensée tant sur le plan individuel que collectif nourrit des projets qui s’opposent jusqu’en devenir ineffables. Le mouvement de la libre circulation s’amplifie mais les murs et les frontières prolifèrent, les accès aux autres se développent et les socialisations se referment sur un entre soi, plus on construit de murs, plus ils sont dénoncés, sanctifiés ou banalisés. Le « paradigme du mur » vu ici en tant que catégorie étatique se présente comme un phénomène fondamental plus que total qui vise plusieurs choses, nourrit leurs contraires et suppose un État capable de soulever la balance en son milieu. « On recense des murs-frontières à la surface du globe comme dans les mentalités : ce "paradigme du Mur" semble même représenter une donnée constante de l’histoire contemporaine des relations internationales. Souvent virtuels et de dimension métaphorique, mais également concrets dans leur dimension géographique et spatiale »[1]. Différentes expressions de murs indiquent les antagonismes que les démocraties libérales sont en demeure de tenir face à leurs propres sociétés civiles, territoires, systèmes d'assistance aux démunis, médias, etc. Notamment étudiés sous le prisme de la production des ségrégations spatiales (Grafmeyer, 1996) les murs sont à la fois un phénomène d'État comme « champ » et appareil bureaucratique de gestion puis comme autorité qui exerce cet appareil dans ce « champ ». Si dans la tradition marxiste la notion d’appareil permet de définir le mur comme une organisation mécaniste qui prête à l’État un pouvoir de production, le « champ en tant que jeu structuré de manière souple et peu formalisé [...] n’est pas un appareil obéissant à la logique quasi mécanique d’une discipline capable de convertir toute action en simple exécution, limite jamais atteinte, même dans les "institutions totales" »[2]. Le paradigme du mur est envisagé ici en référence à la théorie de Pierre Bourdieu à partir d’une perspective qui considère donc l’État comme principe de production de différenciations du monde social dans un champ autonome où les murs conduisent le théâtre de son autorité et ce qui compte, c’est la fiction juridique du territoire qu’ils supposent. Et cette dernière vient en retour légitimer l’État. Avec le vote démocratique, les commissions, les espaces de concertations, le mur devient une des solutions officielles et partagées des problèmes sociaux, économiques, identitaires ou religieux. Il est « le point de vue des points de vue » qui va rassembler en un seul mouvement les antagonismes[3]. Il opère de manière symbolique et réelle en officialisant le fait que l'État bureaucratique est perçu comme une autorité qui fait fonctionner les territoires. Il matérialise et instruit une vision officielle qui trouve sa logique dans une chaîne de légitimations en rassemblant les événements dans des unités signifiantes. Aujourd’hui, les formes matérielles du mur d’État sont diverses. Elles peuvent se classer en grandes catégories. Les situations de blindage de frontières issues de la forme sécuritaire civile et militaire des États, le mur est alors construit sur le territoire d’un État dans un contexte de rapport de forces. Certains relèvent exclusivement d’une production militaire, il peut s’agir par exemple de lignes de cessez-le-feu dont le tracé est contesté. Il existe aussi des murs de séparation entre communautés dans des contextes de guerre civile ainsi que des murs à caractère sécuritaire et social qui attestent d’une logique de séparations urbaines fortifiées comme les barrios privados d’Amérique latine.
Des milliers de kilomètres de frontière blindée s’étendent ainsi aujourd’hui entre les États-Unis et le Mexique, entre l’Union européenne et l’Afrique (notamment entre l’Espagne et le Maroc, mais aussi tout le long des côtes méditerranéennes par une forme de blindage maritime, une "mer blindée"), entre l’Inde et le Bangladesh, entre la Chine et la Corée du Nord, entre le Botswana et le Zimbabwe, entre l’Arabie saoudite et l’Irak, etc. [...] Des limites territoriales de fait semblent bien être la stratégie sous-jacente à l’érection de ces murs : ainsi de la construction par Israël d’un mur, et de nombreux dispositifs d’empêchement, sur et au-delà de la ligne verte de 1949, en Cisjordanie ; ainsi de la construction, par le Maroc, de murs successifs, sur et au-delà de la limite internationalement reconnue des Territoires sahraouis, au Sahara occidental ; ainsi du blindage, par l’Inde, de la ligne de cessez-le-feu au Cachemire.[...] Du sécuritaire militaire relèvent aussi les murs de séparation entre communautés, érigés dans des contextes de guerre civile par des forces militaires tierces, pour séparer les belligérants : les peacelines de Belfast entre quartiers catholiques et quartiers protestants, construits par l’armée britannique ; les Bremer walls à Bagdad entre quartiers sunnites et quartiers chiites, placés par l’armée américaine.[4]
Dans les villes divisées, la discrimination ethnique et la ségrégation spatiale sont souvent légitimées par des prophéties de violence et des perspectives inconciliables qui font du mur une solution.
À Belfast, Beyrouth, Jérusalem, Mostar ou Nicosie, les chemins de la partition physique furent déterminés à la fois par des modes anciens de séparation et par les vicissitudes de la fortune politique : l’issue finale n’intervint pas par hasard, mais elle n’était pas inévitable. Dans un grand nombre de conjonctures, les actions d’une poignée d’individus peuvent déterminer si une ville dévie ou non du droit chemin de son développement. Bien que ces cinq cités ne soient pas parvenues à éviter la division, cela aurait pu être le cas.[5]
Avec les frontières des démarches administratives comme l’espace de Schengen, les espaces maritimes et aériens de défense, ces diverses formes de murs indiquent comment l’État, au sens de ses administrations et de ses institutions, se fait au nom de la protection d’un territoire physique mais aussi administratif et virtuel.
L’acceptation par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), en novembre 2010, du projet américain d’une défense antimissile du territoire, participe d’une logique qui est à la fois celle de la modernisation technologique de la fonction de défense, et de la séparation. Face à la prolifération balistique et nucléaire, les membres de l’Alliance décident de se protéger par un bouclier virtuel, un mur dans l’espace, au moment où l’on peut estimer qu’une cinquantaine de pays, en Asie et au Moyen-Orient pour l’essentiel, maîtriseront d’ici à 2020 la technologie des missiles de moyenne portée. Dans un même esprit de virtualité́, on relèvera également l’érection d’un véritable "mur de Schengen" qui, avec la multiplication, en amont, des démarches administratives pour obtenir un visa d’entrée sur l’espace européen, entend aider à contrôler certains flux migratoires. Plus encore, le développement des réseaux informatiques a contribué à l’émergence d’une nouvelle catégorie de menaces (les cybermenaces) auxquelles des murs exclusivement virtuels, les pares-feux, tentent de s’opposer.[6]
Les processus tant matériels que symboliques des murs d’États profitent de la production, la condensation ou le déplacement de problèmes publics et privés. Ils fonctionnent dans un rapport officiel au territoire qui doit aussi être reconnu jusque dans la contestation car c’est ce qui fait sa force puisqu’il constitue l’officiel des dissensus. L’essence des légitimations, au sens de la justification dans la société de l’ordre établit, réside dans ce que la construction du mur peut faire croire comme possibilités du rapport au territoire. Ainsi, le fictif de l’invasion identitaire ou les dangers réels d’attentats conduisent pour des raisons différentes à des discours de justifications dont la force vient de ce qu’elle contribue à diverses opérations. Ce mouvement fonde l’État et légitime un rapport de force des relations du citoyen au territoire en les inscrivant dans des pratiques sociales qui sont elles-mêmes une construction sociale naturalisée dans des fictions juridiques.
Fictions juridiques
Néanmoins, étudier le mur comme processus d’État suppose de ne pas opposer une perspective agonistique qui viserait la mise en relief de la conflictualité des rapports de force dans le fonctionnement du monde social, et une vision consensualiste que les constructions juridiques devraient réduire (Commaille, 2004, pp. 12-15). Le champ juridique est un univers « relativement indépendant par rapport aux demandes externes », il appartient à un champ spécifique d’une « concurrence pour le droit de dire le droit dans lequel s’affrontent des interprètes autorisés du corpus des textes juridiques consacrant la vision légitime du monde social », il reste cependant la « forme par excellence de la violence symbolique légitime dont le monopole appartient à l’État et qui peut s’assortir de l’exercice de la violence physique »[7]. Comprendre le mur comme processus d’État consiste à situer le champ juridique à la fois comme indépendant et partie prenante de la phénoménologie des actes officiels de consécrations qui règlent les dissensus des rapports citoyens au territoire. Avec l’État, le paradigme du mur produit « du fiduciaire organisé, de la confiance organisée, de la croyance organisée, de la fiction collective reconnue comme réelle par la croyance »[8]. La fiction juridique du mur tient de l’effet de l’illusio comme se plait à le dire Pierre Bourdieu. Elle oblige à entrer dans un jeu collectivement validé par un consensus selon une double naturalisation à la fois dans les corps et les choses et, à ce titre, le mur peut être considéré comme un des principaux promoteurs de l’ordre dogmatique propre aux processus d’État.
Bien avant les remugles contemporains des murs, l’enceinte de l’utopie asilaire visait une construction juridique nouvelle de la folie. La loi de 1838 qui demanda à chaque département la réalisation d’un asile a, comme l’avait perçu Michel Foucault, annexé à la médecine un domaine qui lui était étranger. Le mur asilaire envisageait un territoire avec comme argumentation l’observation de la véritable nature de la maladie. Cette fiction donna au geste de Pinel la possibilité d’un lieu thérapeutique légitime fondé sur la clinique et avec Esquirol, la maladie est devenue une question morale. Le médecin en était le guide et le gardien. Elle reposait sur l’isolement qui devait libérer le fou des influences externes, de leurs familles, vaincre les résistances personnelles face aux soins et imposer de nouvelles habitudes intellectuelles et morales. Sous la forme d’une banalisation idéologique, les murs de l’asile construisirent la maladie mentale comme le problème du rapport entre l’humanité du normal avec celle perdue ou pathologique de la maladie mentale. L’évidence montra qu’une « production idéologique est d’autant plus réussie qu’elle est plus capable de mettre dans son tort quiconque tente de la réduire à sa vérité objective »[9].
Plus proche de nous, le mur de Berlin comme justification de la scission du territoire, consista à l’invention d’un rapport de force Est-Ouest pour masquer l’exode vers l’Ouest. D’un côté le mur fut mis en œuvre pour se protéger efficacement de la propagande dite « impérialiste » et avoir une véritable chance de se développer, de l’autre, l’abandon de l’objectif d’unité nationale par le chancelier Konrad Adenauer avait comme objectif une plus grande intégration dans le camp européen et américain (Goepper, 2010). La fiction juridique allemande du concept de nation s’exprimant dans l’État par le droit du sang (jus sanguins) indiquait au final la possibilité de la réunification. Cependant, avec la perte de ses justifications au travers de sa chute, la légitimité de la séparation est devenue un traumatisme (Soeur, 2013). Le mur garde une emprunte spatiale importante sur le territoire (Laporte, 2017) et la commémoration de sa destruction est toujours compliquée (Vaillant, 2015), même vingt-cinq ans après (Vianna, 2015). À l’aune de cette expérience on peut comprendre ensuite la générosité de l’Allemagne européenne dans l’accueil des migrants que l’on autorisait a passer le mur de la fiction juridique que constitue l’espace de Schengen. Certes, il ne s’agissait pas d’ouvrir vers un droit du sol (jus soli) comme en France où il n’y a pas d’autre projet que celui de l’assimilation, cela impliquait cependant une force culturelle universalisante suffisante que les conservateurs refusent aujourd’hui dans une nostalgie de la grandeur de la culture. Entre la volonté de la liberté de circulation et d’agrandissement, puis la justification d’une frontière administrative, le paradoxe du projet européen s’est cristallisé sur la question de la migration avec la création de Frontex, laquelle s’inscrit dans une large panoplie d’instruments européens de renforcement des contrôles aux frontières extérieures (Wihtol de Wenden, 2004). Le pouvoir symbolique du mur administratif est maintenant de faire faire, faire voir et de faire agir. Il opère comme un rituel vers ceux à qui il est adressé et ces derniers, s’ils ne meurent pas avant d’avoir passé ce mur, doivent présenter les dispositions pour reconnaître et obéir aux règles du jeu du rapport citoyen au territoire dans un but d’intégration, d’assimilation ou au mieux, d’adoption, malgré les hypocrisies, les dominations, les inégalités et les exclusions qu’il conditionne.
Tonalités du dissensus
Le mur comme l’être et le faire de ce que l’on nomme État, « est le fondement n’ont pas nécessairement d’un consensus mais de l’existence même des échanges conduisant à un dissensus »[10]. Comme la règle parlementaire, il sert à la construction d’un espace politique socialement et juridiquement reconnu avec la naissance du citoyen qui a des devoirs envers l’État mais qui est aussi capable juridiquement de demander des comptes (Bourdieu 2012, pp. 552-555). Si le mur donne une existence juridique de la citoyenneté sur le territoire, il le fait souvent selon une certaine asymétrie des obligations, des droits et des devoirs. Ainsi, le mur de la Cisjordanie, comme d’autres dans le monde pour d’autres États, permet d’occuper de plus en plus de terre en légitimant le rapport de domination par l’impossibilité finalement d’une solution à deux États, et dans l’usage du mur, les pratiques du checkpoint sont une mise en politique de l’asymétrie des citoyens sur le territoire. La tonalité du dissenssus y est alors marquée du sceau des cérémonies de l’humiliation qui alimentent en retour le problème du rapport citoyen au territoire (Ritaine, 2009). Ces pratiques procèdent d’une « domestication des dominés » qu’il faut faire entrer dans les règles de l’hégémonie[11]. Quand le mur participe à la production d’un ordre commun il est toujours au regard d’un champ de forces. Il impose des formes symboliques d’une pensée commune de classifications et de schèmes d’action. Par exemple, le mur peut s’appeler une « ligne verte » comme dans le traité de Rhodes de 1949 qui désignait la ligne d’armistice entre les pays arabes et Israël, puis devenir une « barrière de séparation » pour finalement se métamorphoser en « barrière de sécurité » (gader bitahon).
Du côté palestinien, sa présence et sa matérialité s’imposent avec la force et la violence des confiscations et de l’enfermement qu’il crée. Il donne ainsi un caractère encore plus présent et contraignant à l’occupation. Du côté israélien, son manque de visibilité pour la majorité et les projections qu’il favorise tendent à donner l’illusion d’un éloignement du conflit. En d’autres termes, renforçant le sentiment de séparation au sein de la population israélienne, le projet de construction du mur repousse, du point de vue de celle-ci, la nécessité de résoudre le conflit et de négocier une frontière entre Israéliens et Palestiniens. (Parisot, 2009, Op. Cit., p. 72)
Dans la « passion nationaliste » le mur impose de la même manière ses perceptions du territoire[12] :
… sous la forme de structures objectivées, ségrégation de fait, économique, spatiale, -et dans les corps- sous forme de goûts et de dégoûts, de sympathies et d’antipathies, d’attractions et de répulsions, que l’on dit parfois viscérales. La critique objective (et objectiviste) a beau jeu de dénoncer la vision naturalisée de la région ou de la nation, avec ses "frontières naturelles" ses "unités linguistiques" , ou autres, et elle n’a pas de peine à faire apparaître que toutes ces entités substantielles ne sont que des constructions sociales, des artefacts historiques qui, souvent issus de luttes historiques analogues à celles qu’ils sont censés trancher, ne sont pas reconnues comme tels, mais appréhendés à tort comme des données naturelles (Bourdieu, 1997, 2003) Op. Cit., pp. 260-261).
L’exemple du mur de la langue en Belgique indique comment l’État s’est fait en donnant à croire à l’existence d’un problème naturel. Jusqu’en 1878 il n’y avait pas de difficulté avec la double langue ; « Dans les quatre provinces du nord (Anvers, Flandre orientale, Flandre occidentale et Limbourg) et les arrondissements de Louvain et de Bruxelles (province de Brabant), les avis et communications au public [devaient] être rédigés en néerlandais ou dans les deux langues »[13]. C’est la loi du 22 mai 1878 qui créa trois régions linguistiques, elle suscita de fait des anomalies administratives et le pays s’est divisé en deux régions linguistiques ouvertes sur d’interminables controverses.
Selon une autre perspective et puisque « toute règle a sa porte », le mur exprime aussi la duplicité du dissenssus qu’il propose de tenir[14]. Par exemple, en 1986, l’Inde voulait mettre fin à l’immigration musulmane très pauvre du Bangladesh, trois mille cinq cents kilomètres de mur furent édifiés. Mais cette frontière qui sépare les habitants de leur territoire de vie est traversée quotidiennement, notamment pour cultiver les champs, et le flux migratoire ne s’est pas tari. Le mur exprime alors une manière de ne rien faire tout en donnant l’air d’avoir apporté une solution. Dans un autre contexte, le mur entre les États-Unis et le Mexique suit aussi une logique de dissimulation des rapports sociaux si on considère qu’il est le plus traversé au monde avec ses quarante-deux points de passages et une moyenne de 250 millions de traversées par an (Le Texier 2010).
Enfin, les murs servent aussi l’ambiguïté du dissensus. Et l’expression de cette ambiguïté peut trouver une destinée têtue dans les mots d’ordres politiques. Par exemple, en France, dans un contexte de campagne électorale très focalisée sur les questions d’immigration, le premier ministre Michel Rocard prononça le 3 décembre 1989 une formule qui servira toutes les équivoques. Invité dans une émission de télévision, il précisa la nouvelle position de la France en matière d’immigration selon une formule langagière qui fera école grâce à la qualité de ces transformations au grès des positions politiques : « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu’elle est, une terre d’asile politique […] mais pas plus. […] Il faut savoir qu’en 1988 nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes. 66 000 personnes refoulées aux frontières ! À quoi s’ajoutent une dizaine de milliers d’expulsions du territoire national. Et je m’attends à ce que pour l’année 1989 les chiffres soient un peu plus forts » (Deborde 2015). Les prémisses du mur administratif de Schengen étaient posées. L’entretien provoqua de nombreuses réactions et depuis, cet acte de langage ouvre sur le jeu sans fin des ambiguïtés de la politique de la France.
Rhétoriques de l’officiel
Si le mur est une fiction du monopole d’État sur le territoire qui vise un intérêt universel, ce monopole est constitué d’un réseau et d’une chaîne d’interdépendance de puissance et de forces différentes (économiques, religieuses, privées, publiques, associatives et collectives) concernant l’usage du territoire. Les intérêts particuliers recouvrent de nombreux acteurs désirant faire avancer leurs intérêts autour d’un intérêt universel, il est par exemple possible de penser que ce fut l’objectif du mur du candidat Donald Trump.
Commencé en 1994 avec l’opération Gatekeeper à San Diego, en Californie, et poursuivi par Hold-the-Line à El Paso (Texas), Safeguard à Tucson, et Ice Storm à Phoenix (Arizona), le mur (qui peut être un système de barrières uniques ou multiples), s’étend aujourd’hui sur près de 1 000 kilomètres, soit sur un tiers de la longueur de la frontière. Après les attentats du 11 septembre 2001 et le vote du Patriot Act le 26 octobre de la même année, il est devenu le symbole de la lutte antiterroriste. Simultanément, l’intégration économique facilitée par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a entraîné depuis 1994 un quadruplement des échanges commerciaux, ainsi qu’une rapide croissance démographique dans les villes frontières (Le Texier 2010, Op. Cit., p. 758).
La rhétorique du mur était la solution pour répondre aux demandes identitaires, elle constituait ainsi une des multiples expressions du slogan America first, de même, elle permettait de fédérer les intérêts des multinationales tout en proposant une perspective à ce qui s’annonçait comme une nouvelle politique internationale. Les demandes particulières pouvaient être entendues comme des demandes officielles que le candidat promettait d’universaliser en intérêts communs. Le mur, comme dans l’ancien régime, est une supplication, c’est-à-dire une procédure hors du pouvoir des juges qui autorisait de soumettre au roi toutes les demandes des diverses juridictions du royaume (Bourdieu 2012, p. 333). Le futur président avait donc un avantage à incarner l’unification des demandes vers un intérêt universel pour constituer la souveraineté d’un État non pas centralisé qui va garantir le commun, mais un État qui peut défendre des intérêts privés.
Enfin, avec la supplication et les procédures d’universalisation, l'obsequium apparaît comme la nécessité première d’une rhétorique de l’officiel qui enserre un respect à l'ordre symbolique par lequel l’État nous façonne à son usage (Bourdieu, 1980, p.113 note 2). Il comprend toujours des bouc-émissaires qui doivent payer un hommage à l'officiel (Bourdieu, 2012, pp. 63-66), et, avec les murs, les figures du « migrant », du « réfugié », du « travailleur étranger » forment les héros qui sauvent la face des officiels du territoire. Ainsi, en vertu des règles dites de « Dublin III », chaque réfugié doit demander l’asile dans le pays où ses empreintes ont été enregistrées. Peu importe si de nombreux migrants échappent à ce contrôle pourvu qu’existe l’expression d’une stratégie de « police à distance » (Guild, Bigo, 2003). Le paradigme du mur doit incarner les rapports de force même les plus fuligineux. À cette liste des bouc-émissaires, nous pouvons ajouter pour la France les « dublimés », puisque depuis décembre 2017 les députés ont adoptés une proposition de loi qui donne la possibilité de mettre directement en rétention les migrants qui n’ont pas demandés asile dans le pays d’entrée dans l’espace de Schengen, même si quarante pour cent de ceux qui s’enregistrent en préfecture pour une démarche d’asile avaient déjà demandé l’asile dans un autre pays et souvent en avaient été déboutés[15]. En prenant le parti de penser le paradigme du mur comme processus d’État il apparaît aussi nécessaire de saisir les contextes de vie de ces étrangers comme de nouvelles formes sociologiques. Cela nous entraîne alors à faire usage de la formulation de Georg Simmel, c’est-à-dire à comprendre que ces étrangers sont désignés comme des êtres mobiles qui viennent aujourd’hui et qui restent demain. Pour Simmel l’étranger est une forme sociologique qui se rattache à un point mais qui en est aussi détaché. Il est ainsi possible de penser que le mur et notamment le cadre juridique européen de Schengen, vise non pas à situer l’étranger dans un espace selon la perspective positive que Simmel défend, mais cet espace suppose de le rattacher à un lieu géographique selon un destin qui ne serait pas fortuit mais inscrit selon cette forme sociologique, dans un destin d’étranger. Ce qui importe, c’est l’officiel, le principe, plus que la réalité et les bouc-émissaires témoignent de ces effets. L’euphémisme de la « rétention » banalise l’enfermement qui devient une salle d’attente dans laquelle « la manipulation des aspirations et des espérances subjectives doit, pour être efficace, pouvoir compter avec une véritable incertitude objective, inscrite dans la structure même du jeu »[16]. La « domestication » peut aussi fonctionner selon une rhétorique philanthropique. L’argumentation du hotspot est édifiante quand l’État, non sans un certain cynisme, parle d’intégration. Le 27 août 2017 lors d’une rencontre à l’Élysée avec des représentants des pays du Sahel, le président Français déclarait : ces « nouveaux guichets » de pré-examen au Niger et au Tchad « ne constitueront pas un outil de contrôle des flux migratoires », ils permettront de « faire de la pédagogie » puisque ces critères de distinction entre migrants économiques et réfugiés politiques sont « opérants » pour la délivrance d’un titre de séjour tout en conduisant les « missions de protection en vue de la réinstallation de réfugiés en Europe » (Hulot-Guiot, 2017). Décrit comme des dispositifs d’accueil, les hotspots apparaissent néanmoins comme les nouveaux camps d’internements des agences européennes. Dans le glossaire de la Commission européenne, le terme « d’accueil » était pourtant explicite dans une section intitulée Save Lives and secure the External Borders mais aujourd’hui, ce dispositif d’accueil est une frontière pour mieux renvoyer (Tassin 2016) et c’est bien la logique de dissuasion et non celle de secours qui prédomine[17]. Avec les oxymores de l’officiel, cet exemple exprime aussi toute la difficulté à penser le paradigme du mur dans le champ de l’État sans esquiver la question de la production des agents qui participent aux usages du mur puisqu’un champ ne peut fonctionner que s’il trouve des individus socialement prédisposés à poursuivre les enjeux et obtenir les profits qu’il propose.
En conclusion, le paradigme du mur œuvre comme rite d’institution d’un transcendantal historique commun qui propose ses nomenclatures de classifications des personnes sur un territoire. Dans sa forme État, il conditionne des programmes d’action politique visant à imposer une vision particulière de l’État conforme aux intérêts et aux valeurs associées à la position occupée par ceux qui les produisent dans l’univers bureaucratique en voie de constitution. C’est pourquoi, si nous continuons à penser la construction étatique des murs dans les esprits, « on est entraîné dans une régression à l’infini au terme de laquelle "il faut s’arrêter" et l’on peut, à la façon des théologiens, choisir de donner le nom d’État au dernier (ou au premier) maillon de la longue chaîne des actes officiels de consécrations »[18]. Le mur institue des usages du territoire, des représentations de l’État associées à ceux qui les font vivre en s’instaurant comme incarnation statutairement mandatée de l’officiel. Les rapports de forces qu’ils établissent sont les plus asymétriques, ils assujettissent ou excluent de manière brutale les dominés qui se retrouvent régulièrement assignés à des places de victimes émissaires des processus d’État, conjointement, ils produisent des rapports symboliques qui mettent en œuvre des structures cognitives. Ces dernières sont des formes constituées, arbitraires et conventionnelles, elles fonctionnent comme des évidences qui fondent les relations de soumissions doxiques au territoire. Enfin, la construction des murs permet à l’État de ne pas être uniquement une fiction juridique mais un ordre autonome capable de monopoliser la violence physique et symbolique au bénéfice d’agents qui sont chargés de transcender l’intérêt particulier dans un intérêt général par le recours à une rhétorique de l’officiel.
Bibliographie
BOURDIEU P., Sur l’État, Paris, Éditions du Seuil, 2012.
–, Méditation pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil, 2003 (1997).
–, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions du Seuil, 2001.
–, Raisons pratiques, Sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil, 1994.
–, « Droit et passe-droit [Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements] », in Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 81-82, mars 1990. L’économie de la maison. pp. 86-96.
–, « La dernière instance », Le siècle de Kafka, Paris, Centre Georges Pompidou, in Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987 (1984) , pp. 268-270.
–, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986, pp. 3-19.
–, Ce que parler veut dire, Paris, Éditions Fayard, 1982.
–, Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980.
CALAME J., « La ville divisée : les minorités hors les murs », in Politique étrangère, Les murs : séparation et traits d’union, vol. hiver, n°. 4, 2010, pp. 783-797.
COMMAILLE J., « Présentation », La place du droit dans l’œuvre de Pierre Bourdieu, in Droit et société́, n°56-57, Paris, 2004, pp. 11-15.
DEBORDE J., « "Misère du monde", ce qu'a vraiment dit Michel Rocard », in Libération, 22 avril 2015.
GOETTER S., « Du "mur dans les œuvres" au "mur dans les têtes" », in Les Cahiers du MIMMOC, [en ligne], 2009, [consulté le 08 octobre 2017].
GRAFMEYER Y, « La ségrégation spatiale : une approche conceptuelle et méthodologique », in PAUGAM S. (Dir.), L'Exclusion. L'État des savoirs, Paris, Éditions La Découverte, 1996, pp.209-217.
BIGO D., GUILD E. (dir.), « Schengen la politique des visas », in Cultures & Conflits, La Mise à l’écart des étrangers. La logique du visa Schengen, n°49, 2003, pp. 22-37.
HULLOT-GUIOT K., « Une proposition de loi pour placer plus de migrants en centre de rétention », in Libération, 7/12/2017.
KHOOJINIAM M., « La Police des Étrangers face à l’immigration de travail dans la Belgique des Golden Sixties : gouvernementalité sécuritaire et gestion différentielle du séjour illégal (1962-1967) », in Cahiers Bruxellois, nº 48, 2016, pp. 223-325.
LAPORTE A., « L’empreinte spatiale de l’ancienne frontière interallemande dans le Berlin d’aujourd’hui », in Belgeo, [en ligne], 2013, [consulté le 31 octobre 2017].
Le TEXIER E., « Mexique/États-Unis : de la frontière intelligente au mur intérieur », in Politique étrangère, Les murs : séparation et traits d’union, 2010/4 (Hiver), 757-766.
MACÉ C, « Demandes d'asile : Macron défend ses «hot spots» au Niger et au Tchad », in Libération le 28/08/2017, [en ligne].
NEISSE, F., NOVOSSELOFF A., « L'expansion des murs : le reflet d'un monde fragmenté ? », in Politique étrangère, Les murs : séparation et traits d’union, nº 4, 2010, pp. 731-742.
PARIZOT C., « Après le mur : les représentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens », in Cultures & Conflit, Frontières, marquages et disputes, n°73, 2009, pp. 53-72.
RILLAERTS S., « La frontière linguistique, 1878-1963 », in Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2069-2070, 2010, pp. 7-106.
RITAINE E., « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », in Cultures & Conflits, [en ligne], 2009, [consulté le 27 septembre 2017].
SIMMEL Georg, Soziologie, Leipzig, 1908, p. 685-691, trad. française par Liliane Desroche et Digressions sur l’étranger, trad. française par Philippe Fritsch et Isaac Joseph, in Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L’Êcole de Chicago, Paris, Aubier, 1984, p. 53-59.
SOEUR M., « La chute du mur », in Revue française de psychanalyse, nº 80, 2016, pp. 123-135.
TASSIN L., « Le mirage des hotspots. Nouveaux concepts et vieilles recettes à Lesbos et Lampedusa », in Savoir/Agir, Accueillir les migrants, nº 36, 2016, pp. 39-45.
YÈCHE H., « Le paradigme du Mur dans le monde contemporain : évolution et perspectives 1989-2009 », in Les Cahiers du MIMMOC, nº 5, [en ligne], 2009, [consulté le 27 septembre 2017].
VAILLANT J., « Essai d’introduction sur un sujet multiple et complexe », in Allemagne d'aujourd'hui, nº211, 2015, pp. 7-9.
VIANNA P., « Vingt-cinq ans après la chute du mur de berlin », in Migrations Société, nº158, 2015, pp. 55-60.
WIHTOL de WENDEN C., « Le tournant de 2004 : l’élargissement de l’Union européenne et la création de Frontex », in Migrations Société, nº158, 2015, pp. 125-130.
[1] YÈCHE H., « Le paradigme du Mur dans le monde contemporain : évolution et perspectives 1989-2009 », in Les Cahiers du MIMMOC, nº 5, [en ligne], 2009, [consulté le 27 septembre 2017].
[2] BOURDIEU P., Droit et passe-droit [Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements], in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 81-82, mars 1990. L’économie de la maison, op. cit. p. 88.
[3] BOURDIEU P., Sur l’État, Paris, Éditions du Seuil, 2012, op. cit., p. 53.
[4] RITAINE E., « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », in Cultures & Conflits, 2009, [en ligne].
[5] CALAME J., « La ville divisée : les minorités hors les murs », in Politique étrangère, Les murs : séparation et traits d’union, vol. hiver, n°. 4, 2010, pp. 783-797, p. 783.
[6] NEISSE, F., NOVOSSELOFF A., « L'expansion des murs : le reflet d'un monde fragmenté ? », in Politique étrangère, Les murs : séparation et traits d’union, nº 4, 2010, pp. 731-742, p. 733.
[7] BOURDIEU P., « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986, p. 6-7.
[8] BOURDIEU P., Sur l’État, Paris, Éditions du Seuil, 2012, op. cit., p. 67.
[9] BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 368.
[10] BOURDIEU P., Sur l’État, Paris, Éditions du Seuil, 2012, op. cit., p. 16.
[11] Ibid., p. 566.
[12] BOURDIEU P., Méditation pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil, 2003 (1997), p. 260.
[13] RILLAERTS S., « La frontière linguistique, 1878-1963 », in Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2069-2070, 2010, op. cit., 14.
[14] BOURDIEU P., « Droit et passe-droit [Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements] », in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 81-82, mars 1990, L’économie de la maison, p. 88.
[15] « Le 27 septembre, la Cour de cassation avait répondu par la négative, jugeant que le texte transposant dans le droit français le règlement « Dublin III » ne définissait pas ce qu’était un « risque non négligeable de fuite», invoqué pour justifier le placement en rétention des personnes qui devraient effectuer leurs démarches de régularisation dans le premier pays européen où ils sont arrivés (ou ont laissé une trace), et donc s’y trouver. Selon les autorités françaises, depuis début 2017, quatre migrants venus s’enregistrer en préfecture sur dix sont déjà connus dans un autre pays européen. La décision de la Cour de cassation faisait suite à un jugement de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans l’arrêt Chodor rendu en mars dernier, estimait également ce « risque de fuite » insuffisamment défini » Hullot-Guiot K., « Une proposition de loi pour placer plus de migrants en centre de rétention », in Libération , Op. Cit. 7/12/2017.
[16] BOURDIEU P., « La dernière instance, Le siècle de Kafka », Paris, Centre Georges Pompidou, in Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987 (1984), p. 270.
[17] « Des hotspots au cœur de l’archipel des camps », Revue migreurop.org, les notes de migreurop, nº 4, [consulté le 8 décembre 2017].
[18] BOURDIEU P., Raisons pratiques, Sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 122.